|
[165]
Joseph-Yvon Thériault
“La démocratie et le trouble identitaire”
Un texte publié dans le livre sous la direction de Mikhaël ELBAZ, Andrée Fortin et Guy Laforest, LES FRONTIÈRES DE L'IDENTITÉ. Modernité et postmodernité au Québec, pp. 165-179. Québec: Les Presses de l’Université Laval; Paris: L'Harmattan, 1996, 384 pp.
- Démocratisme et contractualisme chez les modernes
- Démocratisme et trouble identitaire chez Lionel Groulx
- Les chemins de la démocratie
-
- Conclusion
-
- Références
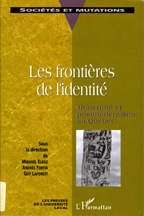

Au sein des études portant sur la société québécoise, la relation entre la démocratie et la nationalité demeure un impensé. Cela n'est pas dû à un aveuglement face aux liens existant entre les deux processus. Au contraire, cette question est omniprésente, elle hante le discours sociopolitique depuis près d'un siècle et demi. En effet, la plupart des analystes qui se sont penchés sur le destin collectif des Québécois ont cru nécessaire de lier démocratie et nationalité. Si ce lien demeure un impensé, c'est donc moins par son absence que par le caractère non problématique par lequel il a été défini. On a voulu chercher dans la relation entre démocratie et nationalité la vérité sur le mouvement national alors qu'il ne s'y trouve qu'une interrogation.
Cette vérité a été formulée, dans un premier temps, comme une incompatibilité. Incompatibilité affirmée, de Lord Durham à Mordecai Richler, en passant par Pierre Elliott Trudeau, entre l'épanouissement des institutions démocratiques libérales et la défense de sa nationalité. Une proposition d'ailleurs reprise, en écho, par le nationalisme québécois traditionnel qui verra, comme nous l'enseignera Lionel Groulx, dans les velléités du démocratisme un danger pour sa nationalité. À la sociabilité démocratique il opposera celle, plus conforme, croyait-il, à l'esprit de la race française d'Amérique, fondée sur l'inscription dans une histoire nationale.
L’affirmation d'une telle incompatibilité hante d'ailleurs toujours le milieu intellectuel québécois. La querelle contemporaine sur la prédominance des droits individuels et des droits collectifs est encore souvent posée comme une irréductible opposition entre une conception individualiste, démocratique libérale, et une conception communautaire, collectiviste, de la nation [1]. Marcel [166] Rioux (1969 : 55) voyait déjà, au début des années soixante, dans cette opposition une conception libérale, anglo-saxonne, de la démocratie et une conception collectiviste, autoritaire, francophone, de la démocratie.
À cette première proposition est venue, dans le Québec contemporain, s'en rajouter une autre. Au contraire de la thèse de l'incompatibilité entre la démocratie libérale et la défense de sa nationalité, cette deuxième proposition postule que l'affirmation nationale des Québécois est l'expression d'un approfondissement de la démocratie. À proprement parler, cette affirmation est tout aussi ancienne que la première. Elle est, en effet, déjà contenue dans le projet libéral démocratique des patriotes. Elle est explicitement formulée dans le bilan que fera Louis-Joseph Papineau de la révolte de 1837-1838. L’affirmation nationale des Canadiens français, dira-t-il alors, s'inscrit dans les idéaux de la grande révolution démocratique qui a façonné les nations modernes que sont la France et les États-Unis [2].
Au sein de la littérature sympathique au nationalisme québécois contemporain, cette dernière perception est devenue aujourd'hui hégémonique [3]. La Révolution tranquille aurait fait passer le nationalisme québécois d'une conception ethnique de la nation, antimoderne et antidémocratique, à une conception moderne, élective et contractuelle de la nation. À lire la plupart des écrits francophones portant sur la question, on serait porté à croire que le nationalisme contemporain est essentiellement un mouvement de démocratisation de la société québécoise où toute trace d'affirmation d'une nationalité particulière aurait disparu. Ainsi, depuis Bodin, dans la modernité politique, nous dit Denis Monière (1992 : 27), « souveraineté et démocratie deviendront deux concepts indissociables et auront la même signification : se gouverner soi-même. » Voilà, semble-t-on dire, la vérité du projet indépendantiste des Québécois, il n'est rien d'autre qu'une révolution démocratique tardive. La défense de sa nationalité est ainsi complètement évacuée (ou cachée) comme quelque chose de honteux eu égard à une conception moderne, démocratique, de la nation [4].
De telles perspectives, en opposant ou en assimilant les deux phénomènes, se refusent, à notre avis, à poser la question de l'articulation historique entre démocratie et nationalité. Pourtant, que des lectures aussi diamétralement opposées puissent subsister pendant plus d'un siècle aurait dû conduire à semer le doute. Des matrices aussi transparentes obscurcissent bien souvent, plutôt qu'elles n'éclairent, les phénomènes qu'elles veulent révéler. Le postulat de l'incompatibilité entre la démocratie et la défense de sa nationalité, tout comme celui de leur fusion, empêchent à notre avis de bien comprendre la dynamique qui s'opère entre l'exigence démocratique et l'exigence identitaire. Sur le plan plus proprement politique, une telle confusion participe à entretenir, chez les opposants au nationalisme québécois (particulièrement au sein des communautés anglophones et allophones), un doute sur les prétentions démocratiques des Québécois francophones tout en empêchant le Québec français de clarifier son projet identitaire à l'aune de l'univers démocratique.
[167]
Je ne voudrais pas aborder ces questions directement, c'est-à-dire par une analyse sociohistorique de l'enchevêtrement des questions de la démocratie et de la nationalité dans l'histoire du Québec. Je propose plutôt le détour par une interrogation sur la signification de l'expérience démocratique dans la modernité et son rapport avec l'enracinement social. En fait, la relation entre démocratie et nationalité au Québec apparaît un cas d'espèce d'un phénomène beaucoup plus large, soit celui de la complexité du lien, au sein de la modernité, entre le politique et le social, entre la démocratie et la communauté, entre l'universalisme et l'identité. La question nationale est riche d'enseignements parce qu'elle se situe justement au croisement de ces dichotomies.
Démocratisme et contractualisme
chez les modernes

Paradoxalement, l'aveuglement face à la complexité du lien entre démocratie et enracinement social, ou plus largement entre le politique et le social, semble en grande partie redevable à l'apparente transparence de la matrice politique moderne. De prime abord, celle-ci permet une projection simple d'une société démocratique et d'une nation moderne. Cette vérité matricielle, toutefois, est aveuglement par rapport à l'histoire effective des démocraties. En effet, tout en étant conforme à sa matrice, la réalité des démocraties est radicalement différente de l'image que projette son type idéal. Nous reviendrons sur ce paradoxe plus tard en soulignant comment la matrice politique de la modernité n'est que l'une des faces du monde moderne. Auparavant, toutefois, de façon à mieux comprendre la radicalité du projet politique moderne, rappelons quelques éléments au fondement d'une telle matrice politique.
Le premier de ces éléments est emprunté à l'histoire de la philosophie politique. La conception moderne du politique, nous dit-on, est radicalement nouvelle, car elle repose sur la disqualification, comme fondement du pouvoir au sein des sociétés humaines, de toutes réalités (sociales ou métasociales) autres que celles émanant de la pure volonté des contractants. Pierre Manent (1993), dans un article récent, rappelle comment cette idée, étonnante, naît chez Hobbes de la nécessité de faire face au pluralisme religieux et de l'incapacité, selon lui, de répondre à ce nouveau défi par une conception aristotélicienne de la politique. Pour que toutes les religions soient acceptées, pour que toutes les conceptions du monde aient droit de cité, il faut qu'aucune d'entre elles ne soit considérée vraie, qu'aucune idée du bien n'ait préséance. Il faut en quelque sorte un pouvoir qui tout en étant une création sociale (le Souverain) ne soit l'émanation d'aucune de ses composantes. Un tel pouvoir, souvent à son insu, est nécessairement un pouvoir voué à un éternel questionnement. C'est pourquoi l'une des trames de fond de la politique moderne sera l'extension de la sphère du problématique et la crise du sens qu'une telle extension ne cesse de provoquer.
La politique moderne ne vise donc pas, par le dialogue entre les différentes notions du bien qui émanent du religieux ou de l'enracinement social, à [168] découvrir ou à produire le bien absolu au fondement de la cité. Au contraire, elle permet une interminable discussion entre différentes conceptions du bien parce qu'est postulée illégitime, à tout jamais, toute prétention à occuper pleinement le lieu du pouvoir (Lefort, 1981). La politique, dans le sens d'une solution essentiellement mondaine au problème de fondation, s'est ici installée, au sein de la modernité, dans une position originelle ; elle est la véritable et la seule religion des modernes.
Le deuxième élément par lequel nous voulons rappeler la radicalité du projet politique moderne relève de la sociologie politique. Il s'agit ici de la nature du lien social propre à l'univers démocratique des modernes. Cette idée est admirablement exprimée par l'image de « dissociété » à travers laquelle Tocqueville croyait pouvoir appréhender la sociabilité moderne (Manent, 1982 : 28). À l'encontre de l'univers aristocratique où la sociabilité ressemblait à « une longue chaîne qui remontait du paysan au roi ; la démocratie brise la chaîne et met chaque anneau à part », disait-il (Tocqueville, 1981 : 126). Elle détruit continuellement le lien social en faisant croire en quelque sorte à chaque citoyen et à chaque génération qu'ils ont à recréer une société. Ainsi, concluait-il le chapitre « De l'individualisme dans les pays démocratiques » en disant : « non seulement la démocratie fait oublier à chaque homme ses aïeuls, mais elle lui cache ses descendants et le sépare de ses contemporains ; elle le ramène sans cesse vers lui seul et menace de le renfermer enfin tout entier dans la solitude de son propre cœur » (ibid. : 127).
L’existence d'une société d'individus, une dissociété, est donc le substrat sociologique à la fois nécessaire et produit par l'univers démocratique des modernes. Seuls les hommes et les femmes imprégnés d'une telle culture individualiste peuvent arriver à concevoir comme illégitime tout fondement à l'ordre social autre que celui émanant de la volonté pure.
L’idée de la nation qui se dégage de ce court rappel des fondements de la modernité politique, l'idée proprement moderne de la nation, est évidemment l'idée contractualiste : la nation comme rassemblement d'individus égaux unis par le seul lien de leur volonté. C'est à travers un véritable processus de désocialisation, un retour à son moi intérieur, que l'individu rousseauiste, par exemple, crée les conditions nécessaires à la formulation du contrat social. Augustin Cochin voit la réalisation effective de ce processus dans la représentation de la nation qui surgit au cours du processus révolutionnaire dans la France de 1789. « L'esprit de société », croit-il, s'est substitué à « l'esprit de corps » propre à l'Ancien Régime. L'esprit de société, Cochin voit sa réalisation effective dans les sociétés de pensée, véritable microcosme de la nation démocratique. François Furet résume ainsi la signification pour Cochin d'une société de pensée :
- C'est une forme de socialisation dont le principe est que ses membres doivent pour y tenir leur rôle, se dépouiller de toute particularité concrète, et de leur existence sociale réelle. Le contraire de ce qu'on appelait sous l'ancien régime les corps, définis par une communauté d'intérêts [169] professionnels ou sociaux vécus comme tels. La société de pensée est caractérisée, par chacun de ses membres, par le seul rapport aux idées, et c'est en quoi elle préfigure le fonctionnement de la démocratie (Furet, 1983 : 224).
Si la société de pensée est le prototype de la nation moderne, c'est que le peuple qui fonde la nation est dorénavant représenté comme une communauté fictive, un simple rassemblement de volontés libres. La nation moderne s'érige contre l'esprit de corps, c'est-à-dire contre toute tentative d'habiller la citoyenneté de particularités concrètes liées à l'appartenance. Certes, la nation moderne s'exprime sur un territoire (nous y reviendrons), mais il faut voir en cela un inachèvement. Car c'est bien la citoyenneté universelle, débarrassée de tout contexte normatif, comme le dirait Habermas, qui est à l'horizon du projet tant politique que philosophique des modernes.
On comprend facilement à la lumière de la conception moderne, contractualiste, de la nation comment celle-ci conduit à l'hypothèse de l'incompatibilité entre démocratie et nationalité. Il y a des mouvements démocratiques nationaux, c'est-à-dire des procès de démocratisation se réalisant à l'échelle d'un regroupement politique déjà constitué. Telles ont été, en effet, les révolutions démocratiques bourgeoises : des tentatives de disqualification des formes antérieures de pouvoir et d'individualisation de la citoyenneté. Il ne saurait toutefois exister, à proprement parler, un mouvement national authentiquement démocratique. Par essence, un mouvement national préfigure, dans sa revendication, une réalité (la nation au nom de laquelle il se bat) que l'idéologie moderne ne saurait reconnaître comme fondement. La nation doit surgir de la communauté fictive des individus, elle ne peut être le principe qui préside au regroupement des individus libres.
Telle est donc la vérité matricielle de la démocratie moderne, elle ne saurait, lorsque lue à partir de son intention première, faire une place politique à l'identité nationale.
Démocratisme et trouble identitaire
chez Lionel Groulx

C'est ce problème, inhérent au projet démocratique moderne, que Lionel Groulx perçoit dans le jugement qu'il porte sur l'évolution idéologique de Louis-Joseph Papineau et du mouvement de jeunesse dans le Bas-Canada autour de 1850. Comment expliquer, se demande-t-il alors, qu'un si grand nationaliste et patriote que Papineau (Groulx, 1937 : 206) ou qu'une jeunesse autrefois « si ardemment nationaliste » et si « respectueuse des croyances traditionnelles » (Groulx, 1936 : 218) en vinrent à « prêcher une doctrine aussi anti-patriotique que l'annexion aux États-Unis » (Groulx, 1932 : 206). Comment expliquer donc l'effacement de la référence identitaire dans la réflexion de Papineau et du mouvement de jeunesse des années 1850 ?
[170]
Dans les deux cas, la réponse de Groulx est la même : l'idéologie démocratique est responsable d'un tel égarement. « À ce moment de notre histoire, dit-il à propos de Papineau, l'idéologie démocratique trouble entièrement la vue du grand homme » (ibid.). C'est que Papineau, selon Groulx, a été contaminé lors de son exil en France par le romantisme démocratique ambiant. Et, il en est de même pour la jeunesse organisée autour de l'Institut canadien de Montréal. Tout bascule au sein de ce mouvement quand, à la suite des échos de la Révolution de 1848, « le groupe démocratique réussit à s'emparer de l'Institut » (1936 : 218).
Groulx n'est pas cet antidémocrate primaire qu'on a souvent voulu dépeindre [5]. Ses préférences politiques vont pour un régime libéral et électif susceptible de permettre aux personnalités fortes d'assumer leur rôle de leaders. Sa méfiance envers le mouvement démocratique n'est pas, non plus, une réaction élitiste devant les transformations sociales qu'un tel mouvement pourrait faire naître. « Les jeunes Canadiens, dit-il, sont épris de réformes politiques beaucoup plus que de réformes sociales » (1936 : 225). Le démocratisme qu'il perçoit et qu'il critique est un démocratisme essentiellement politique, « c'est la doctrine de la souveraineté populaire ».
Et, c'est bien, pour Groulx, la conception politique du peuple ou de la nation contenue dans l'idéologie démocratique qui est responsable de l'égarement face à la question nationale. En transférant le pouvoir au peuple, sans le définir autrement que par le vague concept de politiquement souverain, on rend trouble la capacité de saisir la vérité de ce peuple au-delà de la conjoncture politique immédiate. « Un jour même viendra où, dit-il, appelé à se prononcer sur l'opportunité de sauver de sa disparition la nationalité canadienne-française, l'Institut canadien de Montréal y daignera consentir à la majorité d'une voix » (1936 : 232). Autrement dit, la jeunesse de l'Institut en concevant l'avenir de la nationalité sous le registre d'une société de pensée n'a plus de balises pour contenir un possible débordement démocratique.
Pour le démocrate, la nation n'a pas d'essence qui précède son regroupement en société politique. Pour Groulx, le peuple démocratique passe, la nationalité reste. Il rejette la définition démocratique, car elle définit le peuple sans filiation, indifférent à l'appel du passé qui pour lui, à la manière de Maistre, fonde pourtant la vraie nature de l'âme collective. Le démocrate a une vision trouble de la nation, c'est pourquoi il est conduit à situer le peuple canadien-français un jour dans le Bas-Canada et un autre jour, en réaction à l'impérialisme britannique, comme une entité fondue « dans le vaste creuset des États-Unis, suprême incarnation de la démocratie moderne » (1936 : 227).
Le passage par Groulx nous apparaît instructif à un double titre. Il démontre bien le caractère incongru d'une position qui voit dans la revendication nationale et la revendication démocratique un seul et même processus. En postulant leur incompatibilité, et c'est là le second élément que nous retenons de son analyse, il nous dirige toutefois vers un égarement tout aussi important. Un tel aveuglement est d'autant plus surprenant qu'il semble contredire le [171] matériel historique sur lequel il travaille. En effet, autant dans le cas de Papineau que dans celui du mouvement de jeunesse, on est en présence de deux exemples pratiques de symbiose entre démocratie et nationalité. Groulx se refuse à essayer de comprendre par quels mécanismes deux matrices aussi divergentes en arrivent à se retrouver au sein du même homme ou du même mouvement. Ébloui par la vérité de la matrice démocratique, il reste aveugle à sa réalisation historique.
Ainsi, comme nous venons de le souligner, l'aveuglement de Groulx, et en cela il s'inscrit dans la foulée de la plupart des analystes de la démocratie moderne, tire son origine d'une confusion entre l'idée moderne de la démocratie (sa matrice, qu'il associe fort justement à la doctrine de la souveraineté populaire) et sa réalisation effective dans une forme de société (un régime, pour employer l'expression tocquevillienne). Il ne s'agit pas ici d'opposer l'idéal type démocratique à la plate réalité des sociétés démocratiques, ou encore, comme on le disait autrefois, la démocratie formelle à la démocratie réelle. Au contraire, nous affirmons que le régime démocratique est inextricablement lié à sa matrice. À cet égard, la démocratie moderne est à la fois un projet philosophique et un état social. Et, si ces deux versants ne peuvent être confondus, ils ne sauraient non plus se présenter comme des réalités étrangères, voire antagonistes. La démocratie que nous connaissons est un processus historique qui s'est inventé à l'interstice d'une conception nouvelle du monde (sa matrice) et d'une histoire sociale (sa pratique).
Les chemins de la démocratie

Il faut d'ailleurs aller plus loin dans cet apparent paradoxe et rappeler, à la suite de Marcel Gauchet, comment la démocratie, par l'effet même de sa matrice, a produit une société totalement différente de celle qu'elle laissait entrevoir au départ. L’idée centrale du contractualisme, on l'a vu, repose sur l'image d'une société complètement transparente, elle repose sur « une vision d'un social intégralement présent à lui-même ». En fait, dira Gauchet, « la victoire du fait démocratique s'est payée de la perte de la pensée qui lui a fourni sa prime expression » (1985 : 252). À l'encontre de ses tenants et promoteurs, ce qui a surgi du fait démocratique est un régime non pas fondé sur « l'accord profond des esprits » mais « sur le déchirement du sens et l'antagonisme sans merci des pensées » (1980 : 61). La société des individus s'est avérée être la société du conflit par excellence.
Ce développement inattendu, après quelques siècles de fonctionnement effectif des démocraties, il est possible aujourd'hui de mieux saisir comment il est, somme toute, conforme à la matrice démocratique. En effet, en disqualifiant toutes formes d'autorité, les promoteurs de la politique moderne croyaient remettre le pouvoir au social défini comme rassemblement des volontés rationnelles des individus. Une telle présomption reposait sur une méconnaissance du fonctionnement des sociétés humaines. Les théoriciens du contrat [172] social avaient peu ou pas d'intuition de la complexité du rapport entre l'individu et son milieu. La pensée sociopolitique viendra d'ailleurs infléchir rapidement une telle présomption. On réalisera que ces êtres dits libres sont traversés de toutes parts par des forces qu'ils ne contrôlent pas, par des mécanismes difficilement identifiables. Le pouvoir remis à la société, perçue comme rassemblement de subjectivités individuelles, a été en fait un pouvoir remis à une myriade d'intersubjectivités. Somme toute, la matrice démocratique repose sur la négation d'un reste anthropologique que, par exemple, la sociologie au dix-neuvième siècle s'évertuera à extirper. C'est pourquoi la remise du pouvoir aux individus s'est avérée être la remise du pouvoir à ces multiples relations dans lesquelles les individus sont effectivement inscrits.
Les remarques de Marx, dans La Sainte Famille, sur l'individualisme bourgeois demeurent encore l'une des meilleures illustrations de cette découverte, par la pensée du dix-neuvième siècle, d'un individu qui tout en se posant comme autonome est néanmoins au centre d'un tissu de relations sociales.
- À parler avec précision et au sens prosaïque du terme, les membres de la société bourgeoise ne sont pas des atomes. [...] L’individu égoïste de la société bourgeoise a beau, dans sa représentation non sensible et son abstraction sans vie, se gonfler jusqu'à se prendre pour un atome, c'est-à-dire un être sans la moindre relation, se suffisant à lui-même, sans besoins, absolument plein, en pleine félicité, l'infortunée réalité sensible, elle, ne se soucie pas de l'imagination de cet individu [...] Chacune de ses activités et de ses propriétés essentielles, chacun de ses instincts vitaux devient un besoin, une nécessité, qui transforme son égoïsme, son intérêt personnel en intérêt pour d'autres choses et d'autres hommes hors de lui (Marx, 1972 : 146-147).
Il ne faut pas uniquement reconnaître la persistance au sein des démocraties réelles d'une sociabilité (un reste anthropologique) que la matrice démocratique tend à nier, il faut aussi voir que cette réalité sensible est activée, stimulée, par l'univers démocratique. Le paradoxe des démocraties modernes (paradoxe créateur s'il en est un), c'est que la subjectivité abstraite qui leur sert de fondement active les prétentions des intersubjectivités particulières à occuper le lieu du pouvoir. Il ne pouvait en être autrement.
Encore ici, Marx avait bien vu ce mouvement de la société réelle démocratique dans la réponse qu'il donnait à B. Bauer qui affirmait « qu'il n'y a pas de religion s'il n'y a plus de religion privilégiée ». Au contraire, disait Marx, « [...] la religion se déploie dans son universalité pratique [qu'on imagine les États-Unis d'Amérique] que là où n'existe pas de religion privilégiée » (1972 : 142). La prolifération des religions ne se réalise que dans les sociétés qui ont cessé d'être des sociétés religieuses. Un phénomène que le jeune Marx ne limitait d'ailleurs pas à la religion mais à l'ensemble des aspects de la vie libérés, pensait-il, par la matrice démocratique moderne. « Ce qui sert de fondement à "l'état des choses public" moderne, poursuivait-il, c'est-à-dire à l'État [173] moderne développé, ce n'est pas comme la critique le pense, la société des privilèges, mais la société des privilèges abolis et dissous, la société bourgeoise, où sont libérés les éléments de vie encore politiquement entravés dans les privilèges » (ibid.). Il est vrai que Marx verra dans cette libération des « éléments de vie » une particularisation qui aliène l'homme de sa communauté universelle. C'est pourquoi il propose de ressouder l'individu à sa communauté. Une telle lecture de la matrice démocratique moderne, rappelons-le encore une fois, en est une de premier niveau, elle se rend aveugle à saisir l'originalité de phénomènes qu'il avait pourtant identifiés. Marx voit une limitation à ce qui nous apparaît la force créatrice de la démocratie moderne, la scission qu'elle opère entre la société civile et l'État (Thériault, 1992).
Revenons à l'essentiel. Ces « éléments de vie », libérés et activés par l'univers démocratique, soulignent la permanence d'un enracinement des sujets humains dans une intersubjectivité. En quelque sorte, ce que la matrice démocratique disqualifie pour instituer le fondement moderne du politique, la politique ne cesse de le réhabiliter. C'est ainsi qu'il faut voir comment les antagonismes religieux, de classes, de genres, de projets de vie, de nationalités ont formé la vie réelle des démocraties. Ces acteurs sociaux ne luttent pas exclusivement, ou prioritairement, au nom des valeurs propres à la démocratie, c'est-à-dire qu'ils ne visent pas la réalisation de l'idée de liberté par la disqualification de toute autorité et la réalisation d'une communauté d'individus libres. Ils interviennent sur la scène publique, au contraire, en voulant la remplir par la réalisation d'une vérité pratique, en rêvant bien souvent de reconstruire l'unité du corps social à partir d'une intersubjectivité particulière, une identité.
Ainsi, la démocratie s'est-elle construite par une activité largement inconsciente d'elle-même ou ses principaux artisans professaient bien souvent des doctrines largement antidémocratiques (Gauchet, 1980). Rappelons simplement l'exemple du mouvement ouvrier, acteur s'il en fut un, au cœur de la praxis démocratique moderne. Celui-ci a longtemps vu dans la démocratie une fiction bourgeoise visant à assurer la pérennité de la domination du capital. La question sociale, comme on le disait au XIXe siècle, fut l'enjeu de ses luttes, un enjeu qui exigeait le dépassement du régime de la souveraineté populaire au nom de l'égalité réelle [6].
Soulignons encore l'exemple contemporain du mouvement écologiste. Luc Ferry (1992) a démontré récemment comment celui-ci porte en son sein une critique antihumaniste et, par conséquent, antidémocratique de la modernité. En voulant soumettre la communauté élective des hommes aux lois inhérentes à leur insertion dans une nature, les écologistes proposent de rétablir un étalon, une idée du bien, qui aurait préséance sur celles issues de la délibération des citoyens. Il serait possible d'allonger la liste et de voir dans la myriade des mouvements sociaux ayant jalonné l'histoire des démocraties (du romantisme au nationalisme, du mouvement des femmes au tiers-mondisme) des revendications fondées sur une intersubjectivité particulière, sur un désir d'identité.
[174]
Activité démocratique inconsciente d'elle-même, disions-nous, car tout en s'inscrivant dans un projet visant à combattre l'abstraction idéaliste de la démocratie, ces mouvements participent à étendre sa logique. Le paradoxe démocratique est double en effet. Dans un premier moment la disqualification de toutes les prétentions à occuper le lieu du pouvoir permet, comme nous venons de le voir, la prolifération de tous les points de vue ayant chacun en sous-main le projet de rétablir l'unité du monde. Ce qui pourrait nous faire penser que la démocratie est vouée à l'entropie. Ce serait toutefois une analyse hâtive. La prolifération des points de vue a comme résultat, à rebours, d'affaiblir chacun des points de vue dans sa prétention à détenir la vérité sur l'organisation de la vie. Pour anticiper sur nos conclusions, disons que l'abbé Groulx avait raison de voir dans le démocratisme un semeur de trouble dans l'esprit de certains qui pourtant possédaient au départ des convictions inébranlables.
Ainsi, les chemins de la démocratie réelle, quoique balisés par la matrice démocratique, ne sont pas tracés par elle. C'est pourquoi il est juste de voir dans la démocratie, à la suite de Tocqueville, des régimes où il est possible de tout dire et de tout oser et, en même temps, des régimes qui s'interdisent de tout entreprendre et qui cheminent vers un certain conservatisme heureux. Ce sont des sociétés tournées vers le changement, tout en étant vouées au compromis social. Encore ici, l'exemple du mouvement ouvrier est éloquent. C'est dans les régimes où il a pu s'exprimer le plus librement, où la lutte des classes fut la plus vive et la plus ouverte, qu'il a le plus accepté le compromis avec l'ennemi de classes en mettant de côté son projet révolutionnaire et en optant pour la social-démocratie. Les sociétés démocratiques sont par excellence des sociétés du conflit, mais où la guerre sociale, par l'effet de l'ébranlement des évidences, se transforme en un conflit soft, se dépassionne (Lipovetsky, 1983). Ce sont, bref, des sociétés qui doutent continuellement d'elles-mêmes, car la matrice démocratique sème le trouble dans les convictions en apparence les plus inébranlables.
Alain Touraine nous a récemment rappelé cette vérité : le Sujet moderne n'est pas purement démocratique. Il n'est pas simple « volonté de dégagement, distance à l'égard des rôles imposés, liberté de choisir et d'entreprendre. [...] Le Sujet est autant un corps, une mémoire, des origines » (1992 : 343). Il nous a rappelé aussi comment ces deux faces de la modernité, démocratie, c'est-à-dire désir de liberté, et communauté, c'est-à-dire défense d'une identité, doivent continuellement se combiner. « C'est dans leur intégration, précise-t-il, que la modernité s'accomplit. » Ce constat, ne faut-il pas le comprend plus comme un souhait que comme un fait ? La modernité étant tiraillée entre l'arrogance absolutiste d'un sujet universel et la tentation totalitaire présente au sein du désir identitaire. Une combinaison heureuse entre ces deux moments de la modernité relève d'ailleurs plus de l'art du politique que du fait sociologique.
Ainsi en est-il, à notre avis, du rapport entre démocratie et nationalité. Ce sont deux faces de la modernité qui ne doivent ni être confondues ni être posées [175] en radicale altérité. Elles expriment une tension inhérente au régime démocratique, tension entre la tendance démocratique à transformer le social en « société de pensée » et un reste anthropologique qui reproduit continuellement une « société de corps ». Dans les faits, aucune démocratie n'est complètement une société de pensée, aucune nation exclusivement une nation contrat. La négation du social qu'une telle perspective recouvre rend d'ailleurs une telle hypothèse irréalisable. Elle est d'autre part non souhaitable. Un dialogue purement décontextualisé conduirait à une cacophonie des subjectivités individuelles (version nietzschéenne) ou encore au despotisme de la raison (version habermassienne). C'est pourquoi aussi, sans être au fondement de la conception moderne du politique, la « société de corps », qu'on peut assimiler ici à l'idée de nation-culture, est inhérente au fonctionnement de toute société démocratique. C'est au sein d'un tel enracinement que le débat politique trouve sa matière première. Nier la tension entre ces deux réalités, c'est, comme nous l'avons vu, s'interdire de comprendre le fonctionnement effectif des démocraties.
CONCLUSION

C'est à la lumière de cette tension qu'il nous semble possible de mieux comprendre la dynamique historique qui s'est instaurée au Québec entre démocratie et nationalité, entre modernité et identité. Cette dynamique s'est construite à l'interstice de tendances oppositionnelles et de logiques fusionnelles. Nous ne ferons qu'esquisser ici une telle lecture.
La quasi-simultanéité au Québec entre la création d'institutions démocratiques libérales par l’Acte constitutionnel de 1791, ce qui peut être interprété comme l'émergence d'un espace public moderne, et les premières manifestations du nationalisme canadien-français au début du XIXe siècle, n'est pas à notre avis fortuite. Déjà, Lord Durham notait comment l'octroi par le gouvernement britannique d'institutions représentatives a avivé au sein de la population canadienne-française un vague désir d'indépendance nationale. Les Canadiens français, disait-il, ont utilisé (et même abusé pensait-il) des institutions démocratiques pour affirmer leur caractère national [7].
Cette simultanéité, toutefois, ne doit pas nous conduire à confondre les deux processus. L'affirmation nationale des Canadiens français ne recouvre pas totalement le procès de démocratisation alors en cours. Encore ici, Durham est un précieux guide. La défense de sa nationalité, dit-il, est un danger pour le développement des institutions démocratiques libérales, car elle vise à réinstaller un fondement au sein de l'espace public qui obnubile toutes les autres questions politiques. Groulx, nous l'avons rappelé, fera le même diagnostic tout en inversant la perspective. Le démocratisme en relativisant la question nationale introduit le trouble dans l'esprit des patriotes.
Ces deux perspectives contradictoires, comme on l'a dit, expriment deux tendances inhérentes à tout régime démocratique. Durham appréhende [176] l'émergence du nationalisme canadien-français à partir de la matrice démocratique moderne : il voit dans le développement d'un mouvement identitaire un frein au déploiement d'une société d'individus au Bas-Canada. Groulx concentre son analyse, pour sa part, sur le fonctionnement effectif du régime démocratique et, dans sa foulée, sur l'existence d'une revendication d'identité fondée sur une filiation : il voit dans l'excès démocratique une force menaçante pour le déploiement d'une telle identité.
Et, justement parce que ces deux processus existent simultanément au sein des régimes démocratiques, la projection pessimiste qui découle de chacune de ces analyses ne s'est pas réalisée. Tout se passe comme si ces deux pôles antagonistes s'activent et s'annulent mutuellement. Ce qui a comme conséquence non pas de paralyser le développement historique, mais bien de lui faire suivre un chemin tortueux fort différent de l'intention première des acteurs. La revendication nationalitaire n'a pas rendu inopérantes les institutions démocratiques, comme le projetait Durham, parce qu'elle a été troublée, comme le percevait Groulx, par le démocratisme. La démocratie n'a pas effacé, comme le projetait Groulx, la mémoire de filiation, parce qu'une telle mémoire est stimulée, selon l'intuition de Durham, par la logique démocratique.
Un siècle plus tard, modernité démocratique et nationalisme se retrouveront dans un rapport de fusion et d'opposition tout aussi inextricable. En effet, depuis la Seconde Guerre mondiale, la société québécoise est le lieu, non pas d'une entrée dans la modernité, mais d'une extension des logiques modernes à de nouvelles catégories sociales et à de nouvelles activités. La fin du cléricalisme, la rationalisation de l'État, l'extension des valeurs individualistes et entrepreneuriales sont des signes, parmi d'autres, de cette nouvelle étape du développement de l'individualisme démocratique. Encore ici, cette accentuation du démocratisme n'a pas résulté dans l'effacement de la revendication identitaire. Au contraire, un puissant mouvement identitaire accompagne cette nouvelle avancée de la modernité.
La simultanéité des deux processus confirme, s'il le fallait, le caractère fallacieux de la thèse selon laquelle la modernité démocratique repose essentiellement sur un procès d'individualisation au détriment de toute forme de communalisation. L’accentuation de la révolution démocratique a présidé dans le Québec contemporain à l'accentuation du désir d'autonomie nationale. Mais encore ici, il serait dangereux de confondre les deux processus.
Le désir de souveraineté nationale en autant qu'il s'applique à un espace spécifique (en l'occurrence ici le Québec) est, nous l'avons déjà rappelé, incompréhensible à la seule lumière de l'exigence démocratique. Pourquoi, se demandera-t-on alors, une telle exigence de souveraineté se limite-t-elle au territoire du Québec ? Pourquoi pas, en suivant l'exemple du démocratisme de Papineau dénoncé par Groulx, ne pas l'étendre à l'ensemble de l'Amérique ? Parce que, et la réponse semble tellement évidente, le Québec est le foyer principal d'un peuple, c'est-à-dire le lieu de déploiement d'un héritage particulier, d'une identité. Le mouvement national vise à doter ce peuple d'un instrument [177] politique, non pas à démocratiser un espace politique préalablement existant. C'est d'ailleurs parce qu'un tel mouvement n'est pas spontanément démocratique qu'il est normal qu'on exige de ses principaux porte-parole des énoncés sans nuances sur les engagements démocratiques d'un Québec souverain. On ne saurait s'offusquer de telles exigences.
À l'opposé, toutefois, parce que le mouvement national québécois baigne dans un univers démocratique (même s'il n'est pas par essence démocratique), on peut penser que de telles appréhensions sont superflues. La dynamique démocratique que nous avons décrite empêchera, au grand dam des plus ardents nationalistes d'ailleurs, que le mouvement national, même à la tête d'un Québec souverain, règle une fois pour toutes le problème de la nationalité. Un processus d'érosion de la « vérité » identitaire est d'ailleurs en cours. Déjà, on a laissé tomber l'assimilation des premiers moments du mouvement entre un projet social d'inspiration socialiste et le projet national. L'entrepreneur québécois se demandait à bon droit en quoi un Québec socialiste est plus conforme à la nationalité québécoise qu'un Québec Inc. ; il exigera une conception de la nation moins politiquement exclusive. Plus récemment, la prétention du mouvement national à définir l'espace québécois à partir d'un héritage français a activé des prétentions contraires. On pense notamment aux anglophones, aux Autochtones, aux communautés culturelles qui soudainement revendiquent leur appartenance au Québec et exigent une définition de la nationalité qui ne les exclut pas. Ces prétentions contraires, amenées par le débat démocratique sur l'identité québécoise, ont semé le trouble dans l'esprit de plus d'un nationaliste.
Tous conviendront aujourd'hui, après trente ans de débats passionnés, que l'idée de la souveraineté nationale est plus floue, plus timorée, moins exclusive que l'était sa prime version des années soixante. Ce qui était présenté dans un premier temps comme une guerre à finir entre d'irréductibles adversaires se transforme lentement en une souveraineté soft, débarrassée de tout contenu normatif. Tout indique d'ailleurs que le projet souverainiste n'aura de chance de recevoir l'approbation populaire qu'en autant qu'il intensifie une telle désubstantialisation. C'est aujourd'hui le peuple entier qui tout comme Papineau au siècle dernier a été contaminé par le démocratisme. Car, n'en déplaise à Monsieur Parizeau, la clarté doctrinale n'a pas d'avenir en démocratie.
[178]
RÉFÉRENCES

Balthazar, L. (1992), «L'évolution du nationalisme québécois» : 647-666, dans G. Daigle et G. Rocher (dir.), Le Québec enjeu, Montréal : Presses de l'Université de Montréal. [Livre disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.]
Bergoniaux, A. et B. Manin (1979), La social-démocratie ou le compromis, Paris : Presses Universitaires de France.
Delisle, E. (1992), Le traître et le juif, Outremont : L’étincelle.
Durham, J.G.L. (1839), Le Rapport Durham, Montréal : L’Hexagone, 1990.
Ferry, L. (1992), Le nouvel ordre écologique, l'arbre, l'animal et l'homme, Paris : Grasset.
Furet, F. (1983), Penser la Révolution française, Paris : Gallimard.
Gauchet, M. (1980), « Tocqueville, l'Amérique et nous », Libre, 7 : 43-120.
Gauchet, M. (1985), Le désenchantement du monde, une histoire politique de la religion, Paris : Gallimard.
Groulx, L. (1932), « Louis-Joseph Papineau. L’homme politique » : 189-211, dans Notre maître le passé (vol. 1), Montréal : Librairie Granger frères.
Groulx, L. (1936), « Un mouvement de jeunesse vers 1850 » : 213-232, dans Notre maître le passé (vol. 2), Montréal : Librairie Granger frères.
Lefort, C. (1981), L'invention démocratique, Paris : Fayard.
Létourneau, J. (1991), « La nouvelle figure identitaire du Québécois. Essai sur la dimension symbolique d'un consensus social en voie d'émergence », British Journal of Canadian Studies, 6, 1 : 17-38.
Lipovetsky, G. (1983), L'ère du vide. Essais sur l'individualisme contemporain, Paris : Gallimard.
Manent, P. (1982), Tocqueville et la nature de la démocratie, Paris : Juliard.
Manent, P. (1993), « La démocratie comme régime et comme religion », dans La pensée politique. Tome 1. Situations de la démocratie, Paris : Gallimard/ Le Seuil.
Marx, K. (1972), La Sainte Famille, Paris : Éditions sociales. [Livre disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.]
Monière, D. (1992), L'indépendance, Montréal : Québec/Amérique. [Livre disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.]
Papineau, Louis-Joseph (1839), « Histoire de l'insurrection du Canada en réfutation du Rapport de Lord Durham » : 72-80, dans A. Ferretti et G. Miron (dir.), Les grands textes indépendantistes, Montréal : L'Hexagone, 1992.
[179]
Rioux, M. (1969), La question du Québec, Paris : Seghers.
Simard, J.-J. (1990), « La culture québécoise : question de nous », Cahiers de recherche sociologique, 14 : 131-141.
Thériault, J.-Y. (1991), « Individualisme, nationalisme et universalisme : l'affaire Durham », communication présentée lors du colloque « Mouvements sociaux et représentation politique, Québec/Brésil », Université du Québec à Montréal (à paraître).
Thériault, J.-Y. (1992), « De l'utilité de la conception moderne du privé et du public », Politique, 21 : 37-69.
Thériault, J.-Y (1993), « Le droit d'avoir des droits » : 13-28, dans J. Lafontant (dir.), L’État et les minorités, Saint-Boniface : Éditions du blé/Presses universitaires de Saint-Boniface.
Thériault, J.-Y. (1994), «L'individualisme démocratique et le projet souverainiste», Sociologie et sociétés (« Québec fin de siècle »), XXVI, 2. [Livre disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.]
Tocqueville, Alexis de (1981), De la démocratie en Amérique (tome 2), Paris : Garnier/Flammarion. [Livre disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.]
Touraine, A. (1992), Critique de la Modernité, Paris : Fayard.
Fin du texte
Notice biographique
[371]
- J.-YVON THÉRIAULT
J.-Yvon Thériault est né en 1949. Il a étudié au Collège de Bathurst (B.A., 1971), à l'Université d'Ottawa (M.A., 1973) et à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris (doctorat, 1981). Professeur de sociologie à l'Université d'Ottawa, il est aussi depuis 1992 doyen associé (recherche) à la Faculté des sciences sociales. Il est l'auteur d'une thèse de doctorat, Acadie coopérative et développement acadien : contribution à une sociologie d'un développement périphérique et à ses formes de résistance (Paris : EHESS, 1981) ; La société civile ou la chimère insaisissable (Montréal : Québec Amérique, 1985) ; L'état de la recherche sur la francophonie minoritaire (en collaboration avec L. Cardinal et J. Lapointe (Ottawa : CRCCF, 1994) ; ainsi que L'identité à l'épreuve de la modernité (Éditions d'Acadie, 1995). Ces récents travaux et publications portent principalement sur les questions de la démocratie, de l'individualisme et des mouvements sociaux dans les sociétés contemporaines ainsi que sur la question identitaire dans la société québécoise, en Acadie, et au sein de la francophonie canadienne minoritaire.
[1] Nous avons développé plus longuement dans « Le droit d'avoir des droits » (Thériault 1993) la question du lien entre droits individuels et droits collectifs.
[2] Voir Papineau (1839). On se référera ici plus particulièrement aux remarques de Groulx (1932) sur la pensée politique de Papineau.
[3] Voir sur cette question, par exemple, le bilan que fait Balthazar (1992).
[4] Certes, des lectures nationalistes identitaires persistent, notamment dans les pages de l'Action nationale. Toutefois, la nouvelle figure identitaire du Québec des années 1980 est plus pragmatique tout en essayant de structurer un discours nationaliste autour de l'espace territorial (voir Létourneau, 1991 ; Thériault, 1994).
[5] Voir à cet effet le livre pamphlet de E. Delisle (1992) et la critique sans nuances qu'elle effectue de l'œuvre de Groulx.
[6] Sur le difficile rapport entre le mouvement ouvrier et la démocratie, voir Bergoniaux et Manin (1979).
[7] Nous reprenons ici des éléments que nous avons présentés dans « Individualisme, nationalisme et universalisme : l'affaire Durham » (Thériault, 1991).
|

