|
CITÉ LIBRE. Une anthologie.
III. Sur la démocratie
“Réflexions sur la politique
au Canada français”
par Pierre Elliot Trudeau
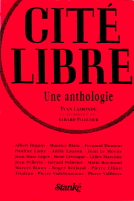
Pierre Elliott Trudeau. « Réflexions sur la politique au Canada français », Cité libre, 2, 3 (décembre 1952) : 53-70.
Un texte publié dans l’ouvrage d’Yvan Lamonde, avec la collaboration de Gérard Pelletier, CITÉ LIBRE. Une anthologie, pp. 69-85. Montréal : Les Éditions internationales Alain Stanké, 1991, 415 pp. [Autorisation formelle accordée par Yvan Lamonde et son éditeur, le 2 septembre 2008 de diffuser ce livre dans Les Classiques des sciences sociales.]
- I -
Il faut expliquer notre immoralisme profond.
Car enfin nous prétendons être un peuple chrétien. Nous adhérons à une éthique où les devoirs vis-à-vis de la société et du prochain sont rigoureusement définis. Nous ne manquons pas de respect envers l'autorité civile, et nous vivons habituellement dans un climat d'obéissance aux lois. Nous punissons la trahison et l'assaut au nom du bien commun et de la loi naturelle ; nous expliquons le communisme par un fléchissement dans la foi ; nous considérons la guerre comme la rançon du péché.
Bref, nous entretenons sur l'ordre social des conceptions orientées par la théologie catholique, et nos moeurs témoignent en général de la sincérité de ces vues, - sauf en un domaine. Dans nos relations avec l'État, nous sommes passablement immoraux : nous corrompons les fonctionnaires, nous usons de chantage avec les députés, nous pressurons les tribunaux, nous fraudons le fisc, nous clignons obligeamment de l'oeil « au profit de nos oeuvres ». Et en matière électorale, notre immoralisme devient véritablement scabreux. Tel paysan, qui aurait honte d'entrer au lupanar, à chaque élection vend sa conscience pour une bouteille de whisky blanc. Tel avocat, qui demande la peine maximale contre des voleurs de tronc d'église, se fait fort d'avoir ajouté deux mille noms fictifs aux listes des électeurs. Et les histoires de malhonnêtetés électorales ne scandalisent pratiquement plus personne, tellement elles ont peuplé l'enfance de notre mémoire collective.
Dire que « la démocratie ne prend pas chez les peuples latins » et que « les nordiques ont un sens civique plus aigu que le nôtre » n'explique rien du tout : il faut trouver pourquoi cela est. Dans le cas des Canadiens français, je crois que c'est d'abord à l'histoire politique qu'il faut demander la réponse.
Notre démocratie parlementaire, comme nous le rappelle Lussier, est essentiellement d'origine britannique. Après la conquête, vainqueurs et vaincus furent plus ou moins d'accord pour importer progressivement les formes politiques anglaises, mais pour des raisons à mon avis diamétralement opposées. Les Canadiens d'origine britannique voyaient le self-government comme la façon la plus noble de régir les rapports des hommes entre eux : leur dignité de citoyens libres ne se satisferait de rien de moins. Pour les Canadiens français, au contraire, cette institution ne pouvait briller d'aucun éclat intrinsèque : avant 1763, le pays n'avait connu qu'un gouvernement autoritaire ; et même à l'échelle municipale, comme le montre J.-C. Falardeau (French Canada, Past & Present, p. 6) le paysan n'a pour ainsi dire jamais participé activement aux affaires publiques.
Si donc l'on vit, au siècle dernier, les Canadiens français se lancer à corps perdu dans la politique, on ne saurait attribuer ce phénomène à un engouement soudain pour le « gouvernement responsable ». Nous n'avions alors qu'une passion : survivre. Et à cet effet le suffrage universel pouvait bien s'avérer un instrument commode. Aussi bien, en important pièce à pièce le système parlementaire anglais, notre dessein secret n'était pas seulement d'en user mais d'en abuser. À d'autres la recherche du gouvernement idéal : nous faisions flèche de tout bois. (Tout dernièrement, dans Esprit, page 185, Frank Scott exprimait la même idée, dans un sens nullement injurieux, en écrivant que le Canadien français « s'est servi de la démocratie plutôt qu'il n'y a adhéré comme à une doctrine ».)
Or le parlementarisme anglais repose sur des prémisses assez claires : deux partis qui, par des moyens différents, veulent poursuivre un bien commun identique, établissent des règles de jeu au terme desquelles le parti majoritaire aura le droit d'organiser cette poursuite, à charge toutefois de céder la place à l'autre dès que celui-ci aura prouvé, en cessant d'être minoritaire, que ses moyens à lui seraient plus acceptables.
Le jeu suppose donc premièrement l'entente sur le bien à poursuivre, et deuxièmement la possibilité périodique pour la minorité de devenir majorité. Or d'une part il n'y eut jamais au Canada entente sur le but à poursuivre, car l'élément français a toujours réclamé l'égalité absolue avec l'anglais, ce que les gouverneurs d'avant l'Acte d'Union de même que la députation canadienne-anglaise d'après, n'ont jamais voulu considérer. D'autre part, le bascule des majorités et des minorités ne pouvait se faire puisque fondamentalement cette division ne relevait pas de variations électorales, mais d'une répartition ethnique assez stable.
Il ne se présenta ainsi aux nôtres que deux possibilités. Ou bien saboter la machine parlementaire par une obstruction systématique, comme le firent les Irlandais à Westminster ; qui sait ? cette méthode pure de compromis nous aurait peut-être valu le home rule laurentien, et nous ferions aujourd'hui de la politique honnête - dans un État sans conséquence. Ou bien, jouer en apparence le jeu parlementaire, mais sans nous croire moralement liés par ses postulats de base ; c'est à ce choix que se rallièrent les ancêtres, en refusant de cantonner pour toujours leur canadianisme à l'intérieur du Bas-Canada.
Ils comprirent que pour longtemps encore ce gouvernement du peuple par le peuple ne serait pas pour le peuple mais surtout pour la partie anglophone de ce peuple. Dès lors, c'est avec des restrictions mentales qu'ils adhérèrent au contrat social : ils ne crurent pas qu'une « volonté générale » pût naître sans entente ethnique ; et ne pouvant pas aspirer à jouir en égaux d'un bien commun canadien, ils se rabattirent secrètement sur la poursuite de leur bien particulier. C'est-à-dire qu'ils formèrent une communauté à l'intérieur de la communauté ; pour préserver la première ils trichèrent contre les règles de la seconde. La ruse et le compromis dictèrent leurs choix de partis ou d'alliances : dès le gouvernement de l'Union, le peuple semblait se désintéresser de toute idéologie sauf de la nationaliste. Pour lui, Tory et Clear-Grit, conservateur et libéral, ne se rapportaient pas à des techniques d'administration, autant qu'à une alternance qui faciliterait les enchères et les concessions : aussi bien, on trouva plus simple de parler de bleu et de rouge. C'est ainsi que la condamnation du libéralisme par l'Église et les avantages de la réciprocité pour notre peuple n'empêchèrent pas Laurier de gagner en 1896 et de perdre en 1911 : notre peuple ne votait pas pour ou contre une idéologie philosophique ou économique, mais uniquement pour le champion de nos droits ethniques ; Laurier d'abord, Bourassa ensuite.
Hélas ! c'est en trichant qu'on devient tricheur. Une casuistique subtile nous avait autorisés à enfreindre certaines règles du jeu politique, et voilà qu'à la fin le jeu tout entier glissa hors du champ de la moralité. Nous avions si bien subordonné le bien commun (canadien) au bien particulier (canadien-français) que nous perdîmes le sens moral de notre obligation vis-à-vis du premier. Et hors des temps de crise (Riel, écoles séparées de l'Ouest, conscription), où nous nous ralliions d'instinct pour assurer le bien particulier de notre survivance au sein de la communauté globale, chacun se crut en droit de poursuivre, au détriment de celle-ci, son bien particulier à lui. C'est dire que notre sens civique fut perverti ; nous devînmes des opportunistes.
Cette genèse de notre incivisme se double aussi d'explications d'ordre religieux. Sans rien préjuger de l'avenir, il faut reconnaître que les catholiques, en tant que collectivité, ont rarement été des piliers de la démocratie - je le dis à notre grande honte. Car ils en arrivent à si bien mêler les questions spirituelles et temporelles, qu'ils se résignent difficilement ensuite à statuer d'aucune vérité en comptant des votes. Et dans les pays à grande majorité catholique (Pologne, Autriche, Espagne, Portugal, Italie, républiques sud-américaines, - l'Irlande fait exception) souvent ils n'échappent à l'anarchie que par l'autoritarisme, tandis que là où leur force est moindre (France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, États-Unis, Canada) ils acceptent la séparation de l'Église et de l'État comme un pis-aller, ils consacrent leurs énergies civiques à la poursuite du bien particulier catholique et, comme groupe, ils ne se signalent ni par leur moralité ni par leur clairvoyance politique.
C'est là encore une raison pourquoi au Québec, où chacun sait que l'autorité vient de Dieu, on n'attache guère d'importance aux simagrées électorales : ce sont des divertissements protestants et anglo-saxons dont la signification profonde reste obscure, et dont l'utilité immédiate se traduit par la bouteille de whisky à recevoir, par la salle paroissiale à faire bâtir, ou par le contrat de route à obtenir.
On prétendra peut-être que sociologiquement j'ai tort de généraliser, puisque beaucoup de gens se désolidarisent de ces pratiques malhonnêtes. Mais c'est justement ce que je n'admets pas : sous notre régime, la collectivité politique est solidairement responsable des procédures par lesquelles elle se donne des chefs. Tolérer que d'autres fassent le mal en ce domaine, c'est manquer de vigilance à l'endroit du bien commun. Ceux par exemple qui refusent de voter parce que « la politique est trop sale » sont en fait les grands responsables des « télégraphes », puisque les machines électorales se chargeront de voter à leur place, comme le fait comprendre Pierre Laporte.
Mais il faut dire qu'en pareille matière notre immoralité s'appuie sur une ignorance crasse et d'autant plus néfaste que chacun se croit spécialiste. Or à peu près personne ici n'a lu La République et Le Contrat social ; et la petite vogue pour L'Humanisme intégral n'a guère survécu au désaccord survenu entre Maritain et notre épiscopat sur les questions franquistes et pétainistes. C'est pourquoi le civisme reste « une foule de petites choses », et nous pensons que le parti pris doit tenir lieu de réflexion, dans des discussions par exemple sur le rôle de la loi, ou la fonction d'un budget national.
Car, fait paradoxal, la tournure de notre esprit nous dispose assez à discuter de théorie politique, et notre ignorance n'est pas tant le fruit de la paresse que du préjugé. Pour des raisons historiques et religieuses, nous sommes prévenus contre le système démocratique sans l'avoir loyalement mis à l'essai ; cela explique que nos élucubrations, après avoir été nationalistes pendant des générations, s'exprimèrent enfin carrément dans des idéologies d'extrême droite : bon nombre d'intellectuels embrassèrent le maurrassisme, subséquemment des hommes d'action cédèrent à la tentation du fascisme, et d'une façon générale notre peuple éprouva un engouement pour les gouvernements autoritaires de chez nous et d'ailleurs.
- II-
La grande crise économique des années trente marque cependant un renouveau de notre pensée politique, le premier tournant important depuis 1791. Nous commençâmes d'abandonner la conception de l'État-gendarme, simple protecteur de droits acquis. Comme tant de peuples envahis par la misère, notre confiance dans le libéralisme classique fut ébranlée : nous exigeâmes de l'État qu'il intervînt positivement pour guérir la plaie du chômage et corriger les scandales de la mauvaise distribution.
Mais les peuples pensent les problèmes avec les cerveaux qu'ils se sont formés, en conséquence de quoi notre malaise économique et social finit encore par se traduire politiquement par un regain de nationalisme. (Il faut relire là-dessus ce que Pierre Vadeboncoeur écrivait sur l'irréalisme de notre culture, dans les dernières livraisons de Cité libre.) Ainsi donc, au sein d'une crise qui transcendait toutes les frontières, au milieu de bouleversements économiques à l'échelle mondiale, cependant que les États-Unis inauguraient le new deal et que les Anglais préparaient la révolution keynésienne, tandis que les Canadiens anglais fondaient les mouvement CCF et Crédit social, les Canadiens français, eux, voulurent que l'État remédiât au chaos économique par un raffermissement de son nationalisme.
Non pas certes que nous nous soyons désintéressés des problèmes sociaux. Dans l'arène provinciale, l'Action libérale nationale renversa Taschereau avec un programme de réformes sociales, qui servit ensuite à lancer l'Union nationale. On discuta avec ferveur les idées du major Douglas. Les Jeune-Canada, malgré leur préoccupation intempestive pour les questions de langue et de nationalité, faisaient quand même campagne contre le trust de l'électricité. Mais en fin de compte, l'intervention qu'on réclamait de l'État était surtout d'ordre nationaliste : à notre idée, nos malheurs ne venaient pas du système économique en tant que tel, mais en tant que dominé par « les Anglais ». Ainsi, M. Paul Bouchard avec raison explique la naissance de l'Union nationale par le « désarroi de notre nationalité devant... sa minime emprise sur l'économie de la province », et E.C. Hughes (French Canada in Transition, page 89) * nous rappelle ce fait curieux que les Canadiens français votèrent pour l'Union nationale en 1936 parce que « les Libéraux avaient vendu la province aux Anglais », alors que ceux-ci votèrent pour Duplessis parce que Taschereau était trop doux avec les syndicats ouvriers.
Quoi qu'il en fût, de 1936 à 1939, Duplessis eut amplement le temps de démontrer qu'il n'était ni nationaliste, ni réformiste, mais purement et simplement tory : il oublia les réformes promises au nom de l'Action libérale nationale ; il désillusionna Gouin, Chaloult et Hamel, ainsi que beaucoup de nationalistes, qui l'abandonnèrent. Et la population flairant la guerre, comprit qu'il eût été imprudent de réélire un tory : en 1939, l'électorat obtint du Parti libéral des engagements contre la conscription et la guerre à outrance et porta Godbout au pouvoir. Celui-ci entreprit dans les domaines social et éducatif des réformes qui furent approuvées aux urnes de 1944 par quarante pour cent des électeurs (malgré l'opposition quasi unanime de ceux-ci aux Libéraux d'Ottawa, lors du plébiscite). Mais pour la majorité, il y avait une tâche plus urgente : la nation devait s'arc-bouter contre les nouveaux militaristes d'Ottawa, ce dont Godbout s'avéra incapable, et ce pourquoi trente-huit pour cent des votes furent donnés à Duplessis (qui prit le pouvoir), et quinze pour cent au Bloc populaire.
Pendant quatre années, Duplessis, se souvenant de la défaite de 1939 et de la victoire de 1944, joua si habilement la carte nationaliste qu'il empêcha à peu près la question sociale de se poser. De sorte qu'à l'élection de 1948, Le Devoir lui apporta une bonne partie des votes du défunt Bloc populaire, et l'Union nationale obtint cinquante et un pour cent des votes ; en pourcentages du total, les Libéraux reculèrent de quatre, les CCF de deux, et l'Union des électeurs avança de huit.
Le vin de la victoire monta à la tête de l'honorable Duplessis, et le tory revint au galop. Avec quatre-vingt-deux députés sur quatre-vingt-douze, il se crut assez fort pour aliéner une partie (probablement minime) des nationalistes, en appuyant les Conservateurs de Drew en 1949, et en révélant le caractère purement verbal de son autonomisme. D'autre part, une politique férocement anti-ouvrière obligea tout vote progressiste de se porter ailleurs. En 1952, l'Union nationale perdit quarante-six mille voix et quatorze sièges ; les Libéraux gagnèrent cent dix mille voix et quinze sièges ; les partis CCF et Ouvrier-Progressiste marquèrent de légères avances (dix mille voix). L'Union des électeurs ne présenta aucun candidat malgré ses cent quarante mille votes de 1948 : certains sondages permettent de croire que ces votes furent donnés aux Libéraux dans les centres urbains ; le reste dut se partager entre Duplessis et l'abstention.
Pendant ce temps, que s'était-il passé aux élections fédérales ? En 1935, la province en force avait voté pour les Libéraux, traditionnellement le parti de la décentralisation et des droits québécois : là encore, nous ne répondions pas à la crise par des idées sociales mais par un retour au nationalisme atavique. En 1940 la province vota pour le parti qui avait juré « jamais de conscription » alors qu'en 1945, elle vota contre le parti qui n'avait cessé de réclamer « encore plus de conscription ».
Aujourd'hui, il semble bien que la révolution dans notre pensée politique, qui avait commencé avec la crise, a repris son secret développement. Aux élections provinciales de 1939, 1944 et 1948, et fédérales de 1940 et 1945, de vieux réflexes avaient joué : en réponse à une politique de guerre instinctivement considérée comme dangereuse pour notre nationalité, nous avions rassemblé nos énergies et partagé nos loyautés pour assurer encore une fois la survivance de la communauté dans la communauté. Mais depuis 1948, ce bien particulier n'est plus en assez grand péril pour commander à nos fibres nationalistes. Un certain nombre de gens, redevenus soucieux de leurs biens particuliers, sont retournés à la politique vétuste du bleu et du rouge. Mais un nombre croissant de citoyens semblent se rendre compte que nous ne pouvons plus nous moquer impunément du jeu démocratique.
Depuis que, en théorie comme en fait, l'État n'est plus un simple gendarme chargé de maintenir l'ordre dans une société en évolution libre, depuis que l'État intervient avec une fréquence accrue pour contrôler les activités des citoyens et suppléer à leurs déficiences, le problème crucial se pose de savoir au profit de qui l'intervention doit s'opérer : pour quel groupe ethnique, pour quelle classe sociale ?
Certes, quelques hommes politiques prétendent enrayer cet interventionnisme ; ainsi le 12 novembre dernier, le gouvernement de l'Union nationale, dans le discours du Trône, condamnait ce qu'il appelait « le paternalisme d'État,... un sérieux obstacle à la prospérité durable de notre province ». Mais, fait notoire, dans l'exposé du programme législatif, le même discours consacrait cinq paragraphes à la classe agricole, tandis qu'il mentionnait la classe ouvrière seulement pour lui rappeler que « l'accomplissement du devoir est toujours la meilleure garantie de l'exercice d'un droit ». C'est cette sorte de « non-intervention » qui détourne de Duplessis le vote ouvrier. Et dans un ordre d'idées connexe, les nationalistes éclairés se détournent de lui à cause de son attitude négative, c'est-à-dire purement défensive vis-à-vis d'Ottawa ; c'est ainsi que Le Devoir s'est prononcé contre l'Union nationale à l'élection de 1952. (Voir les articles de Laurendeau - les 11 et 17 juillet - sur la « brèche dans le domaine de l'éducation », et sur la qualité d'un autonomisme qui avait rapproché de M. Duplessis le journal libéral The Star.)
Bref, à l'époque du laisser-faire, notre antidémocratisme, voire notre immoralisme ne nous causait pas de dommages trop apparents, car à l'heure du danger, nous élisions toujours à Ottawa ou à Québec le gouvernement qui assurerait le mieux notre survivance ; et entre-temps nous nous passions l'assiette au beurre, allègrement et en famille. Ainsi les quarante années de règne des Libéraux provinciaux s'expliquent moins par leur prétendu autonomisme, que par leur corruption avérée et notre esprit de parti.
Mais aujourd'hui il est essentiel de choisir un gouvernement, eu égard à l'action positive qu'il exercera : autrement dit, les questions idéologiques acquièrent une importance qu'elles n'ont jamais eue chez nous, et il devient impérieux d'élire des candidats capables de défendre ces idéologies. Nous ne pouvons plus nous désintéresser du bien commun, pour la bonne raison que les gouvernements d'aujourd'hui, par les impôts, les prestations sociales et les subsides, redistribuent sans cesse le produit national entre les divers groupes de la population, et que les groupes qui restent sous leur tente ou qui se font mal représenter risquent de n'être pas servis.
Il faudrait désormais choisir des députés compétents et actifs, et des gouvernements qui se conforment intègrement à la volonté générale. Pour cela, nous devons assainir le processus par lequel nous les élisons.
-III-
Afin d'indiquer le sens dans lequel cet assainissement doit s'opérer avec le plus d'urgence, je veux maintenant souligner certaines caractéristiques de notre électoralisme, qui se dégagent de l'enquête conduite par Cité libre.
L'article de Laporte nous a démontré l'importance de l'argent dans les élections, et les recherches de Pelletier nous permettent de conclure qu'il s'est dépensé plus de quatre millions de dollars pour l'élection de 1952. Or MacGregor Dawson (The Government of Canada, p. 571) avait estimé - en 1947, il est vrai - qu'il n'en fallait pas tant pour une élection fédérale où il y a pourtant deux fois et demie plus de députés. Gérard Filion (Le Devoir, 15 juillet) estimait qu'une élection au Québec coûte quatre à cinq fois plus cher qu'en Ontario. Et Clayton Knowles (New-York Times, 12 octobre 1952) écrit qu'aux États-Unis, jusqu'à l'élection alors en cours, c'est-à-dire avant la télévision, le montant maximum, de dépenses électorales avait été atteint en 1940, avec le chiffre de quarante millions de dollars soit dix fois plus qu'au Québec, mais avec une population quarante fois plus nombreuse, un territoire six fois plus considérable et au moins six fois plus de candidats à élire : un président, un vice-président, trente-cinq sénateurs, quatre cent trente cinq membres et d'innombrables fonctionnaires locaux. (Il semble aussi que le chiffre de Knowles comprend les dépenses à partir de la préparation des conventions de parti, alors que les estimés de Pelletier ne mentionnent pas les sommes dépensées, par exemple, à la convention libérale, par ceux qui se cherchaient un chef à leur guise.)
Tant qu'il faudra autant d'argent pour élire un gouvernement au Québec, la population sera sûre de n'avoir qu'une politique dictée par la haute finance : c'est-à-dire que l'État continuera d'être un outil de la dictature économique. « La reconnaissance a toujours été un facteur important dans la façon de traiter avec des gouvernements démocratiques », déclarait candidement le président de la Beauharnois, après qu'une enquête eût révélé que la compagnie, désireuse d'exploiter des pouvoir hydrauliques, avait versé trois quarts de million à diverses caisses électorales (Hansard 1931, 4260). Il n'est peut-être pas hors de propos de noter ici que les Canadiens anglais peuvent difficilement nier toute responsabilité, pour ce qui est de la débauche des moeurs électorales québécoises. Car dans une province où ils n'avaient pas le nombre mais où ils avaient l'argent, nos concitoyens ont souvent cédé à la tentation d'agir démesurément avec les moyens qu'ils avaient.
On peut m'objecter que pareille emprise de la finance sur notre système démocratique n'a rien de fatal, puisqu'en 1935 par exemple, l'Action libérale nationale a pu prendre vingt-six comtés, avec une caisse qui avait seulement les moyens de donner à chaque candidat deux cent dollars de dépôt et cinq cent dollars de dépenses ; et que le Bloc populaire en 1944 a pris quinze pour cent du vote avec une caisse et une organisation improvisées (mais en dépensant néanmoins bien au-delà de dix mille dollars par comté, en moyenne). Je reconnais qu'il ne faut pas minimiser (fort heureusement) la puissance d'indignation d'une population qui veut se débarrasser de faquins ; mais il faut remarquer que dans ces deux exemples, le partage s'est fait le long d'une ligne nationaliste plutôt qu'économique, de sorte que la finance pouvait bien espérer trouver son compte des deux côtés. Fait bien plus significatif : le CCF, qui représente une menace réelle pour la dictature économique, doit effectivement faire ses élections sans argent, comme le rappelle M. Forest avec le résultat qu'il n'a jamais recueilli trois pour cent des votes dans le Québec.
Aussi bien, les démocraties estiment de plus en plus qu'elles doivent se protéger en interdisant aux partis politiques de contracter des dettes de « reconnaissance ». Ainsi en Angleterre, la loi fixe une limite aux dépenses électorales ; aux États-Unis de même, tant à l'échelle nationale que dans la plupart des États. À ce propos, les Canadiens qui sont souvent tentés de mépriser « l'immaturité politique » des Américains feraient bien de songer que nous sommes bien en retard sur eux : qu'on se rappelle le mouvement d'opinion qui, lors des récentes élections présidentielles, obligea les candidats importants à révéler l'état de leurs finances, et amena le gouverneur Stevenson à poser ce principe : "Every candidate for high political office should disclose his personal financial condition."
Certes, il existe depuis longtemps au Canada une loi fédérale qui, sans limiter le montant des dépenses, en exige la publication par chaque candidat. Mais les fraudes à cette loi furent si criantes, et le scandale de la Beauharnois fut si retentissant, qu'un comité spécial de la Chambre des communes fut formé pour étudier la question. Dans un rapport daté de 1939, ce comité recommanda qu'une loi soit votée dont le but serait, d'une part d'empêcher les fraudes à la loi sur la publicité des dépenses électorales et d'autre part de rendre publique la provenance des fonds électoraux (en dévoilant par exemple le nom et l'adresse de tout donateur d'une somme de cinq cent dollars ou plus). Mais il est important d'ajouter que plus de vingt ans après le scandale en question, ce projet n'est pas encore devenu loi, pour l'excellente raison que les deux grands partis sont également bien servis par la haute finance qu'ils servent en retour.
Pour ce qui est des élections provinciales, évidemment nous sommes encore bien moins avancés. Nous n'avons même pas jugé bon de réduire les frais des candidats en leur fournissant (comme au fédéral) des copies de la liste électorale. Bien pis, notre esprit démocratique est si débile que nous souffrons dans notre loi (comme l'a démontré Lussier) les pires incongruités dans des domaines qui n'ont pourtant rien à voir avec la finance en tant que telle.
De plus, cette loi partiellement impotente n'est souvent même pas appliquée dans ce qu'elle a de bon : Marcel Rioux et Pierre Laporte nous ont illustré des pratiques électorales malhonnêtes. M. Gagnon a souligné la primauté du matériel. M. Gélinas nous a donné certains exemples du terrorisme policier exercé contre un parti qui est présumé jouir de protections constitutionnelles puisqu'il n'est pas hors la loi. L'organisateur du Parti libéral, Jean-Marie Nadeau, avant d'énumérer une longue série de manoeuvres frauduleuses de l'Union nationale, a dit : « Le juge Archambault avait déclaré quelques heures plus tôt qu'aucun mandat (d'arrestation) ne serait émis avant la date des élections... La loi électorale... est sous la seule juridiction du juge Archambault qui y fut nommé par... l'honorable Maurice Duplessis... C'est une injustice. Cela signifie en d'autres termes que la loi électorale qui régit les procédures des élections ne pourra pas être appliquée intégralement avant que celles-ci ne soient terminées. » (La Patrie, 13 juillet). En retour, M. Duplessis accusa laconiquement ses adversaires d'avoir fait une « lutte très malpropre » (La Presse, 17 juillet), tandis que M. Crankshaw, lors d'une convention du Parti conservateur, dénonçait les « télégraphes » et autres manoeuvres frauduleuses de la machine libérale, ajoutant que « les chefs libéraux qui encouragent (ces méthodes) privent graduellement mais inexorablement les électeurs de leur droit de voter dans des élections libres ». (The Gazette, 17 novembre)
Ainsi donc encore une fois, tous les partis tombaient d'accord pour déplorer la dépravation de nos moeurs. Mais en plus, quelques âmes idéalistes demandaient que les prévaricateurs fussent « punis avec toute la rigueur de la loi afin de décourager la récidive, de proclamer le respect de notre population pour la moralité publique et de dissocier les autorités de ces moeurs de gangsters » (Feu M. Letellier de Saint-Just dans La Patrie du 17 juillet). Les vrais politiciens, par contre, n'ont pas ces conceptions vindicatives de l'éthique électorale ; avec un noble désintéressement, ils ne demandent qu'à oublier le passé. Ainsi le premier ministre, le soir de son triomphe, « demande donc, comme faveur personnelle que l'on ne fasse rien pour humilier inutilement les adversaires » (Le Devoir, 17 juillet) ; cette belle parole alla droit au coeur de son adversaire personnel : Son Honneur le maire J.-A. Mongrain qui, lors des élections à Trois-Rivières, avait été la cible de revolvers et qui avait jugé prudent de faire assermenter cent policiers spéciaux pour faire contrepoids à la police provinciale, et qui se présenta un mois plus tard sur la même tribune que l'honorable Duplessis à qui il rendit hommage en ces termes : « L'autorité vient de Dieu et celui qui a été choisi par l'électorat tient son autorité du ciel. » (Le Devoir, 23 août)
Il faut donc se poser carrément la question : dans notre pays, le ciel devra-t-il encore longtemps déléguer son autorité par le truchement de boxeurs, de maîtres chanteurs et de gangsters professionnels, et au moyen d'armes à feu et à blanc, de vols, de mensonges, et d'intimidation ? En somme, pouvons-nous espérer sortir éventuellement de ce que je nommais notre immoralisme profond ?
- IV -
Ma réponse, et mes conclusions, découleront des interprétations que j'ai données à notre histoire politique. Il s'agira principalement de déterminer quelles forces sociales ont un intérêt pressant à démocratiser nos conceptions politiques et à assainir nos institutions démocratiques.
Il faut commencer par éliminer les puissances d'argent qui ont un intérêt acquis à la conservation du statu quo. L'utilité pour elles de parlements où l'opposition n'est, comme le dit M. Gagnon, que « la tête de rechange d'un parti bicéphale », ressort clairement du fait typique que les banques sont les plus gros souscripteurs aux deux caisses, conservatrice et libérale. Puisque de telles institutions financières n'attendent rien du patronage d'aucun parti, il est évident qu'elles considèrent leurs versements comme une prime d'assurance contre le radicalisme sous toutes ses formes.
Par une rencontre bizarre, les éléments ruraux de notre population ont à peu près les mêmes intérêts électoraux que la finance, bien que leur préférence pour le statu quo ait d'autres motifs. D'une part, ils envisagent le radicalisme surtout sous l'aspect de prestations sociales (assurances contre chômage et accidents du travail, plans d'habitation, cliniques, etc.) qui profitent surtout aux centres industriels ; d'aucuns vont même jusqu'à craindre pour la propriété privée de leur terre et de leur vache. D'autre part, la population rurale ayant une députation hors de proportion avec sa force numérique, n'a aucun intérêt immédiat (le directeur de La Terre de chez nous, M. Beaudin, a vu fort intelligemment qu'il y aurait un intérêt lointain à corriger une situation qui pourrait éventuellement « inspirer des luttes acrimonieuses ») à modifier un système dont elle croit rester l'enfant gâtée, quels que soient les aléas des élections. Coeteris paribus, elle votera toujours pour le parti au pouvoir, Duplessis aujourd'hui, comme Taschereau jadis, jusqu'à ce que de nouveau une crise fasse d'elle la première victime d'une chute des prix. Entre-temps, à cause de cette conception du bien particulier, il est parfaitement inutile de chercher à l'émouvoir en dénonçant des scandales d'administration, puisque ce n'est pas elle en définitive qui paye les (im)pôts cassés.
Aux financiers et aux classes rurales s'ajoutent deux autres forces de conservation : exception faite d'une minorité progressiste, les gens d'Église et les nationalistes redoutent d'instinct les réformes qui pourraient causer des fissures dans le monolithe québécois. Parce que la paysannerie est la classe la moins perméable à de telles influences, ils persistent à croire qu'il est « bon » de vivre près de la terre. Et ce « postulat » moral ne les engage pas à lutter très efficacement pour modifier des lois et des moeurs qui avantagent leur classe préférée.
Pour les fins de cette analyse, je ne compte pas la bourgeoisie comme une force politique distincte : qu'elle suive les financiers, ou qu'elle conduise les nationalistes, ou qu'elle fasse un peu des deux comme à la Chambre de commerce de Montréal, elle ne représente pas une force de changement idéologique ni, partant, d'assainissement électoral.
Le changement, s'il doit venir, viendra de la classe ouvrière (peut-être aidée par des « collets blancs » de condition quasi prolétarienne). Issue de la révolution industrielle qui lui donna la puissance du nombre, et ressortissante d'une démocratie où le nombre devrait faire loi, cette classe compte pourtant pour peu dans l'ensemble de forces qui, en s'équilibrant par le jeu électoral, détermine l'ordre politique. Longtemps on lui a fait croire qu'elle n'existait pas en tant que classe (le mot sentait le marxisme) ayant des intérêts sociaux particuliers, et elle se contenta béatement de jouer à « bleu et rouge ». Elle fut momentanément secouée par la crise économique ; mais devant les phénomènes de guerre, par atavisme elle canalisa ses énergies dans le nationalisme. Cependant, par une participation accrue au syndicalisme national et international, les ouvriers s'étaient découvert des fidélités qui transcendaient la communauté canadienne-française. Avec la retentissante grève d'Asbestos, ils furent rendus à la réalité de 1949 : ils comprirent que leur lutte désormais ne se livrait pas contre les Anglais, les protestants ou les juifs, mais contre les financiers, ou mieux contre une certaine conception du capitalisme. En même temps, ils apprirent expérimentalement un double principe politique : que l'État moderne exerce une action positive, pleine de conséquences pécuniaires pour des secteurs donnés de la population ; et que devant un conflit d'intérêts, un gouvernement gouverne toujours pour le profit de ces secteurs qui le reporteront au pouvoir.
Dans son ensemble, notre classe ouvrière n'a pas encore tiré les conclusions qui découlent de ce double principe. Certes elle commence à voir assez bien qu'il est d'importance vitale pour elle de devenir une force politique ; mais elle s'imagine encore pouvoir le faire dans le cadre des vieux partis soumis à la finance. Cette erreur de jugement se comprend chez une masse où le syndicalisme commence seulement à prendre forme ; et elle se comprend d'autant mieux que ses propres chefs ont longtemps eu la naïveté de croire que les unions ouvrières devaient s'abstenir de toute activité politique partisane, et devaient user de leur droit de vote dans les cadres politiques existants, comme le reste des citoyens.
Mais depuis peu, des chefs plus astucieux ont détecté le paralogisme qu'il y avait à mettre la nouvelle classe ouvrière sur un pied d'égalité politique avec le « reste des citoyens » : ils comprirent que la carte électorale est ainsi divisée, la loi ainsi appliquée, les fonds ainsi obtenus, qu'il n'y a de place pour les nouveaux venus dans l'arène politique que s'ils épousent les intérêts anciens. Une éducation nouvelle en découlera inévitablement : voyez déjà la judicieuse étude d'André Roy dans le rapport du bureau confédéral au Congrès de la CTCC, en septembre 1952. Cela, ajouté au fait que la classe ouvrière prend graduellement conscience d'un bien commun débordant les frontières du Québec ; au fait qu'elle s'habitue par le syndicalisme au maniement des instruments démocratiques (assemblées, élections, délégations de pouvoir) ; et au fait que sa puissance numérique va toujours grandissant, portera inévitablement cette classe à exiger que le suffrage universel devienne une réalité plutôt qu'un simulacre.
Bref, puisque sous le système actuel la « volonté générale »de la nation est déterminée sans faire une juste part à la volonté ouvrière, les travailleurs constituent chez nous une force puissante d'assainissement des lois et des moeurs démocratiques.
-V-
À partir de ces conclusions, il me reste à faire quelques observations sur la conséquence pratique du jeu de force que j'ai tenté d'analyser.
A - À l'élection de juillet, l'Union nationale remporta un victoire presque exclusivement rurale : des soixante-sept comtés ruraux ou mixtes, elle en gagna cinquante-huit, et des vingt-quatre comtés exclusivement urbains, elle en décrocha seulement dix. Il faut noter néanmoins que le parti recueillit cinquante virgule huit pour cent du scrutin total, contre cinquante et un pour cent en 1948 : conséquemment, si assez de gens lâchèrent le parti pour lui faire perdre quatorze sièges (dont seulement deux exclusivement ruraux sur quarante-quatre), par contre un nombre assez fort de nouveaux voteurs se rallièrent au parti, de façon à conserver presque intact son pourcentage du vote total. Autrement dit, si l'Union nationale a perdu beaucoup de votes ouvriers (dans les centre urbains), elle a dû aussi attirer beaucoup d'électeurs nouveaux des autres classes. Il semble donc que la politique anti-ouvrière de l'honorable Duplessis tend de plus en plus à donner un caractère idéologique à la politique québécoise. Jusqu'à présent, l'Union nationale gardait un certain vernis réformateur dont elle s'était couverte en 1936 (voir sur ce point l'article de Marcel Rioux qui remarque le phénomène dans un centre rural) ; mais désormais il sera clair qu'elle fait partie de ce passé dont la classe ouvrière en particulier veut se libérer, et que d'autres classes aimeraient bien conserver.
En ce sens, M. Paul Bouchard est très clairvoyant d'insister sur les arguments nationalistes, car idéologiquement les Conservateurs (qu'il évalue à trente-cinq pour cent des électeurs) sont irrévocablement acquis à l'Union nationale, parti de la conservation : l'important désormais est de ne pas perdre la population flottante qui par définition ne croit pas encore à l'acuité du conflit social, et qui conséquemment est encore influençable, soit par des arguments nationalistes, soit par des arguments individuels. Comme il reste toujours des biens particuliers à satisfaire ; et que d'autre part les nationalistes qui entourent M. Duplessis peuvent lui faire prendre une attitude un peu plus positive à l'égard d'Ottawa par exemple, sans pour autant nuire à la finance, il est fort probable que l'Union nationale gagnera les prochaines élections provinciales. Mais alors, il semble bien que la cristallisation des forces de droite et de gauche sera en passe de devenir si nette que la nationalisme de M. Duplessis ou de M. Rivard constituera un argument électoral moins décisif que leur conservatisme.
B - Les Libéraux ont avancé de huit à vingt-trois sièges et de trente-six virgule cinq à quarante-cinq pour cent du vote total. Quatorze de leurs députés représentent des comtés urbains, et cinq autres ont été élus grâce à l'appui des centres industriels dans les comtés mixtes. Ces gains semblent donner raison aux stratèges du parti qui avaient élaboré un programme de réforme sociale de nature à capter le vote ouvrier. Mais inversement, leur libéralisme un tantinet radical réussit à ébranler la fidélité de ceux qu'effraient le mot « gauche » : les grosses légumes fédérales, par exemple ; et la finance, qui coupa temporairement les vivres au parti, ne cessant de le bouder qu'à l'approche du scrutin, par crainte d'être privée des fruits d'une victoire possible. Ce parti schizophrène groupait donc d'une part ceux qui voulaient continuer de jouer aux rouges, pour leur avantage très particulier ; et d'autre part ceux qui se nommaient libéraux pour des motifs idéologiques. Les premiers avaient placé M. Lapalme à la tête du parti plutôt que M. Nadeau, parce qu'ils croyaient pouvoir le contrôler ; mais M. Lapalme avait suffisamment échappé à ce contrôle pour donner courage aux seconds.
M. J.-L. Gagnon est évidemment du second groupe, et c'est pourquoi il souligne l'importance d'une idéologie sociale, d'une réforme électorale, et d'un mouvement bâti sur des militants. Mais pour son malheur, ses chefs parlementaires sont MM. Marler et Cournoyer, qui s'appuient sur des militants de la trempe de MM. Brais, Beaubien et Simard. Il ne me semble pas probable qu'un tel parti puisse établir des positions suffisamment sociales pour rallier les principales forces progressistes de la province, et je ne vois aucune raison d'escompter une victoire libérale aux prochaines élections provinciales. Mais selon que le groupe idéologique ou que le groupe traditionnel garde le contrôle de la machine après la prochaine défaite ; autrement dit, selon que les Libéraux écoutent ou non l'avertissement de Briand : « Il faut tomber à gauche », le parti pourra espérer devenir l'embryon d'un véritable mouvement social ; ou il disparaîtra éventuellement, écrasé entre l'Union nationale conservatrice et une gauche qui se formera sans lui.
C - Le CCF jouit d'avantages purement théoriques. L'exemple de la Saskatchewan a prouvé que ce parti social-démocrate n'oppose pas les classes ouvrière et agricole ; que son autonomisme tient à une mise en valeur des ressources naturelles pour le profit de la province ; et que le contrôle socialiste n'éloigne pas les investissements canadiens et étrangers. Cela pourtant n'émeut pas l'électeur québécois car à son origine, le parti avait dû se former sans les Canadiens français, qui s'étaient imaginé que des raisons religieuses les en excluaient ; et du reste, à cette époque, ils cherchaient encore les remèdes sociaux dans les formules nationalistes. En conséquence, le CCF, aujourd'hui, a « l'air anglais ». Madame Casgrain a beau travailler courageusement à lui faire perdre cet air, elle ne peut que lentement déraciner des préjugés antiques, en attendant l'épanouissement au Québec d'une conscience sociale.
Aussi bien, M. Forest est-il sage de prendre le ton patient pour parler un langage de raison. Son parti semble actuellement le seul en mesure de donner sur le plan social des garanties acceptables à la force ouvrière, mais celle-ci a refusé de négocier. Sans doute trop de réflexes religieux et ethniques jouent-ils encore contre le CCF pour qu'il puisse être reçu par la masse ouvrière. Par contre il ne faut jamais sous-estimer les instincts lucides qui à la longue guident la classe ouvrière dans le choix de ses moyens d'action. Et dans la présente perspective, s'il est vrai que les ouvriers n'étaient pas prêts à voter CCF, ni même à présenter des candidats indépendants, il me semble que la partie du mouvement ouvrier qui appuya des candidatures libérales aux dernières élections, commit une erreur. Les vieux partis absorbent volontiers du sang nouveau ; mais aucun ne se métamorphosera jamais en parti social (à supposer même qu'il le veuille), à moins que le poids de la caisse et des anciennes fidélités, à droite, ne soit contrebalancé par la présence sur le flanc gauche d'une force démocratique radicale et intransigeante. Pour les unions ouvrières, la dernière campagne électorale aurait pu être l'occasion d'une campagne d'éducation intense, à la suite le laquelle les ouvriers auraient forcé tous les partis politiques à démasquer leur jeu. Désormais, les choix seraient plus évidents, et la prise de conscience politique n'aurait pas été retardée de quelques années.
D - Le Parti ouvrier-progressiste est le facteur mystérieux de la politique québécoise. C'est un parti sans âge et sans patrie qui guette astucieusement les événements, et tire sa force des moindres erreurs de ses adversaires. Aujourd'hui, il est numériquement insignifiant, comme cela s'explique d'un parti auquel s'opposent l'Église et la nation. Mais si la classe ouvrière échoue dans sa mission d'assainissement du processus électoral ; si en conséquence elle ne réussit pas à exprimer sa force idéologique par des moyens démocratiques (soit que ses dirigeants errent gravement, soit qu'ils se butent contre un fascisme naissant) : alors il pourra suffire d'une crise profonde pour que des masses opprimées acceptent le secours du seul parti qui leur promet la dictature du prolétariat, et dont l'efficacité n'attend pas nécessairement la constitutionnalité des moyens.
Je ne vois pas que le front populaire dont parle M. Gélinas puisse se former autrement. C'est pourquoi je tiens pour particulièrement malhabiles ces gens qui cherchent à combattre le communisme en fomentant contre lui une peur et une haine hystériques. L'emploi de ces techniques affaiblit le sens démocratique, et empêche les citoyens de considérer la recherche de la vérité politique principalement comme une démarche de l'esprit. Cela constitue chez nous le comble de l'illogisme, puisque notre peuple a toutes sortes d'excellentes raisons, spirituelles, politiques et économiques, pour rejeter le communisme, et puisque les seuls mobiles qu'il pourrait trouver pour céder à pareille doctrine dépendraient de la création chez nous d'un climat de répression et de violence.
E - L'Union des électeurs vint à exister parce qu'elle comblait admirablement une lacune. Comme je l'ai dit plus haut, les Canadiens français se passionnent facilement pour les théories politiques. Après que la crise les eût invités à réfléchir sur les structures de l'État, il arriva que les théories de gauche furent honnies par le clergé québécois, alors que l'histoire rendit plus ou moins impotentes les théories de droite. Le créditisme fut alors le refuge de beaucoup de théoriciens sans feu ni lieu, et coupés de la réalité. J'ai connu de la sorte un professeur de philosophie qui se disait créditiste pour des raisons qui l'auraient porté au socialisme, si cette doctrine n'avait pas été condamnée dans son cours.
M. Grenier suit donc parfaitement bien ses lignes de force historiques quand il place le créditisme au-dessus des partis. Et il faut admirer le zèle infatigable avec lequel les créditistes enseignent leur doctrine ; car il est bon pour la démocratie que les citoyens soient mis en demeure de penser. Mais j'ai déjà expliqué qu'à mon avis, les réformes de structure ne pourront réussir qu'appuyées sur des forces sociales nouvelles. Et comme le créditisme ne constituera jamais un véhicule historique idoine au mouvement ouvrier, cette doctrine ne pourra subsister qu'en s'altérant de plus en plus au profit des forces politiques conservatrices, comme du reste elle le fait déjà en Alberta.
- VI -
Je n'aime pas plus que quiconque les catégories, et je reconnais les limites de raisonnements bâtis sur des généralisations comme « la finance », « la paysannerie », etc.
Je suis donc le premier à dire « tant mieux » si l'on m'apprend, par exemple, qu'une part grandissante du « clergé » et des « nationalistes » reconnaît que les « ouvriers » aussi font partie de l'Église et de la nation. Et je serais le premier à me réjouir si mes réflexions sur notre avenir politique s'avéraient mal fondées par suite de la fusion de nos classes sociales en une grande famille fraternelle et unie. Mais ni la sociologie, ni l'histoire contemporaine ne nous donnent raison d'espérer qu'une société puisse se réformer dans une pareille abnégation. Et tant que nous ne serons pas chrétiens au point d'aimer tous les hommes comme nos frères, nous aurons dans la nation des groupes compartimentés suivant leurs intérêts, et des partis politiques pour les représenter.
C'est pourquoi je conclus que jusqu'à nouvel ordre, il faut laisser les forces sociales s'exprimer rationnellement et calmement au sein d'une cité libre. L'expérience de certaines grèves nous a déjà prouvé que l'oppression engendre la violence ; et c'est précisément pour l'éviter, sous toutes ses formes, que nous devons au plus tôt corriger notre immoralisme profond.
* [La version française de ce livre, traduit par Jean-Charles Falardeau, RENCONTRE DE DEUX MONDES. La crise d’industrialisation du Canada français, est disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.]
|

