|
IV. Sur le nationalisme
“La nouvelle trahison des clercs.”
par Pierre Elliot Trudeau
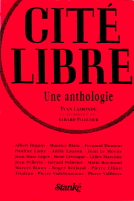
Pierre Elliott Trudeau, « La nouvelle trahison des clercs », Cité libre, 46 (avril 1962) : 3-16 ; publié dans Pierre Elliott Trudeau. Le fédéralisme et la société canadienne-française. Montréal, HMH, 1967, p. 159-190.
Un texte publié dans l’ouvrage d’Yvan Lamonde, avec la collaboration de Gérard Pelletier, CITÉ LIBRE. Une anthologie, pp. 141-167. Montréal : Les Éditions internationales Alain Stanké, 1991, 415 pp. [Autorisation formelle accordée par Yvan Lamonde et son éditeur, le 2 septembre 2008 de diffuser ce livre dans Les Classiques des sciences sociales.]
- Les hommes dont la fonction est de défendre les valeurs éternelles et désintéressées, comme la justice et la raison, et que j'appelle les clercs, ont trahi cette fonction au profit d'intérêts pratiques... L'objet au profit duquel les clercs consommaient alors leur trahison avait été surtout la nation.
- (Julien Benda, La trahison des clercs)
1 - L'option géographique
Ce n'est pas l'idée de nation qui est rétrograde, c'est l'idée que la nation doive nécessairement être souveraine.
À quoi les Indépendantistes québécois rétorquent qu'une idée n'est pas rétrograde qui a permis à l'Inde, à Cuba et à une multitude d'États africains d'obtenir leur indépendance.
Ce raisonnement postule l'équation : indépendance égale progrès. L'indépendance, affirme-t-on, est bonne en elle-même. Et pour confondre l'ennemi, on retourne contre lui l'aphorisme : Good government is no substitute for self-government.
Le recours fréquent à ce brocart (qu'on cite invariablement de travers, - mais tout le monde doit-il savoir l'anglais ?) indique à quel point nos Séparatistes ont l'esprit confus. Seff-government ne veut pas dire national self-determination. (Il ne s'agit pas ici de briller en linguistique : il s'agit de savoir de quoi on parle quand on réclame l'indépendance du Québec.) Distinguons donc les deux notions.
Que le self-government soit une bonne chose, ou plus précisément, que la tendance vers un système de gouvernement dit « responsable » soit généralement une tendance vers le progrès, je veux le concéder dès le début de cet article. J'ai trop dénoncé l'autocratisme de l'Union nationale à Québec, et le paternalisme des Libéraux et des Socialistes à Ottawa, pour être suspect sur ce point. J'ai toujours soutenu que la population du Québec ne progresserait jamais vers la maturité politique et la maîtrise de ses destinées, tant qu'elle ne ferait pas elle-même l'apprentissage d'un gouvernement véritablement responsable, rejetant en même temps les idéologies qui prêchaient la soumission aveugle à « l'autorité qui vient de Dieu », et celles qui s'en remettaient avec confiance à Ottawa pour la solution de nos problèmes difficiles.
Mais je réclamais là « la liberté dans la cité », remarque G. C. [1]. Ce que l'on exige aujourd'hui, c'est « la liberté de la cité », c'est l'indépendance absolue de la nation canadienne-française, la souveraineté pleine et entière de la Laurentie. Bref, le national sef-determination.
« Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, écrit monsieur Marcel Chaput, au-delà de trente pays, anciennes colonies, se sont libérés de la tutelle étrangère et ont accédé à la souveraineté nationale et internationale. Au cours de 1960 seulement, dix-sept colonies d'Afrique, dont quatorze de langue française, ont de même obtenu leur indépendance. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est le peuple canadien-français qui commence de se lever et qui, lui aussi, vient réclamer sa place au sein des nations libres [2]. »
Bien sûr, M. Chaput s'empresse de reconnaître que le Canada français possède plus de droits que ces peuples n'en possédèrent jamais. Mais il n'a pas l'indépendance totale et « son destin repose, dans une très large mesure, entre les mains d'une nation qui lui est étrangère ».
L'équivoque reste totale.
Car, la quasi-totalité de ces « trente pays, anciennes colonies » sont des États, comme le Canada est un État ; ils ont accédé à la pleine souveraineté, comme le Canada l'avait fait en 1931. Ces pays ne constituent nullement des nations au sens où les Canadiens français seraient une nation. Par conséquent, l'opération qui consiste à placer l'indépendance du Québec dans ce courant historique et à y trouver des paternités spirituelles est un pur sophisme.
L'État de l'Inde est une république souveraine. Mais on y reconnaît officiellement quatre langues (ce qui n'inclut ni l'anglais, ni le chinois, ni le tibétain, ni les innombrables dialectes). Il y existe huit religions principales, dont plusieurs sont irréductiblement opposées les unes aux autres. Où est la nation ? Et quelle indépendance veut-on ici citer en exemple ?
L'État de Ceylan compte trois groupes ethniques principaux et quatre religions. En Fédération malaise, il y a trois autres groupes ethniques. L'Union birmane oppose entre elles une demi-douzaine de nationalités. La République indonésienne inclut au moins douze groupes nationaux, et on y parle vingt-cinq langues principales. Le Viêt-nam, en plus des Tonkinois, des Annamites et des Cochinchinois, compte huit tribus importantes.
En Afrique, le caractère multi-ethnique des nouveaux États est encore plus frappant. Les frontières de ces pays souverains ne sont que le décalque des lignes tracées naguère par les colonialistes, au hasard des conquêtes, des explorations et des fantaisies administratives. En conséquence, les membres d'une même tribu, parlant une même langue et ayant les mêmes traditions, sont devenus citoyens d'États différents, et ces États souvent ne sont guère plus que des conglomérats de groupes distincts et rivaux. On voit un peu ce que ça donne dans le Congo ex-belge. Mais on retrouve à peu près la même complexité ethnique si on regarde le Ghana, le Soudan, le Nigéria, ou presque partout ailleurs. En Afrique occidentale française, par exemple, la population se composait de quelque dix tribus éparses ; la France trouva commode d'y découper huit territoires. L'histoire transforme ces territoires en États souverains. On y chercherait en vain des États-Nations, c'est-à-dire des États dont les frontières auraient obéi à des impératifs ethniques ou linguistiques [3].
Pour ce qui est de l'Algérie du GPRA, que nos Indépendantistes citent toujours en exemple, il n'est pas difficile de voir en quel sens elle veut être un État. En plus des habitants d'origine française, espagnole, italienne, juive, grecque et levantine, il faut distinguer dans ce pays les Berbères, les Kabyles, les Arabes, les Maures, les Nègres, les Touareg, les Mzabites [4], et plusieurs ratons laveurs. De l'opposition kabyle-arabe notamment, on n'a pas fini d'entendre parler.
Quant à Cuba, enfin, qui revient toujours dans les discussions séparatistes comme un exemple à suivre, c'est de toute évidence un pur coq-à-l'âne. Ce pays était souverain sous Batista et il est souverain sous Castro. Il était économiquement dépendant autrefois, il l'est encore maintenant. Le self-government n'y existait pas jadis, il n'y existe toujours pas aujourd'hui. Bon ; et qu'est-ce que ça prouve ? Que Castro n'est pas Batista ? Bien sûr ; mais l'Hydro-Québec sous René Lévesque n'est pas l'Hydro sous Daniel Johnson. Nous voilà bien avancés vers le séparatisme...
Il ressort de tout ceci qu'en posant l'indépendance comme une chose bonne en soi, une affaire de dignité pour tout « peuple normal », on embarque le monde dans une drôle de galère. On a prétendu que tout anticolonialiste sincère, qui veut l'indépendance pour l'Algérie, devrait aussi la vouloir pour le Québec. Ce raisonnement postule que le Québec est une dépendance politique, ce qui est bien mal connaître son histoire constitutionnelle ; mais quand bien même cela serait, pour être logique il faudrait plutôt dire que tout séparatiste québécois doit préconiser l'indépendance des Kabyles ou, pour donner un exemple plus frappant, l'indépendance des quelque vingt-cinq millions de Bangalis inclus dans l'État indien... Si les séparatistes, pour me confondre, répondent qu'ils la veulent cette indépendance du Bengale, je leur demanderai pourquoi s'arrêter en si bonne route : on parle, au Bengale, quatre-vingt-dix langues différentes ; et puis, il y a encore les Bengalis du Pakistan... Que voilà beaucoup de séparations en perspective !
Pour en finir avec l'aphorisme du début, je serai donc tenté de conclure que good government is a damned good substitute for national self-determination, si on entend invoquer par ce dernier vocable le droit des groupes ethniques ou linguistiques à se donner une souveraineté absolue. Il semble même assez urgent, pour la paix du monde et le bonheur des États nouveaux, que cette forme de good government qu'est le fédéralisme démocratique soit perfectionnée et répandue, en vue de résoudre un peu partout les problèmes du pluralisme ethnique. À cet effet, comme je l'indiquerai plus bas, le Canada pourrait être appelé à jouer un rôle de mentor, pourvu qu'il sache opter pour la grandeur... John Conway écrivait, à propos du vrai fédéralisme : "Ils successful adoption in Europe would go a long way towards ensuring the survival of tradionnal western civilization. It would be a pity, if in Canada, so young, so rich and vigourous and plagued with so few really serious problems, the attempt should fail." [5]
À propos de fédéralisme, il paraît bien établi que le président Wilson - le grand apôtre du « principe des nationalités » - n'entendait nullement favoriser les sécessions nationalistes, mais qu'il voulait plutôt affirmer le droit des nationalités à une certaine autonomie à l'intérieur des États [6].
De plus, il est erroné d'affirmer, comme le font souvent nos indépendantistes, que ce principe des nationalités est reconnu en droit international et sanctionné par les Nations Unies. Celles-ci, plutôt que de reprendre l'expression équivoque de Wilson, et de se trouver - comme après la première Grande Guerre, en face d'une nouvelle vague de plébiscites et de sécessions, ont préféré parler - à l'article premier de la Charte - du droit des peuples à s'autodéterminer. « Les peuples », c'est bien autre chose que « les groupements ethniques » [7].
2 - L'optique historique
S'il est difficile d'appuyer l'idée d'État-Nation sur l'évolution anticoloniale des dernières années, qu'en est-il de l'histoire en général [8] ?
Au seuil des temps, il y avait l'homme, et sans doute aussi - tenant à la nature même de l'homme - cette autre réalité qui s'appelle la famille. Puis, très tôt, apparut la tribu, sorte de communauté primitive, fondée sur des usages et un idiome communs.
Or l'histoire de la civilisation, c'est l'histoire de la subordination du « nationalisme » tribal à des appartenances plus larges. Sans doute, exista-t-il toujours des loyautés de clans et des attachements régionalistes. Mais la pensée se développa, les connaissances se répandirent, les inventions furent connues et l'humanité progressa, là où il y eut interpénétration des tribus et échange entre elles, sous l'influence de la division du travail et du commerce, sous le coup des grandes conquêtes (depuis l'Égypte et la Chine jusqu'au Saint-Empire romain), et sous la poussée des religions universalistes (depuis le bouddhisme jusqu'à l'islam, en passant par le christianisme).
Enfin, après plus de soixante-cinq siècles d'histoire, avec l'éclatement de l'ordre médiéval, la régression du latin comme langue de l'homme lettré, et la naissance de la mystique individualiste, la notion moderne de nation commença à se développer en Europe. Le remplacement de l'Église catholique par des Églises nationales, la montée des bourgeoisies, le mercantilisme protecteur des économies territoriales, les outrages commis contre certains groupes ethniques comme les Polonais, la Révolution jacobine, la ferveur de Mazzini, la domination des nations pauvres par les nations industrialisées comme l'Angleterre, ce furent autant de facteurs qui contribuèrent à donner naissance aux aspirations nationales, celles-ci devant conduire à la mise sur pied successive des États nationaux. Les pays d'Amérique latine se révoltèrent contre l'Espagne. L'Italie et l'Allemagne firent leurs guerres d'unification. Les Grecs et les Slaves se rebellèrent contre l'Empire ottoman, l'Irlande se souleva contre la Grande-Bretagne. Bref, toute l'Europe et une grande partie de l'Amérique prirent feu. L'ère des guerres nationales, commencées au temps de Napoléon, connut son apogée avec les deux guerres mondiales. Et nous entrâmes ainsi dans l'époque où les nations mettent leur fierté dans la possession des armes nucléaires, en attendant de se défendre par leur usage.
Quelque sept mille ans d'histoire en trois paragraphes, c'est évidemment un peu court. J'en dirai du reste un peu plus long ci-dessous. Mais c'est assez pour faire réfléchir dès maintenant à trois observations.
La première, c'est que la nation n'est pas une réalité « biologique », je veux dire une communauté qui découlerait de la nature même de l'homme. Sauf pour une petite fraction de son histoire, l'humanité s'est faite et la civilisation a progressé sans appartenance à la nation. Ceci, pour rassurer nos jeunes gens qui voient comme un événement apocalyptique le moindre accroc fait à la souveraineté de la nation.
La seconde, c'est que la petite parcelle de l'histoire qui est marquée par l'émergence des États-Nations, est aussi celle des guerres les plus dévastatrices, des atrocités les plus nombreuses et des haines collectives les plus dégradantes de toute l'épopée humaine. Jusqu'à la fin du XVIlle siècle, c'étaient généralement les souverains qui se faisaient la guerre, plutôt que les nations ; et pendant que leurs souverains guerroyaient, les populations civiles continuaient de se visiter, les marchands traversaient les frontières, les hommes de lettres et les philosophes allaient librement d'une cour à une autre, les chefs d'armée prenaient sous leur protection les savants des villes conquises. À cette époque, la guerre tuait des militaires, mais elle respectait les civilisations. Tandis que de nos jours, on a vu des nations mobilisées contre l'Allemagne refuser d'écouter du Beethoven, d'autres en rupture avec la Chine boycotter l'Opéra de Pékin, d'autres encore refuser des visas ou des passeports à des savants qui désiraient assister à quelque congrès scientifique ou humanitaire dans un pays à idéologie différente. Pasternak ne put même pas aller chercher son prix Nobel à Stockholm. Le concept de nation, qui donne si peu de priorité à la science et à la culture, ne peut pas placer plus haut que lui-même dans l'échelle de valeurs la vérité, la liberté et la vie même. C'est un concept qui pourrit tout : en temps de paix, les clercs se font propagandistes de la nation et la propagande se fait mensonge ; en temps de guerre, les démocraties glissent vers la dictature, et les dictatures nous entraînent dans l'univers concentrationnaire ; et en définitive, après les massacres d'Éthiopie, il y a eu ceux de Londres et de Hambourg, puis ceux d'Hiroshima et de Nagasaki, et peut-être ainsi de suite jusqu'au massacre final. Je sais bien que l'idée d'État-Nation n'est pas à elle seule cause de tous les maux issus de la guerre : la technologie moderne y est bien pour quelque chose ! Mais le point important, c'est que cette idée a été cause de ce que les guerres soient devenues de plus en plus totales depuis deux siècles : c'est donc cette idée que je combats ici. D'ailleurs, à chaque fois que l'État a pris pour son fondement une idée exclusive et intolérante (religion, nation, idéologie), cette idée a été le ressort même des guerres. Il a fallu, autrefois, que la religion cesse d'être le fondement de l'État, pour que se terminent les affreuses guerres de religion. Les guerres internationales ne prendront fin que dans des conditions analogues, la nation cessant d'être le fondement de l'État [9]. Quant aux guerres interétatiques, elles ne cesseront que si les États renoncent à cet attribut dont l'essence même les rend exclusifs et intolérants : la souveraineté. Or - pour revenir à mon propos - ce qui m'inquiète dans le fait que cinq millions de Canadiens d'origine française n'arrivent pas à partager leur souveraineté nationale avec sept millions de Canadiens d'origine britannique, à côté desquels ils vivent et dont ils savent qu'ils n'ont généralement pas de puces, c'est que ça me donne peu de motifs d'espérer que quelque mille millions d'Américains, de Soviétiques et de Chinois, qui ne se sont jamais vus et dont aucun n'est sûr que l'autre n'est pas galeux, consentent à abdiquer une parcelle de leur souveraineté sur les armes nucléaires.
La troisième observation que je tire du déroulement de l'histoire, c'est que l'idée même d'État-Nation est absurde. Affirmer que la nationalité doit détenir la plénitude des pouvoirs souverains, c'est poursuivre un but qui se détruit en se réalisant. Car toute minorité nationale qui se sera libérée découvrira presque invariablement en son sein une nouvelle minorité nationale qui aura le même droit de réclamer la liberté. Ainsi la chaîne des révolutions devra continuer jusqu'à ce que le dernier-né dans la filiation des États-Nations fasse usage de la force contre le principe même auquel il doit d'exister. C'est pourquoi le principe des nationalités a apporté au monde deux siècles de guerres et de révolutions, mais pas une seule solution définitive. La France a toujours ses Bretons et ses Alsaciens, l'Angleterre, ses Écossais et ses Gallois, l'Espagne, ses Catalans et ses Basques, la Yougoslavie, ses Croates et ses Macédoniens, la Finlande, ses Suédois et ses Lapons, et ainsi de suite pour la Belgique, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Pologne, l'Union soviétique, la Chine, les États-Unis, tous les pays de l'Amérique latine, et que sais-je encore ? En ce qui concerne les États de nationalité plutôt homogène, ou ceux qui n'en ont pas assez de leurs problèmes de sécession, ils se créent des problèmes d'accession : l'Irlande réclame ses six comtés d'Ulster ; l'Indonésie veut la Nouvelle-Guinée. L'Italie nationaliste de Mussolini, quand elle en eut fini avec les irredentas, avait imaginé reconquérir l'Empire romain. Hitler, lui, ne se serait satisfait de rien de moins comme conquête que la totalité du monde non aryen. Quant aux séparatistes québécois, ils auront aussi du pain sur la planche : si leurs principes sont justes, ils devront les pousser jusqu'à l'annexion d'une partie de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, du Labrador et de la Nouvelle-Angleterre ; mais, par contre, ils devront lâcher certaines régions à la frontière de Pontiac et de Témiscamingue, et faire de Westmount le Dantzig du Nouveau-Monde.
Ainsi donc, le concept de l'État-Nation, qui a réussi à entraver la marche de la civilisation, n'a même pas pu résoudre - si ce n'est par l'absurde - les problèmes politiques qu'il était venu poser. Et quand la civilisation a réussi tout de même à passer, c'est lorsqu'il s'est trouvé des clercs capables de placer la fidélité à l'homme au-dessus de l'appartenance à la nation : Pasternak, Oppenheimer, Joliot-Curie, Russell, Einstein, Freud, Casals, et combien d'autres qui ont répondu : E pur si muove, à la raison d'État.
« L'homme, disait Renan, n'appartient ni à sa langue, ni à sa race ; il n'appartient qu'à lui-même, car c'est un être libre, c'est-à-dire un être moral [10]. »
Écoutez aussi le père Delos : « La question est de savoir si l'homme est fait pour abonder en son être historique, si l'histoire est au-dessus de l'homme, si l'humain ne constitue pas une réserve qui déborde toute culture, toute civilisation réalisée par l'histoire et portant un nom de cité, si ce n'est pas nier la valeur de l'homme que de le réduire à s'identifier avec un peuple [11] ».
3 - Genèse des nationalismes
Absurde dans son principe et rétrograde dans son application, l'idée d'État-Nation a néanmoins joui et jouit encore d'une extraordinaire faveur. D'où cela vient-il ? C'est ce que je voudrais maintenant examiner.
La naissance de l'État moderne se situe vers la fin du XIVe siècle. Jusqu'alors les structures féodales avaient suffi à maintenir l'ordre dans une Europe où les moyens de communication étaient limités, où l'économie et le commerce avaient une base essentiellement locale et où, par conséquent, l'administration politique pouvait être fort décentralisée. Mais au fur et à mesure que le commerce se répandit et se diversifia, que l'économie eut besoin d'une assiette plus large et mieux protégée, et que les rois purent donner libre cours à leurs ambitions, les classes bourgeoises montantes s'allièrent avec les monarchies régnantes pour remplacer le pouvoir féodal et les villes libres par un État fort et unifié. En 1576, Jean Bodin comprit que la caractéristique essentielle et nouvelle de tels États était la « souveraineté », et il définissait celle-ci comme la suprema potestas sur les citoyens et les sujets, non limitée par la loi. La monarchie absolue régna quelques siècles sur ces États souverains. Mais ce n'était pas encore des États-Nations ; car les frontières étaient toujours affaires de famille, en ce sens que ces frontières se déplaçaient encore au hasard des mariages et des guerres entre les diverses familles régnantes. Les nationalités entraient si peu en ligne de compte que Louis XIV, par exemple, après avoir annexé l'Alsace, n'y interdit aucunement l'usage de la langue allemande ; c'est seulement vingt ans plus tard que des écoles de français y seraient introduites [12].
L'individualisme, le scepticisme, le rationalisme continuèrent cependant de miner les pouvoirs traditionnels. Et le moment vint où la monarchie absolue elle-même dut abdiquer devant la bourgeoisie, son alliée d'autrefois. Or, avant que la disparition des dynasties n'eût pu entraîner un affaiblissement de l'État, un nouvel agent de cohésion était à l'oeuvre : la souveraineté populaire, ou pouvoir démocratique.
La démocratie en effet ouvrait aux classes bourgeoises, d'abord, puis aux classes populaires, beaucoup plus tard, les voies par où tous pouvaient participer à l'exercice du pouvoir politique. L'État apparut alors comme l'instrument par lequel éventuellement toutes les classes, c'est-à-dire la nation entière, pouvaient s'assurer la paix et la prospérité. Et par un effet naturel, tous voulurent que cet instrument fût le plus fort possible vis-à-vis les autres États-Nations. C'est ainsi que le nationalisme est né, de l'union de la démocratie libérale avec la mystique égalitaire.
Mais hélas ! ce nationalisme, par un singulier paradoxe, s'éloigna vite des idées qui avaient présidé à sa naissance. Car, dès lors que l'État souverain fut mis au service de la nation, c'est la nation qui devenait souveraine, c'est-à-dire au-dessus des lois. Il importa alors peu que la prospérité des unes signifiât la ruine des autres. Les nations fortes historiquement, celles qui s'étaient industrialisées les premières, celles qui avaient hérité d'avances stratégiques ou institutionnelles, eurent tôt fait de comprendre les avantages de leur situation. Les dirigeants y firent alliance avec les dirigés, les possédants avec les dépossédés, et toute cette engeance alla - au nom du nationalisme qui les liait - s'enrichir et s'enorgueillir aux dépens des nations faibles.
Les égoïsmes nationaux s'affublèrent alors d'étiquettes recherchées : darwinisme politique, mystique nietzschéenne, fardeau de l'homme blanc, mission civilisatrice, panslavisme, magyarisation, et toutes ces autres ordures qui autorisèrent le fort à opprimer le faible.
Mais dans tous les cas, le résultat était le même : les nations dominées, amputées, exploitées et humiliées conçurent une haine sans mesure pour leurs oppresseurs ; et solidaires dans cette haine, ils inventèrent contre le nationalisme agresseur un nationalisme défensif. On alluma ainsi des guerres en chaîne qui n'ont pas fini d'incendier la planète.
C'est à l'intérieur du phénomène nationaliste global qu'il faut considérer le sous-sous-cas québécois du sous-cas canadien. La Guerre de sept ans, par un système compliqué d'alliances et d'intérêts, opposait entre elles les cinq grandes puissances européennes. La France et la Russie combattaient aux côtés de l'Autriche, tandis que l'Angleterre s'alignait avec la Prusse. Mais alors que Louis XV aidait Marie-Thérèse de ses armées et de ses deniers, dans l'espoir d'agrandir la présence française en Europe, Pitt envoyait à Frédéric Il beaucoup de sterling mais peu de combattants : ceux-ci s'embarquaient à bord de flottes anglaises pour aller porter la défaite à la France en Inde et en Amérique, et jeter les bases de l'empire le plus formidable que le monde ait connu. On connaît la suite : par le Traité de Paris, le Canada - entre autres - devint anglais [13].
À cette époque, les Anglais étaient déjà les plus nationalistes des hommes. Le pays entier, fier de sa supériorité politique et économique, était d'accord pour aller planter son drapeau, son commerce et ses institutions dans les terres les plus reculées. Ce nationalisme était forcément aussi culturel, et les Anglais étaient convaincus que les pays colonisés par eux jouissaient d'une faveur absolument imméritée : celle de pouvoir communier à la langue et aux coutumes anglo-saxonnes. Aussi bien, les Anglais qui mirent tant d'adresse et de génie politique à développer chez eux le culte des libertés civiles, n'eurent jamais l'idée de protéger les droits minoritaires [14].
Dès la Proclamation royale de 1763, l'intention d'assimiler complètement les Canadiens français était obvie. Et en 1840, Durham - tout en étant "far from wishing to encourage indiscriminately these pretentions to superiority on the part of any particular race" - considérait toujours que l'assimilation n'était plus qu'une "question of time and mode [15]".
Durant toute cette période, les Canadiens d'origine britannique eussent considéré comme une indignité que leur race put être en position inférieure ; aussi, inventèrent-ils toute sorte de stratagèmes grâce auxquels la démocratie en vint à signifier le gouvernement par la minorité [16].
Les générations se succédèrent. L'espoir d'assimiler les Canadiens français finit par être mis en veilleuse (bien que les lois aient continué jusqu'en 1948 à favoriser l'immigration en provenance du Royaume-Uni, par opposition à celle venant de France). Mais le sentiment ne s'est jamais dédit et n'a jamais cessé de caractériser l'attitude des Canadiens de langue anglaise vis-à-vis les Canadiens français.
À Ottawa, et dans les autres provinces, ce nationalisme put porter le masque pieux de la démocratie. Car à mesure que les Canadiens de langue anglaise devenaient les plus nombreux, ils se mirent à voiler leur intolérance sous le couvert de la règle majoritaire : grâce à cette règle, ils purent supprimer « démocratiquement » le bilinguisme dans l'assemblée législative du Manitoba, violer les droits acquis dans les écoles séparées de diverses provinces, imposer férocement la conscription en 1917, et manquer en 1942 à la parole donnée [17].
Dans le Québec, « où ils n'avaient pas le nombre mais où ils avaient l'argent, nos concitoyens (britanno-canadiens) ont souvent cédé à la tentation d'agir démesurément avec les moyens qu'ils avaient [18] ». En politique, le nationalisme canadien-britannique prit ainsi les formes qu'André Laurendeau baptisa admirablement du nom de « théorie du roi nègre ». En matière économique, ce nationalisme consista essentiellement à considérer le Canadien français comme « un cochon de payant » ; mais on poussa parfois la magnanimité jusqu'à placer des hommes de paille - aux noms « bien de chez nous » - sur les boards of directors, ces hommes se ressemblant toujours en ceci : primo, ils ne furent jamais assez compétents et forts pour pouvoir passer en tête, et secundo, ils furent toujours assez « représentatifs » pour solliciter les faveurs du roi nègre et flatter la vanité de la tribu. En matière sociale et culturelle enfin, le nationalisme canadien-britannique s'exprima tout simplement par le mépris : des générations entières d'anglophones ont vécu dans le Québec sans trouver le moyen d'apprendre trois phrases de français. Quand ces individus bornés affirment sérieusement que leur mâchoire et leurs oreilles ne sont pas ainsi faites qu'elles puissent s'adapter au français, ils veulent en réalité vous faire comprendre qu'ils refusent d'avilir ces organes, et leur peu d'esprit, en les mettant au service d'un idiome barbare.
Le nationalisme canadien-britannique engendra, comme c'était inévitable, le nationalisme canadien-français. Comme je l'écrivais, parlant de la genèse de notre nationalisme en même temps que j'en caractérisais l'orientation futile : « Pour un peuple vaincu, occupé, décapité, évincé du domaine commercial, refoulé hors des villes, réduit peu à peu en minorité, et diminué en influence dans un pays qu'il avait pourtant découvert, exploré et colonisé, il n'existait pas plusieurs attitudes d'esprit qui pussent lui permettre de préserver ce par quoi il était lui-même. Ce peuple se créa un système de sécurité, mais qui en s'hypertrophiant lui fit attacher un prix parfois démesuré à tout ce qui le distinguait d'autrui, et considérer avec hostilité tout changement (fût-ce un progrès) qui lui était proposé de l'extérieur [19] ». Et j'ajoutais : « Hélas ! c'est l'idéalisme même des nationalistes qui leur a nui. They loved not wisely but too well ».
4 - Interaction des nationalismes au Canada
Il faut prendre l'histoire comme elle est. Si rétrograde et absurde que soit l'idée d'État-Nation, il reste que cette idée inspira l'essentiel de la politique des Britanniques, puis des Canadiens britanniques, à l'endroit du Dominion of Canada. En gros, il s'agissait pour eux d'identifier le plus possible l'État canadien avec la nation canadienne-britannique.
Comme les Canadiens français eurent la mauvaise grâce de refuser l'assimilation, cette identification ne put jamais être parfaite. Mais les Canadiens britanniques s'en donnèrent néanmoins l'illusion en cantonnant le plus possible le fait français dans le ghetto québécois - dont on rogna souvent les pouvoirs par des mesures centralisatrices, - et en luttant avec une férocité qui étonne contre tous les symboles qui eussent pu détruire cette illusion à l'extérieur de Québec : usage du français sur les timbres, la monnaie, les chèques, dans la fonction publique, les chemins de fer et tout le bazar.
Contre ce nationalisme agresseur, quelle alternative s'offrait - disons depuis un siècle - aux Canadiens français ? D'une part, ils pouvaient opposer à l'idée dominatrice d'État-Nation canadien-britannique l'idée fissipare d'État-Nation canadien-français ; d'autre part, ils pouvaient désamorcer ce concept d'État-Nation et entraîner le Canada sur la voie de l'État multinational.
Le premier choix fut, et reste, celui des séparatistes ou indépendantistes. Option essentiellement émotive et passionnée - comme l'est du reste la cause qu'elle combat, - je n'ai jamais pu en déceler la sagesse. Car, ou bien elle est destinée à réussir ; et ce sera la preuve que le nationalisme des Canadiens britanniques n'était ni intransigeant, ni vigoureux, ni armé, ni bien dangereux pour nous : je me demande alors pourquoi nous craindrions d'affronter ces gens-là au sein d'un État pluraliste, et pourquoi nous renoncerions à nos droits d'être chez nous a mari usque ad mare. Ou bien l'option indépendantiste est vouée à l'échec, et le dernier état de ce peuple sera pire que le premier : non parce qu'un ennemi vainqueur et vindicatif aurait déporté une partie de la population et laissé à l'autre des droits amoindris et un patrimoine spolié - cette éventualité ne me paraissant guère probable ; mais parce que les Canadiens français auraient encore une fois canalisé dans des luttes (par hypothèse) stériles toutes les forces vives qui auraient dû être employées à rivaliser d'excellence, d'adresse et d'obstination avec un ennemi (par hypothèse) redoutable.
Le second choix (celui de l'État multinational) fut, et reste, celui des constitutionnalistes : il consiste à répudier l'idée martiale et autodestructrice d'État-Nation et lui substituer l'idée civilisatrice du pluralisme polyethnique. Je reconnais qu'en certains pays et à certaines époques, cette option peut n'avoir pas été possible, et notamment quand le nationalisme agresseur a joui d'une supériorité écrasante et a refusé tout compromis avec les minorités nationales. Était-ce le cas au temps de Papineau et des patriotes ? J'en doute. Mais en tout état de cause, cette aventure indépendantiste s'est soldée par un Acte d'Union qui - sur le plan des droits minoritaires - était un recul par rapport à l'Acte constitutionnel de 1791.
Comme question de fait, ce second choix a été, et reste possible pour les Canadiens français. L'État multinational put être rêvé par Lafontaine, réalisé sous Cartier, perfectionné par Laurier, affranchi par Bourassa. Car le nationalisme canadien-britannique n'a jamais joui d'une supériorité écrasante, ni ne s'est trouvé en position de refuser tout compromis avec la principale minorité nationale ; par conséquent, il ne pouvait pas suivre la politique que sa morgue eût peut-être préféré, et dut accepter celle que les événements lui imposaient.
D'abord, ce fut l'Acte de Québec, voté sous la menace de la révolution américaine. Puis ce fut la terrible nuit - longue de trois quarts de siècle - durant laquelle les Canadiens britanniques se savaient moins nombreux que les Canadiens français ; comme le remarque Mason Wade à propos des Loyalistes : "They were badly scared men, who had lived through one revolution in America and dreaded another in Canada [20]." Enfin, ce fut la menace perpétuelle de la domination américaine qui obligea - bon gré, mal gré - le nationalisme canadien-britannique à tenir compte de la nationalité canadienne-française : car autrement, il eût été pratiquement impossible de réunir entre elles les différentes colonies de l'Amérique britannique du Nord.
En somme, le pauvre nationalisme canadien-britannique n'a jamais pu avoir le caquet bien haut. Ceux qui eurent la clairvoyance de comprendre cela, parmi les Canadiens français, ceux que j'appelle constitutionnalistes, ont naturellement parié pour l'État multinational, et convié leurs concitoyens à y travailler avec audace et espérance. Ceux au contraire qui ne le comprirent pas n'ont jamais cessé de redouter un adversaire largement imaginaire. Ils se composent : primo, des assimilés et des bonne-ententistes qui accepteraient que l'État-Nation s'édifie sur le cadavre de la nation canadienne-française ; mais ils ne font pas le nombre, ni surtout le poids, et je les élimine comme donnée du problème. Et secundo, des séparatistes, des indépendantistes et des nationalistes de tout poids, qui mettent leur courage et leur talent à dresser contre le nationalisme canadien-britannique un nationalisme contraire. Ces gens n'ont jamais cessé de communiquer à notre peuple ce que Gérard Pelletier a très justement appelé « la mentalité de l'état de siège ». Or, comme je l'écrivais un jour, « le siège est depuis longtemps levé, la caravane humaine a poussé cent lieues plus loin, cependant que nous cuisons implacablement dans notre jus sans oser jeter un coup d'oeil au-dessus des murailles [21] ».
Si l'État canadien a fait si peu de place à la nationalité canadienne-française, c'est surtout parce que nous ne nous sommes pas rendus indispensables à la poursuite de sa destinée. Aujourd'hui par exemple, il semblerait bien qu'un Sévigny ou un Dorion puisse quitter le Cabinet fédéral, comme un Courtemanche l'a quitté, sans causer un dommage irréparable à la machinerie gouvernementale ou au prestige du pays. Et si l'on excepte Laurier, je ne vois pas un seul Canadien français depuis soixante-quinze ans dont la présence au sein du Cabinet fédéral puisse être considérée comme indispensable à l'histoire du Canada telle qu'elle s'est faite, - sauf sur le plan électoral évidemment où la tribu a toujours réclamé ses sorciers. De même, au niveau des hauts fonctionnaires, je doute qu'on puisse en nommer un seul qui ait infléchi heureusement le cours de notre évolution administrative, au sens par exemple où un O. D. Skelton, un Graham Towers ou un Norman Robertson l'ont fait.
Conséquemment, si on examine les quelques « victoires » nationalistes qui ont été remportées à Ottawa après des années de haute lutte, on n'en trouverait probablement pas une seule qui n'aurait pu être gagnée en une séance de Cabinet par un de nos représentants qui aurait eu le calibre d'un C. D. Howe. Il faut bien le dire, tous les ministres canadiens-français ensemble n'auront à peu près jamais fait le poids d'un chèque bilingue ou d'un nom d'hôtel.
En somme, les Canadiens britanniques n'ont jamais été forts que de notre faiblesse. Et c'était vrai non seulement à Ottawa, mais à Québec même, véritable charnier où la moitié de nos droits se perdait par vétusté et décrépitude, tandis que l'autre était dévorée par le ver de l'incivisme et le microbe de la vénalité. Dans ces conditions, peut-on tellement s'étonner de ce que les Canadiens britanniques n'aient pas souhaité que le visage de ce pays comportât quelques traits français ? Et pourquoi auraient-ils voulu apprendre une langue ou participer à une culture que nous mettions tant d'application à dégrader à tous les niveaux de notre système d'éducation ?
Il est sans doute vrai que si les Canadiens de langue anglaise avaient mis à apprendre le français un quart de la diligence qu'ils ont employée à s'y refuser, il y a belle lurette que le Canada serait effectivement bilingue. Car c'est là une des lois du nationalisme, qu'il consume toujours plus d'énergie à combattre les réalités désagréables qu'il n'en faudrait pour inventer une solution heureuse. Mais ceux que cette loi dessert le plus sont de toute évidence ceux dont le nationalisme est minoritaire ; en l'occurrence, nous.
C'est cela que je voudrais maintenant expliquer.
5 - Infortunes du nationalisme canadien-français
Tout le temps et toutes les énergies que nous employons à proclamer les droits de notre nationalité, à invoquer notre mission providentielle, à claironner nos vertus, à pleurer nos avatars, à dénoncer nos ennemis, et à déclarer notre indépendance, n'ont jamais rendu un de nos ouvriers plus adroit, un fonctionnaire plus compétent, un financier plus riche, un médecin plus progressif, un évêque plus instruit ni un de nos politiciens moins ignare. Or, si l'on excepte quelques originaux bourrus, il n'est probablement pas d'intellectuel canadien-français qui n'ait discuté de séparatisme au moins quatre heures par semaine depuis un an ; cela fait combien de milliers de fois deux cents heures employées exclusivement à nous battre les flancs ? Car qui peut affirmer avoir entendu, pendant ce temps, un seul argument qui n'aurait pas déjà été débattu ad nauseam il y a vingt ans, il y a quarante ans et il y a soixante ans ? Je ne suis même pas sûr qu'on ait exorcisé un seul de nos démons : les séparatistes de 1962 que j'ai rencontrés ont, ma foi ! des têtes généralement sympathiques ; mais les rares fois où j'ai eu l'honneur de discuter un peu longuement avec eux, je me suis presque toujours heurté à l'esprit totalitaire des uns, à l'antisémitisme des autres, et, chez tous, au culte généralisé de l'incompétence économique.
Or c'est cela que j'appelle la nouvelle trahison des clercs : cette frénésie hallucinante d'un large secteur de notre population pensante à se mettre - intellectuellement et spirituellement - sur des voies d'évitement.
Il y a quelques années, j'ai essayé de démontrer que les tenants de l'école nationaliste canadienne-française, malgré leur générosité et leur courage, s'étaient à toutes fins pratiques mis en travers du progrès : pendant plus d'un demi-siècle « ils ont formulé une pensée sociale impossible à réaliser et qui à toutes fins pratiques laissait le peuple sans direction intellectuelle efficace [22] ».
Or je découvre que plusieurs personnes parmi celles qui pensaient alors comme moi sont devenues aujourd'hui séparatisantes. Parce que leur pensée sociale est à gauche, parce qu'elles militent pour l'école laïque, parce qu'elles font du syndicalisme, parce que leur culture est ouverte, elles pensent que leur nationalisme s'inscrit dans le sens du progrès. Elles ne voient pas que c'est politiquement qu'elles sont devenues réactionnaires.
Réactionnaires, premièrement, à cause des forces en présence. Un dénombrement, même grossier, des institutions, des réseaux et des individus de fidélité nationaliste, depuis les notaires de village jusqu'à l'Ordre de Jacques-Cartier, depuis le petit patronat jusqu'aux Ligues du Sacré-Coeur, établirait, hors de tout doute, qu'une alliance entre les nationalistes de droite et ceux de gauche jouerait inévitablement - par la loi du nombre - en faveur des premiers. Si cette gauche me répond qu'elle ne passera l'alliance qu'après être devenue majoritaire, je me permets de lui répéter [23] qu'elle ne le deviendra jamais en gaspillant comme elle le fait une partie de ses maigres forces. Tout effort orienté essentiellement vers le renforcement de la nation doit renoncer à diviser cette nation ; un tel effort est automatiquement perdu pour la critique sociale et tend pour autant à consolider le statu quo. En ce sens, l'alliance joue déjà contre la gauche avant même que d'être conclue.
Deuxièmement, les nationalistes - même de gauche - sont politiquement réactionnaires parce qu'en donnant une très grande importance à l'idée de nation dans leur échelle de valeurs politiques, ils sont infailliblement amenés à définir le bien commun en fonction du groupe ethnique plutôt qu'en fonction de l'ensemble des citoyens, sans acception de personne. C'est pour cela qu'un gouvernement nationaliste est par essence intolérant, discriminatoire et en fin de compte totalitaire [24]. Un gouvernement vraiment démocratique ne peut pas être « nationaliste », car il doit poursuivre le bien de tous les citoyens, sans égard à leur origine ethnique. La vertu que postule et développe le gouvernement démocratique, c'est donc le civisme, jamais le nationalisme ; sans doute, un tel gouvernement fera des lois où les groupes ethniques prendront leur profit et le groupe majoritaire en prendra proportionnellement à son nombre ; mais cela viendra comme une conséquence de l'égalité de tous et non comme un droit du plus fort. En ce sens, on peut dire que la province de Québec a toujours eu une politique d'éducation plutôt démocratique que nationaliste ; je n'en dirais pas autant de toutes les autres provinces. Par contre, si l'Hydro-Québec expropriait les industries hydro-électriques pour des raisons nationales plutôt que sociales, nous serions déjà embarqués sur le chemin du fascisme. La droite peut nationaliser ; c'est la gauche seule qui socialise et qui étatise.
Troisièmement, toute pensée qui tend à réclamer pour la nation la plénitude des pouvoirs souverains est politiquement réactionnaire parce qu'elle veut donner un pouvoir politique total et parfait à une communauté qui ne saurait constituer une société politique totale et parfaite. Il est douteux qu'en 1962, aucun État-Nation, ou même aucun État multinational, si fort soit-il, puisse constituer une société politique totale et parfaite [25] : les interdépendances économiques, militaires et culturelles sont une condition sine qua non de la vie des États au XXe siècle, de sorte qu'aucun n'est vraiment suffisant à lui-même. Les traités, les alliances commerciales, les marchés communs, les zones de libre-échange, les accords culturels et scientifiques, tout cela est aussi indispensable au progrès des États dans le monde que le sont les échanges entre les citoyens dans l'État ; et de même que chaque citoyen doit reconnaître que sa souveraineté personnelle est soumise à la loi de l'État - qui l'oblige par exemple à respecter ses contrats - de même les États ne peuvent connaître la paix et le progrès que s'ils acceptent de soumettre les rapports entre eux à une règle de droit supérieure à l'État. En vérité, c'est le concept même de souveraineté qui doit être dépassé, et ceux qui la réclament pour la nation canadienne-française ne sont pas seulement réactionnaires, ils sont ridicules. Les Canadiens français ne peuvent pas constituer une société parfaite, pas plus que les cinq millions de Sikhs du Pendjab ne le pourraient. Nous ne sommes ni assez instruits, ni assez riches, ni surtout assez nombreux pour pourvoir en hommes et financer en argent un gouvernement doté de tous les organes nécessaires à la guerre et à la paix. Les frais fixes per capita nous écraseraient. Mais je renonce à expliquer ces choses à des gens qui voient déjà sans déplaisir que la Laurentie ouvrirait des ambassades un peu partout dans le monde pour « faire rayonner notre culture ». Surtout que les mêmes gens faisaient semblant de comprendre, l'an dernier, que notre société était trop pauvre pour financer une deuxième université - la jésuite - à Montréal !
À ce troisième argument, sur la souveraineté inapplicable et anachronique, les séparatisants répondent parfois qu'un Québec devenu indépendant pourra fort bien renoncer à une partie de sa souveraineté, en entrant dans une Confédération canadienne, par exemple, car alors son choix sera libre... - C'est de l'abstraction, exposant dix. Sans doute serait-ce assez grave d'inviter la nation canadienne-française à s'embarquer pour quelques décennies de privations et de sacrifices, afin que cette nation puisse éventuellement se payer le luxe de choisir « librement » un destin à peu près analogue à celui contre lequel elle aura lutté. Mais la tragédie sans rémission serait de ne pas voir que la nation canadienne-française est trop anémiée culturellement, trop dépourvue économiquement, trop attardée intellectuellement, trop sclérosée spirituellement, pour pouvoir survivre à une ou deux décennies de stagnation pendant lesquelles elle aura versé toutes ses forces vives dans le cloaque de la vanité et de la « dignité » nationales.
6 - La génération de vingt ans
Ce que les Canadiens français de vingt ans pardonneront mal, dans quelques années, aux gens de ma génération, c'est que nous aurons assisté avec tant de complaisance à la renaissance du séparatisme et du nationalisme. Car, dans quelques années, ces jeunes gens auront compris l'effroyable retard qui caractérise l'évolution du Canada français dans tous les domaines. Quoi ! diront-ils alors aux intellectuels, vous publiiez et vous pensiez si peu, et vous aviez le temps de vous poser des questions sur le séparatisme ? Quoi ! diront-ils aux sociologues et aux politicologues, l'année même où les premiers hommes étaient mis en orbite vous répondiez gravement à des enquêtes sur l'indépendance que, à votre avis, peut-être, oui, un jour, sans doute, possiblement... Quoi ! diront-ils aux économistes, le monde occidental - arrivé à l'ère de la production massive - s'ingéniait à recréer par toutes sortes d'unions économiques les conditions de marché qui existaient en Union soviétique et aux États-Unis, et vous, dans le Québec, vous regardiez avec intérêt un mouvement qui commençait par réduire à zéro le marché commun de l'industrie québécoise ? Quoi ! diront-ils aux ingénieurs, vous ne réussissiez même pas à construire des routes qui eussent résisté à deux hivers canadiens, et vous vous ingéniiez à ériger en rêve des frontières autour du Québec ? Quoi ! diront-ils aux juges et aux avocats, les libertés civiles n'avaient survécu dans la province de Québec que grâce aux communistes, aux syndiqués et aux Témoins de Jehovah, grâce aux avocats anglais et juifs, et grâce aux juges de la Cour suprême à Ottawa [26], et vous n'aviez rien de plus pressé que d'applaudir la venue de l'État souverain canadien-français ? Quoi, enfin ! diront-ils aux hommes de partis, vous les Libéraux, vous aviez pendant vingt-cinq ans grugé la souveraineté des provinces, et vous, les Conservateurs, dits d'Union nationale, vous aviez doté le Québec de deux décennies de lois rétroactives, vindicatives, discriminatoires et retardataires, tandis que vous, du PSD-NPD, vous aviez - au nom d'on ne sait plus quelle raison d'État fédéral - saboté, avec l'Union des forces démocratiques, la seule chance des gauches dans le Québec ; et vous découvriez tous tout à coup qu'il fallait donner plus d'indépendance à Québec, plusieurs d'entre vous étant même devenus des séparatistes reconnus ?
J'ose prédire que parmi ces jeunes gens aux interrogations acerbes, il y aura alors un nommé Luc Racine, qui regrettera un peu d'avoir écrit dans Cité libre : « Si la jeunesse actuelle s'attache au problème du séparatisme, ce n'est pas par indifférence aux grands problèmes de l'humanité, mais par souci d'orienter son action sur ce qu'elle est apte à modifier [27] ». Car il comprendra alors qu'un peuple donné, à un moment donné de son histoire, ne dispose jamais que d'une quantité donnée d'énergie intellectuelle ; et que si une génération entière consacre une large part de cette énergie à des billevesées, cette génération aura, à toutes fins pratiques, manifesté son « indifférence aux grands problèmes de l'humanité ». (Un conseil cependant à Racine : qu'il ne s'avise pas de parler d'aliénation nationaliste en 1972, car mon ami André Laurendeau se sentira encore une fois obligé de voler au secours de ses pères et de démontrer qu'en 1922 l'abbé Groulx avait droit à tout notre respect [28].)
Cela dit, comment expliquer la faveur dont jouit aujourd'hui le séparatisme, auprès de la jeune génération ? Comment expliquer, par exemple, que tant de jeunes lecteurs de Cité libre - répondant à « Un certain silence » par une volumineuse correspondance - aient pris parti pour le séparatisme ?
Pelletier me disait qu'ayant - à la revue - enseigné inlassablement le doute méthodique vis-à-vis le pouvoir nanti, et l'ayant également pratiqué à l'égard de la plupart de nos institutions traditionnelles, nous ne devions pas nous surprendre de ce qu'une nouvelle génération s'attaquât à une des réalités que nous avions épargnées : l'État canadien.
La réponse me paraît valable sur le plan psychologique ; mais restait à expliquer l'orientation rétrograde de la révolte.
Pour ma part, je croirais à quelque chose d'analogue au sentiment démocratique d'où naquirent les nationalismes en Europe, il y a un siècle ou deux. La mort de Duplessis, c'est la fin d'une dynastie et de l'oligarchie qu'elle favorisait. L'instauration de la démocratie libérale est la promesse que dorénavant toutes les classes nouvelles pourront accéder au pouvoir. Mais, en pratique, ces classes découvrent que plusieurs des voies de promotion sont obstruées : le clergé conserve sa mainmise sur l'éducation, les Anglais dominent notre finance, les Américains envahissent notre culture. Seul, l'État du Québec est à l'ensemble des Canadiens français : on veut donc pour cet État la plénitude des pouvoirs. La démocratie ayant fait que tous les hommes sont égaux dans la nation, on veut maintenant que toutes les nations soient égales entre elles, et singulièrement que la nôtre soit souveraine et indépendante. On compte que la naissance de notre État-Nation libérera mille énergies insoupçonnées et que, par là, les Canadiens français pourront enfin entrer en possession de leur héritage. Bref, on croit à une énergie créatrice qui donnerait du génie à des gens qui n'en ont pas, et qui apporterait le courage et l'instruction à une nation indolente et ignorante.
C'est d'ailleurs cette foi qui tient lieu d'argument à tous ceux qui sont incapables de fonder leur passion sur l'histoire, ou l'économie, ou la constitution, ou la sociologie. « L'indépendance, écrit Chaput, est beaucoup plus affaire de caractère que de logique... Plus que la raison, il y faut la fierté [29]. » C'est aussi l'attitude de toutes ces adorables jeunes filles et jeunes femmes dont l'argumentation tourne si court : « L'indépendance est affaire de dignité. Ça ne se discute pas, ça se sent ». N'est-ce pas aussi la position de plusieurs artistes et poètes ? « Le jour, écrit Jean-Guy Pilon, où cette minorité culturelle qui a été tolérée en ce pays deviendra une nation à l'intérieur de ses frontières, quand cette minorité sera indépendante, notre littérature connaîtra un formidable bond en avant. Car l'écrivain, comme tout homme de cette société, se sentira libre. Et un homme libre peut faire de grandes choses [30]. »
Or il paraît que Chaput est un excellent chimiste. Je veux seulement savoir comment, par la grâce des énergies libérées par l'indépendance, il deviendra meilleur : il n'a rien d'autre à nous apprendre pour nous conduire au séparatisme. Quant à son livre, il porte la marque d'un homme honnête et désintéressé, mais il se détruit par une de ses propres phrases : « Espérer que par un je ne sais quoi de magique, le peuple canadien-français se réforme tout à coup, réclame en bloc le respect de ses droits, devienne soucieux de la correction de son langage, désireux de culture et de grandes oeuvres, sans lui avoir insufflé un idéal exaltant c'est de l'aberration dangereuse [31] ». Adoncques Chaput renonce à la magie, mais compte sur l'idéal exaltant comme voie de salut pour notre peuple. Comme si la réforme, le respect des droits, la correction de langage, la culture et les grandes oeuvres - toutes choses qui nous sont accessibles sous la constitution canadienne actuelle - ne constituaient pas en eux-mêmes des idéaux exaltants ! Et en quoi cet autre idéal qu'il nous propose - l'État-Nation - est-il différent d'une magie invoquée pour suppléer à notre manque de discipline dans la poursuite des vrais idéaux ?
Il parait aussi que Pilon est un bon poète. Je voudrais qu'il dise en prose, s'il veut - comment la souveraineté nationale fera de lui « un homme libre », et capable de « faire de grandes choses ». S'il ne trouve pas en lui-même, et dans le monde, et dans les astres, la dignité, la fierté et les autres ressorts du poète, je me demande pourquoi et comment il les trouverait dans un Québec « libre ».
Sans doute que le bilinguisme ne va pas sans difficultés. Mais je n'admets pas que celles-ci servent de prétexte à des hommes qui se donnent pour intellectuels, surtout quand la langue dont on se plaint est un des principaux véhicules de la civilisation au XXe siècle. L'ère des frontières linguistiques est finie, au moins en ce qui concerne la science et la culture ; et si les clercs québécois refusent de maîtriser une autre langue que la leur, s'ils n'avouent de fidélité qu'à la nation, ils peuvent renoncer pour toujours à circuler dans l'orbite des élites intellectuelles du monde.
L'argument de l'énergie libérée par l'indépendance nationale me parait inapplicable à des hommes d'esprit. Le rôle de ceux-ci surtout s'ils sortent d'un milieu où le sentiment tient lieu d'idée, et le préjugé tient lieu de connaissance - ce n'est pas de s'émouvoir, c'est de penser, et de penser encore. Si leurs démarches intellectuelles les ont menés dans un cul-de-sac, ils n'ont qu'une chose à faire : rebrousser chemin. Toute tentative de s'échapper par en haut est indigne ; car comme le disait A. Miller dans L'Express : « Le travail d'un véritable intellectuel consiste à analyser les illusions pour en découvrir les causes ».
Il est vrai que pour le peuple, le problème se présente autrement. Le nationalisme, en tant que mouvement émotif qui s'adresse à une collectivité, peut libérer des énergies inattendues. L'histoire nous enseigne que cela s'appelle souvent le chauvinisme, le racisme, le jingoïsme, et autres croisades du genre, où la raison et la réflexion sont réduites à leur plus simple expression. Il se peut que dans certaines conjonctures historiques, là où l'oppression fut sans mesure, la misère sans nom et toute autre issue bouchée, on ait dû invoquer le nationalisme pour déclencher la révolution libérante. Le recours à cette passion était alors un pis-aller inévitable, et il fallait bien accepter que le pire vînt avec le meilleur. Ce « pire » inclut presque toujours un certain despotisme ; car les peuples « libérés » par la passion, plutôt que par la raison, sont généralement déçus de se retrouver aussi pauvres et dépourvus qu'auparavant ; et il faut des gouvernements « forts » pour mettre un terme à leur agitation.
J'étais au Ghana dans les mois qui suivirent son indépendance. Les poètes n'étaient pas meilleurs, les chimistes n'étaient pas plus nombreux, et surtout, les salaires réels n'avaient pas monté. Comme les intellectuels n'arrivaient pas à faire comprendre les raisons de cela au peuple, ils leur parlaient de je ne sais plus quelle île perdue dans le golfe de Guinée qu'il fallait « reconquérir » : à cette fin une partie importante du budget de cet État économiquement dépourvu allait à l'armée. Celle-ci finit par servir à mettre l'opposition en prison...
Une histoire analogue se passe en Indonésie. Cette ancienne colonie devenue État, qui ne réussit guère à se gouverner, ni à s'enrichir, convie son peuple à libérer ses territoires de Nouvelle-Guinée ; or ceux-ci ne lui appartiennent ni par la race, ni par la langue, ni par la géographie. Pourtant, j'ai rencontré au Québec d'authentiques hommes de gauche qui - par inhabileté à raisonner autrement qu'en termes de souveraineté nationale - justifiaient l'opération. L'État du Québec pourra compter sur eux le jour où, incapable d'améliorer la situation sociale de ses citoyens, il lancera ceux-ci à la conquête de « ses îles » de la baie d'Hudson. Déjà l'honorable Arsenault nous prépare à cette épopée glorieuse ! Et Lesage d'applaudir [32].
Fort heureusement, l'aile marchante de notre peuple entretient sur ces sujets moins d'illusions, et elle raisonne plus juste, que nos intellectuels et nos classes bourgeoises. Les grandes centrales syndicales de la province de Québec se sont prononcées catégoriquement contre le séparatisme : elles connaissent pourtant les énergies que dégagent les passions collectives ; mais, justement, elles répugnent à mettre en branle une machine dont la direction est faussée et les freins défectueux.
En résumé, ceux qui recherchent par l'indépendance (ou par l'idée d'indépendance) à « libérer des énergies » jouent aux apprentis-sorciers. Ils ne résolvent pas un seul problème sur le plan de la raison ; et sur celui de la passion, ils déclenchent une action imprévisible, incontrôlable et inefficace. (On remarquera que j'ai surtout parlé ci-dessus de l'énergie prétendument libérée par l'indépendance ; quant à l'énergie qui est à l'origine du séparatisme actuel, j'en disais un mot dans Cité libre de mars 1961, à la page 5. Mais là-dessus, MM. Albert et Raymond Breton présentent dans la présente livraison l'étude de très loin la plus sérieuse qui ait été faite sur le sujet.)
Comme dernier argument, certains jeunes justifient leur flirt avec le séparatisme par des considérations tactiques : « Si nous faisons assez peur aux Anglais, nous obtiendrons ce que nous voulons sans aller jusqu'à l'indépendance ». Cette tactique a obtenu des avantages purement symboliques pour les Canadiens français : un slogan (The French Canadians deserve a New Deal), deux drapeaux (Pearson-Pickersgill), quelques nouveaux noms de vieilles compagnies (par exemple, La Compagnie d'électricité Shawinigan), plusieurs nominations à des conseils d'administration, et une multitude de chèques bilingues (Diefenbaker). De minimis non curat praetor, mais j'avoue quand même que la trouille des politiciens et des hommes d'affaires de langue anglaise est drôle à voir. Elle témoigne certainement de leur mauvaise conscience de nationalistes agresseurs. Mais cela aura ses contrecoups : il n'est rien de plus mesquin que le poltron revenu de sa peur. Et j'aimerais qu'alors le Canada français puisse s'appuyer sur une jeune génération nantie de quelques connaissances plus valables que la passion nationaliste.
7 - L'avenir
Si, dans ma conception, la nation était une antivaleur, je ne me serais pas donné tant de mal à dénoncer une orientation qui conduit la nation canadienne-française à sa ruine.
La nation est porteuse de valeurs certaines : un héritage culturel, des traditions communes, une conscience communautaire, une continuité historique, un ensemble des moeurs, toutes choses qui contribuent - au stage présent de l'évolution de l'humanité - au développement de la personnalité. Certes ces valeurs sont plus privées que publiques [33], plus introverties qu'extroverties [34], plus instinctives et sauvages qu'intelligentes et civilisées [35], plus narcissiques et passionnées que généreuses et raisonnées. Elles tiennent à un stade transitoire de l'histoire du monde. Mais elles sont là aujourd'hui, probablement utiles, et à tout événement conçues comme indispensables par toutes les collectivités nationales.
Sauf pour nous situer dans une perspective juste, cela ne nous avancera donc guère d'affirmer que la nation canadienne-française devra probablement disparaître un jour, et que l'État canadien lui-même ne durera pas toujours. Benda souligne que c'est une des grandeurs de Thucydide qu'il ait pu admettre l'image d'un monde dont Athènes ne serait plus [36].
L'avenir qui doit nous intéresser ici, c'est celui que nous construirons de jour en jour. Il faut donc faire face au problème : comment – sans recourir à l'idée absurde et rétrograde de souveraineté nationale, - comment pouvons-nous préserver les valeurs nationales des Canadiens français ?
Je l'ai dit plus haut : il faut divorcer les concepts d'État et de nation, et faire du Canada une société vraiment pluraliste et polyethnique. Or pour cela, il faut assurer aux différentes régions à l'intérieur de l'État canadien, une large mesure d'autonomie locale, de sorte que, par l'expérience du self-government, les nationaux puissent se donner les lois et les institutions indispensables à l'épanouissement et au progrès de leurs valeurs nationales. En même temps, et dans un mouvement de retrait, il faut que le nationalisme canadien-anglais consente à changer l'image qu'il s'est faite du Canada ; s'il veut protéger et incarner ses valeurs ethniques spécifiques, il devra le faire par le truchement des autonomies locales et régionales, plutôt que par voie de la souveraineté pan-canadienne.
Ces desiderata, il se trouve justement que la constitution canadienne est admirablement conçue pour leur donner un cadre. Par l'Acte de l'Amérique britannique du Nord, la juridiction de l'État canadien (fédéral) porte sur toutes les questions qui n'ont pas à proprement parler une incidence ethnique, mais qui tiennent au bien commun de l'ensemble de la société canadienne : relations extérieures, stabilisation macro-économique, commerce avec les autres pays, navigation, postes, monnaie et banques, et ainsi de suite. Les provinces, au contraire, ont juridiction sur les affaires de nature purement locale ou privée, et celles qui affectent plus directement les valeurs ethniques : éducation, institutions municipales et paroissiales, administration de la justice, célébration du mariage, propriété et droits civils, et le reste ; par ailleurs aucune frontière provinciale ne coïncide tout à fait avec des frontières ethniques ou linguistiques, et conséquemment aucun gouvernement provincial n'est invité par la constitution à se donner une législation conçue uniquement en fonction d'un groupe ethnique, ce qui tendrait à développer la mentalité de l'État-Nation à l'échelon provincial. Sur ce point, il serait bon que l'attitude passée du Québec vis-à-vis de ses minorités nationales serve d'exemple aux provinces où il se trouve de larges minorités de langue française, allemande, ukrainienne, ou autres.
Je ne me cache certes pas que le nationalisme des Canadiens britanniques ait fort à faire - ou plutôt à défaire - avant que l'État pluraliste ne puisse devenir une réalité au Canada. Mais je suis tenté d'ajouter que cela, c'est leur problème. Les jeux sont faits au Canada : il y a deux groupes ethniques et linguistiques ; chacun est trop fort, trop bien enraciné dans le passé et trop bien appuyé sur une culture mère, pour pouvoir écraser l'autre. Si les deux collaborent au sein d'un État vraiment pluraliste, le Canada peut devenir un lieu privilégié où se sera perfectionnée la forme fédéraliste de gouvernement, qui est celle du monde de demain. Mieux que le melting-pot américain, le Canada peut servir d'exemple à tous ces nouveaux États africains et asiatiques, dont il fut question au début du présent article, et qui devront apprendre à gouverner dans la justice et la liberté leurs populations polyethniques. - Cela en soi ne suffit-il pas à dévaloriser l'hypothèse d'un Canada annexé aux États-Unis ?... Le fédéralisme canadien est une expérience formidable, il peut devenir un outil génial pour façonner la civilisation de demain.
Si les Anglo-canadiens ne voient pas cela, encore une fois tant pis pour eux : ils s'enliseront dans un nationalisme rétrograde, borné et despotique. Lord Acton, un des plus puissants esprits du XIXe siècle, catholique par surcroît, avait décrit avec une acuité extraordinairement prophétique, l'erreur des nationalismes et l'avenir qu'ils se préparaient. Il y a exactement un siècle, il écrivait :
"A great democracy must either sacrifice self-government to unity or preserve it by federalism... The co-existence of several nations under the same State is a test, as well as the best security of its freedom. It is also one of the chief instruments of civilisation... The combination of different nations in one State is as necessary a condition of civilised life as the combination of men in society... Where political and national boundaries coincide, society ceases to advance, and nations relapse into a condition corresponding to that of men who renounce intercourse with their fellow-men... A State which is incompetent to satisfy different races condemns itself ; a State which labours to neutralize, to absorb, or to expel them, destroys its own vitality ; a State which does not include them is destitute of the chief basis of self-governement. The theory of nationality, therefore, is a retrograde step in history [37]."
Il va sans dire que si les Canadiens français opposent leur propre nationalisme à celui du Canada britannique, ils sont promis à la même stagnation. Et le Canada deviendra une terre stérile pour l'esprit, une steppe ouverte à toutes les migrations et à toutes les conquêtes.
Encore une fois, les jeux sont faits au Canada : aucun des deux groupes linguistiques ne peut assimiler l'autre de force. Mais l'un ou l'autre, même l'un et l'autre peuvent perdre la partie par défaut, se détruire de l'intérieur, et mourir d'asphyxie. Ainsi, par un juste retour des choses, et comme un gage à la vitalité de l'homme, la victoire est promise à la nation qui, ayant renoncé à son nationalisme, aura enjoint à chacun de ses membres d'employer ses énergies à la poursuite de l'idéal le plus large et le plus humain.
De par la constitution canadienne actuelle, celle de 1867 [38], les Canadiens français ont tous les pouvoirs nécessaires pour faire du Québec une société politique où les valeurs nationales seraient respectées en même temps que les valeurs proprement humaines connaîtraient un essor sans précédent. (Aux pages 98-99 de son livre, M. Chaput propose seize paragraphes de réformes économiques que pourrait entreprendre un Québec indépendant ; or, sauf la première qui abolirait les impôts à Ottawa, toutes ces réformes peuvent être entreprises sous la constitution présente ! Aux pages 123-124, M. Chaput aligne en sept paragraphes les mesures grâce auxquelles un Québec indépendant pourrait assurer la défense effective des minorités canadiennes-françaises établies en dehors du Québec ; or aucune de ces mesures, sauf la déclaration même de souveraineté, ne serait plus accessible à un Québec indépendant qu'elle ne l'est au Québec d'aujourd'hui.
Si le Québec devenait cette province exemplaire, si les hommes y vivaient sous le signe de la liberté et du progrès, si la culture y occupait une place de choix, si les universités étaient rayonnantes, et si l'administration publique était la plus progressive du pays - et rien de tout cela ne présuppose une déclaration d'indépendance ! - les Canadiens français n'auraient plus à se battre pour imposer le bilinguisme : la connaissance du français deviendrait pour l'anglophone un status symbol, cela deviendrait même un atout pour les affaires et pour l'administration. Ottawa même serait transformée, par la compétence de nos politiques et de nos fonctionnaires.
Une telle entreprise est immensément difficile, mais possible. Elle nécessite plus de cran que de gueule. Elle me semble constituer un « idéal » non moins « exaltant » que certaine autre qui est monnaie courante depuis une couple d'années en Landerneau.
À ceux qui auraient quelque souci d'oeuvrer à cette entreprise, qui auraient mis leurs espoirs du côté de l'homme universel, et qui refuseraient d'être complices de la nouvelle trahison des clercs, je laisse une phrase du grand Acton :
"Nationality does not aim either at liberty or prosperity, both of which it sacrifices to the imperative necessity of making the nation the mould and measure of the State. Its course will be marked with material as well as moral ruin, in order that a new invention may prevail over the works of God and the interests of mankind [39]. "
[1] « Lettre d'un nationaliste », Cité libre, Montréal, mars 1961, p. 6.
[2] M. Chaput. Pourquoi je suis séparatiste, Montréal, 1961, p.
[3] On retrouvera la plupart de ces données dans le Statesman's Year Book, Londres.
[4] The Encyclopaeda Britannica.
[5] Dans le Catholic Historical Review, (July 1961).
[6] S. Wambaugh, "National Self-Determiriation", Encyclopaedia of the Social Sciences, New York, 1950.
[7] On l'aura remarqué : le langage politique est parsemé d'embûches. Le mot nation, ou nationalité, du latin nasci (naître), désigne le plus souvent une communauté ethnique, ayant une langue et des coutumes communes. La nation japonaise. C'est en ce sens que l'on parle du principe des nationalités conduisant à l'État national, ou à l'État-Nation. Mais il arrive aussi qu'à l'inverse, ce soit l'État, formé à l'origine de plusieurs communautés ethniques, qui donne naissance à une nation : le met s'entend alors d'une société politique ayant un territoire et des intérêts depuis longtemps communs. La nation suisse. Au Canada, comme je l'expliquerai plus bas, il n'y a, ou aura, de nation canadienne qu'en autant que les communautés ethniques réussiront à exorciser leurs nationalismes respectifs. S'il naît alors un nationalisme canadien, il faudra l'exorciser à son tour, et demander à la nation canadienne d'abdiquer une partie de sa souveraineté en faveur de quelque ordre supérieur, comme on le demande aujourd'hui aux nations canadienne-française et carradienne-britannique. (Pour une discussion du vocabulaire, voir le remarquable essai de E H. Carr, dans Carr et al. , Nations ou fédéralisme, Paris, 1946, p. 4).
[8] Consulter entre autres M. H. Boehm et C. Hayes « Nationalism », E.S.S.
[9] Voir Emory Reeves. A Democratic Manifesto, London, 1943, p. 43. Lire aussi, du même auteur, The Anatomy of Peace, New York, 1945.
[10] Cité par Benda, op. cit., p. 143.
[11] J. T. Delos, La Nation. Montréal, 1944, vol. 1, p. 196. Voir aussi un excellent article du professeur Maurice Tremblay de Laval. « Réflexions sur le nationalisme », Les Écrits du Canada français, vol. V, Montréal, 1959.
[12] Benda, op. cit., p. 268, citant Vidal de la Blache, La France de l'Est.
[13] Lire un chapitre passionnant de J. Dolberg Acton, Lectures on Modern History, London, 1906, p. 274.
[14] "By 1759, English public law had not worked out any theory of minority rights guaranteed by law", écrit le doyen F. R. Scott in Mason Wade Ed, Canadian Dualism, Toronto, 1960, p. 100.
[15] Reginald Coupland, Ed. The Durham Report, Oxford, 1945, p. 153. Voir aussi p. 179.
[16] J'en résume l'histoire dans un chapitre in Mason Wade Ed, Canadian Dualism, Toronto, 1960, p. 252 et suiv. (Chapitre quatre de ce volume, p. 105).
[17] André Laurendeau vient de raconter avec beaucoup de lucidité comment, lors du plébiscite de 1942, l'État fut mis au service du nationalisme canadien-britannique et comment il abusa de la faiblesse numérique des Canadiens français pour se délier de ses engagements envers ceux-ci. (La Crise de la conscription, Montréal, 1962). Une histoire encore plus déshonorante pourrait être écrite à propos de l'oppression qu'exerça le même État contre la minorité canado-japonaise pendant la même guerre.
[18] P. E. Trudeau, « Réflexions sur la politique au Canada français », Cité libre, Montréal, décembre 1952, p. 61.
[19] P. E. Trudeau, Éd. La Grève de l'amiante, Montréal, 1956, p. 11.
[20] M. Wade, The French Canadians 1760-1945, Toronto, 1955, p. 93.
[21] Dans (eh ! oui) Notre Temps, Montréal, 15 nov. 1947.
[22] La Grève de l'amiante, p. 14.
[23] J'ai déjà essayé de démontrer l'inanité stratégique de la gauche nationaliste, dam Cité libre, mars 1961, p. 4.
[24] Lord Acton écrivait déjà en 1862 : "The nation is here an ideal unit founded on the race... It overrules the rights and wishes of the inhabitants, absorbing their divergent interests in a fictitious unity ; sacrifices their several inclinations and duties to the higher claim of nationality, and crushes all natural rights and all established liberties for the purpose of vindicating itself. Whenever a single definite object is made the supreme end of the State.. the State becomes for the time being inevitably absolute." John Dalberg Acton. Essays on Freedom and Power, Glencoe, 1948, p. 184.
[25] Consulter Jacques Maritain, Man and the State, Chicago, 1951, p. 210.
[26] Dans la seule décennie qui commence en 1951, la Cour suprême à Ottawa a renversé sept fois la Cour d'appel de la province de Québec qui avait rendu sept jugements néfastes pour les libertés civiles : l'affaire Boucher (libelle séditieux), l'affaire de l'Alliance (perte de certificat syndical), l'affaire Saumur (distribution de dépliants), l'affaire Chaput (assemblée religieuse), l'affaire Birks (fêtes d'obligation), l'affaire Switzman (loi du cadenas), l'affaire Roncarelli (arbitraire administratif). -Au moment de mettre sous presse, on apprend qu'on peut ajouter à cette énumération un huitième cas : l'affaire de Lady Chatterley's Lover.
[27] Février 1962, p. 24.
[28] Allusion émotive à une réplique émotive de Laurendeau, Le Devoir, 3 mars 1961. Cet esprit raffiné, un des plus justes que je connaisse et qui partage avec Bourassa l'honneur d'être la cible favorite des séparatistes (ceux-ci - assez logiquement, ma foi ! - n'admettant pas que le nationalisme ne soit pas séparatiste), arrive rarement à parler de nationalisme sans trahir par quelque détail une optique faussée : ainsi dans un article de rédaction excellent par ailleurs (Le Devoir, 30 janvier 1962), il lance l'idée saugrenue d'« une conscription morale de la société canadienne-française ». Encore un embrigadement ?
[30] Le Quartier latin, Montréal, 27 février 1962.
[32] Le Devoir, les 29 et 31 janvier 1962.
[33] Delos, op. cit., p. 179.
[34] Maritain. op. cit., p. 5.
[35] Acton, op. cit., p. 188. Voir aussi p. 186 : "In the ancient world idolatry and nationality went together, and the same term is applied in Scripture to both."
[38] C'est en ce sens que j'ai écrit - à propos de la jeunesse séparatiste - une phrase qui a mis beaucoup de monde de mauvaise humeur : « Elle... s'attaque énergiquement à des problèmes qui ont trouvé leur solution il y a un siècle ». (Cité libre, décembre 1961, p. 3.)
|

