|
[5]
De l’esclavage et de la liberté
de l’homme
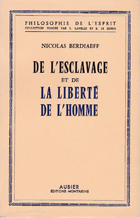 En guise d'introduction En guise d'introduction
Des contradictions de ma pensée
En commençant à écrire ce livre, j’ai jeté un coup d’œil en arrière et éprouvé le besoin d’expliquer à moi-même et à d’autres mon itinéraire intellectuel et spirituel, en même temps que de comprendre et de faire comprendre les apparentes contradictions de ma pensée dans le temps. Ce livre parle de l’esclavage et de l’affranchissement de l’homme ; il se rattache en beaucoup de ses parties à la philosophie sociale, mais il contient toute ma conception philosophique, et a pour base la philosophie personnaliste. Il est le fruit d’une longue recherche de la vérité, d’une longue lutte pour la révélation de toutes les valeurs. Ma vie philosophique était dominée par le désir non seulement de connaître le monde, mais aussi de le changer. Ce n’est pas seulement par la pensée, mais aussi par le sentiment que je me suis toujours refusé à voir dans le monde une réalité immuable et dernière. Dans quelle mesure l’idée qui anime ce livre s’accorde-t-elle avec celles que j’ai développées dans mes livres antérieurs ? Dans quel sens peut-on parler du développement de la pensée d’un philosophe ? Et ce développement constitue-t-il un processus continu, ou présente-t-il des ruptures, des interruptions, et passe-t-il par des crises et des négations de soi-même ? Dans quel sens peut-on parler du développement de ma pensée et comment se sont opérés ses changements ? Il y a des philosophes qui établissent d’emblée un système auquel ils restent fidèles toute leur vie. Et il y en a d’autres dont la philosophie reflète les luttes de l’esprit et dans la pensée desquels on peut discerner plusieurs étapes. Aux époques historiques agitées, aux époques de révolutions spirituelles, le philosophe ne peut rester confiné dans son cabinet, au milieu de ses livres, sans prendre part à la lutte spirituelle. Je n’ai jamais été un philosophe du type académique [6] et n’ai jamais pensé que la philosophie dût être abstraite et étrangère à la vie. Malgré mes nombreuses lectures, je puis dire que ce ne sont pas les livres qui ont été la source de ma pensée. Bien plus, je ne suis jamais arrivé à comprendre un livre, sans me rendre compte du rapport qu’il présente avec mon expérience antérieure. Je pense d’ailleurs que la philosophie, au sens vrai du mot, a toujours été une lutte. Tel fut notamment le cas pour Platon, Plotin, Descartes, Spinoza, Kant, Fichte, Hegel. Ma pensée a toujours été du type de la philosophie existentielle. Les contradictions qu’on peut y relever sont celles qui naissent de la lutte spirituelle ; elles sont inhérentes à l’existence elle-même et ne se laissent pas dissimuler sous une apparente unité logique. La véritable unité de la pensée, d’ailleurs inséparable de l’unité de la personne, est une unité existentielle et non logique. Or, l’existentialité est contradictoire. La personne est l’invariabilité dans la variation. C’est là une des définitions essentielles de la personne. Les variations s’effectuent à l’intérieur d’un seul et même sujet. Il n’y a pas de variation au sens propre du mot, lorsqu’à un sujet se trouve substitué un autre. La variation détruit la personne, lorsqu’elle devient trahison. Or, le philosophe commet une trahison, lorsqu’il change les thèmes fondamentaux de sa philosophie, les motifs essentiels de sa pensée, la base de sa table de valeurs. On peut varier sur la question de savoir où et quand se réalise la liberté. Mais on commet une trahison, lorsqu’on substitue à l’amour de la liberté l’amour de l’esclavage et de la violence. Le changement d’idées peut être réel, mais il peut aussi être apparent, parce que envisagé dans une fausse perspective. Je pense que, d’une façon générale, l’homme est un être contradictoire et polarisé. Et la pensée du philosophe devient contradictoire et polarisée, dès l’instant où, au lieu de s’abstraire des sources primitives de la vie, elle garde constamment contact avec elles. La pensée philosophique est une formation complexe, et même dans les systèmes philosophiques les plus logiques et les plus unis il est facile de déceler la présence d’éléments contradictoires. Loin d’être un mal, c’est là plutôt un bien. Un monisme parfait et définitif de la pensée est irréalisable, et sa réalisation serait même un mal. Je [7] crois peu à la possibilité de systèmes philosophiques, et je ne les trouve même pas désirables. Mais même un système philosophique réalisé et achevé n’est jamais définitif et parfait. La contradiction capitale de la philosophie de Hegel consiste en ce que le dynamisme et la dialectique de la pensée y revêtent la forme d’un système achevé, ce qui signifie l’arrêt du développement dialectique. Or, l’arrêt du développement dialectique, en présence de contradictions sans cesse renaissantes, équivaudrait à la fin du monde. Tant que le monde existe, les contradictions sont inévitables. C’est pourquoi la pensée aboutit nécessairement à une perspective eschatologique, qui projette sur elle une lumière pour ainsi dire rétrospective et éclaire en même temps les paradoxes et les contradictions de la vie du monde.
Je voudrais, en ce qui me concerne, définir les thèmes fondamentaux, la base essentielle des valeurs qui ont inspiré toute ma vie et toute ma pensée. Ainsi seulement pourrai-je faire ressortir la cohérence interne de ma pensée, ma fidélité à l’invariable dans ce qui varie. La principale contradiction de ma pensée relative à la vie sociale consiste dans la coexistence de deux éléments à l’intérieur de cette pensée : de la conception aristocratique de la personne, de la liberté et de l’activité créatrice d’une part, de l’affirmation de la dignité humaine, du droit à la vie de tous les hommes, jusqu’au dernier, de l’autre. Il s’agit d’un conflit de deux sentiments : attachement à un monde supérieur, aspiration à la hauteur, et pitié pour un monde inférieur, pour un monde qui souffre. Contradiction éternelle, conflit inapaisable. Je me sens également proche de Nietzsche et de Léon Tolstoï. J’estime beaucoup K. Marx, mais je n’estime pas moins J. de Maistre et K. Léontiev. J’aime beaucoup Jacob Boehme, mais je n’aime pas moins Kant. Lorsque la tyrannie niveleuse blesse ma conception de la dignité humaine, mon amour de la liberté et de l’activité créatrice, je me révolte contre elle et suis prêt à exprimer ma révolte sous la forme la plus violente. Mais lorsque je vois les partisans de l’inégalité sociale défendre sans pudeur leurs privilèges, lorsque je vois le capitalisme opprimer les masses travailleuses, transformer les hommes en choses, j’éprouve le même sentiment, le même [8] besoin de révolte. Dans un cas comme dans l’autre, je nie les fondements du monde moderne.
Pour comprendre les ressorts intérieurs d’une conception philosophique, il faut faire appel au premier sentiment que le philosophe a éprouvé en présence du monde, sa première vision du monde. A la base de la connaissance philosophique se trouve toujours une expérience concrète ; il serait vain de vouloir l’expliquer par un enchaînement concret de notions, par l’activité de la pensée discursive : ce ne sont là que des instruments. La connaissance de soi étant une des principales sources de la connaissance philosophique, je découvre en moi, comme point de départ initial, une révolte contre le donné du monde, le refus d’accepter une objectivité quelconque, considérée comme un asservissement de l’homme, une opposition de la liberté de l’esprit à la nécessité du monde, à la violence et au conformisme. Je signale ce fait, non à titre autobiographique, mais comme un fait de connaissance philosophique, comme une indication du chemin philosophique que j’ai suivi. C’est ainsi que les mobiles internes de ma philosophie se sont affirmés dès le début : primauté de la liberté sur l’être, de l’esprit sur la nature, du sujet sur l’objet, de la personne sur le général et l’universel, de la création sur l’évolution, du dualisme sur le monisme, de l’amour sur la loi. La reconnaissance de la primauté de la personne implique bien celle d’une inégalité métaphysique, d’une diversité, celle de distinctions, la désapprobation de tout mélange, l’affirmation de la qualité, en opposition avec la quantité. Mais cette inégalité métaphysique et qualitative ne comporte nullement une inégalité sociale, une inégalité de classes. La liberté qui ignore la pitié devient démoniaque. L’homme ne doit pas seulement monter, il doit aussi savoir descendre. Après un long travail intellectuel et spirituel, j’ai fini par reconnaître, d’une façon particulièrement nette, qu’aucune personne humaine, pas même celle du dernier humain, ne saurait, en tant que porteur de l’être suprême, servir de moyen en vue de quoi que ce soit, que chaque personne possède un centre existentiel et a droit non seulement à la vie, ce que lui dénie la civilisation moderne, mais à la participation au contenu universel de la vie. C’est là une vérité évangélique, mais [9] dont l’évidence ne s’impose pas encore à tout le monde. Des personnes qualitativement différentes, inégales, sont égales (au sens profond du mot) non seulement devant Dieu, mais aussi devant la société qui n’a pas le droit d’établir entre les personnes des différences fondées sur des privilèges, autrement dit des différences sociales. Le nivellement social, au sens d’une structure sans classes, ne se comprend pas autrement que comme une révélation de l’inégalité personnelle d’ordre qualitatif, et non substantiel, d’une inégalité n’ayant rien à voir avec la situation sociale de la personne. C’est un personnalisme anti-hiérarchique. La personne ne saurait être une partie d’un tout hiérarchique quelconque : elle est elle-même un microcosme à l’état potentiel. C’est ainsi que se sont trouvés associés dans ma conscience des principes antagonistes, et dont l’antagonisme se manifeste également dans le monde : principe de la personne et de la liberté ; principe de la pitié, de la compassion et de la justice. Le principe de l’égalité comme tel n’a pas de signification propre car l’égalité ne signifie quelque chose que pour autant qu’elle est subordonnée à la liberté et à la dignité humaine. Je n’ai jamais éprouvé la moindre difficulté à sacrifier les traditions sociales, à renoncer aux préjugés et intérêts du milieu aristocratique et nobiliaire qui fut le mien. Partant de la liberté, j’ai suivi mon chemin propre. Je ne me suis jamais senti lié par les idées et les sentiments cristallisés, figés et ossifiés de l’intelliguentzia russe. Je ne me suis jamais senti comme faisant partie de ce monde, ni d’un monde quelconque. A cela s’ajoutait encore mon horreur de la vie bourgeoise de l’État, une tendance anarchique, mais d’un genre particulier. Il faut prendre pour point de départ, non l’amour du monde, mais l’opposition entre la liberté de l’esprit et le monde. Mais partir de la liberté de l’esprit ne signifie pas partir de rien, du vide. Il existe un contenu spirituel du monde des idées dont il faut tenir compte pour comprendre le chemin suivi par un philosophe. Je parlerai tout d’abord du monde des idées philosophiques.
Ce n’est pas en se plaçant au point de vue du platonisme ou de la philosophie de Hegel et de Schelling qu’on pourra dégager la base essentielle de ma conception philosophique, [10] et surtout l’idée que je considère comme l’idée centrale de cette conception et qui est celle de l’opposition entre l’objectivation, d’une part et l’existence de la liberté, de l’autre. Platon et Plotin, Hegel et Schelling ont certainement joué un grand rôle dans la philosophie religieuse russe. Mais ce ne sont pas là mes sources à moi. On comprendra plus facilement ma pensée à travers Kant et Schopenhauer qu’à travers Hegel et Schelling. Kant et Schopenhauer ont exercé une grande influence sur mon orientation première. Je ne suis pas un philosophe d’Ecole, je n’ai jamais appartenu et n’appartiens à aucune Ecole. Schopenhauer fut le premier philosophe dont je me suis inspiré. J’étais encore un adolescent lorsque j’ai commencé à lire des livres de philosophie, et, tout en ayant été, dans mes jeunes années, proche du kantianisme, je n’ai jamais partagé entièrement les idées philosophiques de Kant, pas plus d’ailleurs que celles de Schopenhauer. J’ai même lutté contre l’emprise de Kant. Mais il est un certain nombre d’idées permanentes qui se sont maintenues tout le long de ma carrière philosophique. Ce que j’appréciais surtout chez Kant, c’est son dualisme, sa distinction entre le règne de la liberté et celui de la nature, sa théorie du caractère intelligible de la liberté et son volontarisme, sa conception d’un monde distinct de celui des phénomènes, d’un monde authentique auquel il a donné le nom assez mal choisi de monde de choses en soi. J’apprécie également la distinction schopenhauérienne entre la volonté et la représentation, sa théorie de l’objectivation de la volonté dans le monde naturel, objectivation qui aboutit à la création d’un monde non authentique ; bref, je me sentais très proche de l’irrationalisme schopenhauérien. Après avoir adhéré à toutes ces conceptions et idées de l’un et de l’autre, je me suis engagé dans une voie qui devait m’éloigner de ces deux philosophes. Kant a barré le chemin susceptible de conduire à la connaissance du monde authentique, distinct du monde des phénomènes, et la catégorie de l’esprit est tout à fait absente de sa philosophie. Je me sentis également étranger et hostile à l’antipersonnalisme de Schopenhauer et encore, si possible, plus étranger et plus hostile au monisme, à l’évolutionnisme et à l’optimisme de Fichte, de Schelling et de Hegel, à leur [11] conception de l’objectivation de l’esprit, du Moi universel, de la raison dans le processus cosmique et historique, et surtout à la doctrine de Hegel sur l’autorévélation de l’esprit et sur son évolution vers la liberté au cours du processus cosmique et sur Dieu en tant que devenir. Le dualisme de Kant, le pessimisme de Schopenhauer sont plus proches de la vérité. Tout ceci ne se rapporte qu’à mes idées purement philosophiques. Mais ce que je tiens surtout à montrer, ce sont les circonstances qui ont déterminé ma première attitude à l’égard de la réalité sociale ambiante, les sources auxquelles j’ai puisé les éléments de mes jugements de valeur sur le monde ambiant. Sous ce rapport, j’ai subi, dès ma première jeunesse, l’influence de L. Tolstoï qui m’a appris beaucoup de choses. Si j’ai acquis de bonne heure la conviction que la civilisation repose sur une base fausse, qu’elle est la conséquence d’un péché originel ; que la société dans son ensemble a l’erreur et l’injustice pour base, c’est à Tolstoï que je le dois en grande partie. Je n’ai jamais été un adepte du tolstoïsme proprement dit et je n’ai jamais éprouvé beaucoup de sympathie pour les tolstoïens ; mais la révolte de Tolstoï contre la fausse grandeur et les fausses saintetés de l’histoire, contre les erreurs qui président aux rapports sociaux des hommes ont toujours fait partie des dispositions les plus intimes de mon esprit. Aujourd’hui encore, après avoir parcouru un long chemin, je retrouve en moi ces premières appréciations de la réalité sociale et historique, cette liberté à l’égard des traditions sociales imposées, des préjugés moraux de gens bien pensants, cette horreur de la violence, de la « droite » et de la « gauche ». Je ressens tout cela comme un état de révolte spirituelle, susceptible de donner naissance à toutes sortes de réactions sur le milieu. Plus tard, mon attitude à l’égard de la réalité sociale a subi l’influence de Marx et a pris, sous cette influence, une forme très concrète. Je n’ai jamais pu me résigner au rôle d’un partisan de l’ « orthodoxie », quelle qu’elle soit, et c’est contre l’ « orthodoxie » que j’ai toujours lutté. Aussi n’ai-je jamais été un « marxiste orthodoxe », un matérialiste, et je suis resté idéaliste en pleine période marxiste. J’ai essayé, dans les questions sociales, de concilier ma philosophie idéaliste avec le [12] marxisme. Tout en acceptant certains côtés de la conception du monde matérialiste, j’ai toujours cherché à donner à mon socialisme une base idéaliste et morale. Le bas niveau de culture d’un grand nombre de marxistes révolutionnaires m’a toujours choqué. Je ne me sentais pas à l’aise dans leur milieu, et ce sentiment de malaise s’est encore aggravé pendant les années de mon exil dans le Nord. Mon attitude à l’égard des marxistes était double, et je n’ai jamais pu adhérer au marxisme totalitaire. En pensant aux discussions que j’ai eues avec des marxistes plus ou moins totalitaires dans les cercles marxistes que j’avais fréquentés dans ma jeunesse, j’y retrouve un thème qui est resté actuel jusqu’à nos jours. C’est en effet le même thème que celui qui a donné lieu à tant de discussions à propos d’André Gide et de ses deux livres sur l’U.R.S.S. Je me rappelle fort bien mes discussions avec A. V. Lounatcharski, mon camarade de jeunesse, que je rencontrais souvent dans les cercles marxistes. Ces discussions ont pris fin lorsqu’il est devenu commissaire du peuple, car à partir de ce jour je n’ai plus cherché à le rencontrer. Au cours de ces discussions, dans lesquelles je mettais beaucoup d’ardeur et d’enthousiasme, j’insistais toujours avec force sur l’existence du vrai et du bien, comme valeurs idéales, indépendantes de la lutte de classes, du milieu social ; autrement dit, je me refusais à admettre la subordination de la philosophie et de la morale à la lutte de classes révolutionnaire. Je me suis toujours attaché à montrer que ce sont la vérité et la justice qui déterminent mon attitude révolutionnaire à l’égard de la réalité sociale, au lieu d’être déterminées elles-mêmes par cette attitude. Lounatcharski prétendait que cette défense de la vérité désintéressée, de l’indépendance de l’intellect et du droit de jugement personnel sont en contradiction avec le marxisme qui fait dépendre la vérité et la justice de la lutte de classes révolutionnaire. Plekhanov me disait également qu’on ne peut pas rester marxiste lorsqu’on professe, comme moi, une philosophie idéaliste indépendante. C’est devant ce problème que se trouvent les intellectuels de nos jours qui reconnaissent la vérité sociale du communisme. On dénie à Gide le droit de dire ce qu’il croit être la vérité sur la Russie soviétique, sous [13] prétexte que la vérité ne peut se révéler à l’homme individuel, que l’homme individuel ne doit pas insister sur ce qui n’est pas sa vérité subjective, la vérité étant le produit de la lutte révolutionnaire du prolétariat et devant contribuer à la victoire de celui-ci. La vérité, alors même qu’elle se rapporte aux faits les plus incontestables, devient un mensonge, si elle peut nuire à la victoire du prolétariat, tandis que le mensonge peut devenir un moment dialectique nécessaire de la lutte prolétarienne. Or, j’ai toujours pensé, et je continue à penser, que la vérité n’est au service de personne et de rien, que c’est elle qui se sert de tous et de tout... La vérité doit être défendue et affirmée et proclamée, alors même qu’elle est de nature à nuire à la lutte. L’attitude à l’égard de la vérité a considérablement changé dans le monde contemporain. Marxistes et fascistes prétendent, les uns et les autres, que la vérité est un produit de collectivités et qu’elle ne se manifeste et ne se révèle qu’au cours de luttes collectives ; que l’individu ne saurait connaître par lui-même la vérité et l’affirmer à l’encontre de la collectivité. J’ai assisté à la formation de cette manière de voir pendant les années de ma jeunesse marxiste. Je protestais contre cet aspect du marxisme au nom du personnalisme, tout en continuant à approuver les exigences sociales du marxisme.
Ma rencontre avec Ibsen et Nietzsche a été pour moi d’une grande importance pendant ces années où je cherchais ma voie qui devait mettre fin aux luttes spirituelles qui se livraient en moi. Et cela pour des raisons différentes de celles qui expliquent le rôle que Kant et Marx ont joué dans mon évolution spirituelle. Je dois dire toutefois que le rôle d’Ibsen a été au début plus grand sous ce rapport que celui de Nietzsche. Aujourd’hui encore, je ne puis relire les drames d’Ibsen sans éprouver une profonde émotion. Beaucoup de mes valuations morales se rapprochent de celles d’Ibsen, surtout en ce qui concerne l’opposition entre la personne et le groupe collectif. Avant Ibsen, ce fut Dostoïevski, que j’ai aimé depuis mon enfance, qui me fit entrevoir toute la profondeur des problèmes concernant la personne et la destinée personnelle. Or, ni le marxisme ni les intellectuels russes de gauche n’avaient, à mon avis, quelque conscience de ces problèmes. Je lisais [14] Nietzsche, avant qu’il fût devenu populaire dans les milieux cultivés russes. Il était proche de l’un des pôles de ma nature, comme Tolstoï l’était de l’autre. Il fut un temps où Nietzsche avait pris dans mon esprit le dessus sur Marx et Tolstoï, mais jamais d’une façon définitive. La transmutation des valeurs nietzschéennes, sa négation du rationalisme et du moralisme n’ont pas tardé à devenir partie intégrante de mon contenu spirituel, en agissant comme une force souterraine. Mais sur la question de la vérité, mon désaccord avec Nietzsche était aussi profond qu’avec Marx. Quoi qu’il en soit, toutes ces influences ont contribué, chacune à sa manière, à m’affermir dans mon personnalisme et à déterminer mon attitude à l’égard du christianisme.
Les réactions psychiques jouent un grand rôle dans la vie humaine. L’homme n’arrive que péniblement à dominer les nombreux éléments, en apparence contradictoires et exclusifs les uns des autres, qu’il porte en lui, à réaliser leur harmonie et leur unité. J’ai, quant à moi, toujours cherché à concilier l’opposition entre l’amour, la liberté, la vocation créatrice et l’indépendance de la personne, d’une part, et le processus social qui opprime la personne et la considère comme un moyen, de l’autre. Le conflit entre la liberté et l’amour, comme entre la liberté et la vocation, entre la liberté et la destinée, est un des conflits les plus profonds de la vie humaine. Ma première forte réaction contre mon milieu social avait consisté à me détourner de la société de la noblesse et à adhérer au camp de l’intelliguentzia. Mais je n’ai pas mis longtemps à m’apercevoir, et j’en ai éprouvé une profonde amertume, que, même dans ce camp, la dignité de la personne ne comptait pas pour grand-chose, et que la libération du peuple y était trop associée à l’asservissement de l’homme et de sa conscience. J’ai pu constater de bonne heure les résultats de ce processus. Les révolutionnaires ne respectaient pas la liberté de l’esprit, niaient les droits de l’activité créatrice de l’homme. J’ai éprouvé une réaction interne, psychique et morale, contre la première, contre la petite révolution. Ce ne fut pas une réaction contre l’affranchissement politique et social, qui était le but de cette révolution, mais contre son aspect spirituel, contre les résultats moraux, à [15] mon avis tout à fait insuffisants, qu’elle pouvait avoir, au point de vue purement humain, pour la personne humaine. Je connaissais fort bien ces milieux. Je considérais comme ma tâche propre de critiquer ouvertement une certaine attitude traditionnelle des intellectuels révolutionnaires de gauche. J’étais beaucoup plus éloigné des intellectuels radicaux de gauche que des révolutionnaires proprement dits, auxquels me rattachaient des liens personnels. J’écrivis en 1907 un article dans lequel je prédisais la victoire inévitable des bolcheviks dans le mouvement révolutionnaire. J’étais, pendant ces années-là, sous la profonde influence de la Légende du Grand Inquisiteur, de Dostoïevski. Je puis dire que, devenu chrétien, je me suis identifié avec le Christ de la Légende et que je me suis dressé, au nom du christianisme lui-même, contre tout ce qui faisait partie de l’esprit du Grand Inquisiteur. Cet esprit, je le voyais partout, aussi bien dans l’autoritarisme de la religion et de l’État que dans celui du socialisme révolutionnaire. Le problème de la liberté, celui de l’homme, celui de l’activité créatrice sont devenus les problèmes fondamentaux de ma philosophie. Mon livre sur le Sens de la Création fut pour ainsi dire un livre de combat et d’assaut, dans lequel se trouve exposée ma propre conception philosophique. Je dois encore mentionner, à ce propos, le rôle qu’a joué, au point de vue du développement de mes idées philosophiques et de ma formation spirituelle, ma rencontre avec Jacob Boehme. A vrai dire, je ne participais pas aux mouvements religieux et philosophiques, politiques et sociaux, bref à tous les principaux courants du commencement du XXe siècle. J’ai subi une réaction spirituelle contre le milieu politique, le milieu littéraire et le milieu religieux orthodoxe de cette époque. Il n’y avait rien à quoi je pusse me rattacher et je me sentais bien isolé. Le thème de l’isolement a toujours été un de ceux qui m’ont le plus préoccupé. Mais, doué d’un tempérament actif et combatif, je ne pouvais m’empêcher de me mêler de temps à autre des affaires de ce monde, et chacune de ces interventions me laissait une pénible déception. La deuxième révolution russe, la grande, a provoqué chez moi une réaction orageuse, car tout en estimant que cette révolution était inévitable et juste, je trouvais que son aspect spirituel n’était [16] pas ce que, à mon avis, il devait être. Ses manifestations, qui manquaient souvent de noblesse, ses atteintes à la liberté de l’esprit étaient en contradiction avec ma conception aristocratique de la personne et mon culte de la liberté spirituelle. Je désapprouvais la révolution bolchevik, non en raison de ses buts sociaux, mais à cause de ses tendances spirituelles. Et j’exprimais ma désapprobation avec trop de passion, souvent d’une façon trop injuste. Je voyais en elle le triomphe du Grand Inquisiteur. Mais, en même temps, je ne croyais pas à la possibilité de restaurations quelconques et je n’en voulais d’ailleurs pas. C’est à ma revendication de la liberté de l’esprit que je dois d’avoir été exilé de Russie. Mais une fois en Occident, j’ai subi une nouvelle crise psychique, crise de réaction aussi bien contre les éléments russes émigrés que contre la société européenne, bourgeoise et capitaliste. J’ai constaté chez les émigrés russes la même aversion pour la liberté, la même attitude négative à son égard que dans la Russie communiste. Fait incompréhensible, mais beaucoup moins justifié que dans la révolution communiste. Jamais une révolution n’a aimé la liberté car la mission d’une révolution est ailleurs. Les révolutions font remonter à la surface de nouvelles couches sociales, jusqu’alors exclues de la vie active et opprimées, et il n’y a rien d’étonnant si, dans leur lutte pour une nouvelle position sociale, elles se montrent peu animées de l’amour de la liberté et ne manifestent pas trop de sollicitude pour les valeurs spirituelles. Beaucoup moins compréhensible et moins justifiée est cette indifférence pour la liberté et les créations spirituelles chez ceux qui se considèrent comme les porteurs et les gardiens de la culture spirituelle. Or, quant à l’Europe occidentale, il devint pour moi tout à fait évident que le front anticommuniste ne s’y était constitué que pour la défense des intérêts du capitalisme bourgeois et avait un caractère nettement fasciste. Et c’est ainsi que s’acheva l’évolution de ma philosophie sociale. Cycle plutôt qu’évolution, puisque je revins à la vérité socialiste qui avait été celle de ma jeunesse, mais enrichie des idées et des croyances que j’avais acquises et élaborées au cours de toute ma vie. J’ai abouti à ce que j’appelle le socialisme personnaliste, lequel diffère radicalement [17] de la métaphysique socialiste en vigueur, fondée sur le primat de la société par rapport à l’individu. Le socialisme personnaliste reconnaît, au contraire, le primat de la personne par rapport à la société. Ce socialisme n’est qu’une projection sociale du personnalisme dont la vérité devenait pour moi de plus en plus évidente.
J’ai réussi, au cours de ces dix dernières années, à me débarrasser définitivement des derniers restes du romantisme historique qui comporte une conception esthétique de la religion et de la politique et une idéalisation de la grandeur et de la puissance historiques. Le romantisme historique n’avait jamais poussé en moi de racines bien profondes, il n’avait rien d’une élaboration vraiment personnelle. La profonde vérité de l’attitude de Tolstoï à l’égard du faux romantisme des valeurs historiques s’imposa de nouveau à mon esprit, s’empara de nouveau de ma conscience. La valeur de l’homme, de la personne humaine est supérieure aux valeurs historiques d’un État et d’une nationalité puissants, d’une civilisation florissante, etc. Tout comme Herzen et K. Léontiev chez nous, comme Nietzsche en Allemagne et Léon Bloy en France, je sens venir le règne du petit bourgeois, je prévois l’embourgeoisement non seulement de la civilisation capitaliste, mais aussi de la civilisation socialiste. Mais cet argument, tiré de l’avènement inévitable du règne du petit bourgeois, me paraît aujourd’hui porter à faux. J’ai acquis la profonde conviction que toute objectivation de l’esprit dans le monde a pour effet l’embourgeoisement de celui-ci. On ne peut pas défendre l’injustice sociale sous le prétexte que la justice sociale ouvre la porte à l’embourgeoisement. On ne peut refuser de résoudre le problème du pain pour les classes laborieuses sous le prétexte que la culture était belle tant que ce problème n’était pas résolu et tant que les masses étaient opprimées. C’est là un argument particulièrement inadmissible pour un chrétien. Je ne m’élève pas moins contre l’idéalisation de l’élément « organique » de l’histoire, que j’avais déjà soumise à une critique approfondie dans l’ouvrage dont j’ai parlé plus haut, de même que contre l’idéalisation de ce qu’on appelle les « élites » cultivées. Le sentiment de supériorité qui anime ces élites n’est qu’une preuve de leur égoïsme, de la méconnaissance [18] dédaigneuse des liens qui les rattachent au corps social, de la nécessité de servir ou de leur incapacité de servir. Je crois à l’aristocratisme authentique de la personne, à l’existence de génies et de grands hommes conscients du devoir de servir et éprouvant non seulement le besoin de monter, mais aussi celui de descendre. Mais je ne crois pas à l’aristocratisme de groupe, fondé sur une sélection sociale. Rien de plus odieux que le mépris que ceux qui se considèrent comme une élite éprouvent pour les masses populaires. Une élite peut même se révéler comme « plébéienne », au sens métaphysique du mot, et ceci est particulièrement vrai de l’élite bourgeoise. Il importe d’insister sur l’incompatibilité de l’idée chrétienne du royaume de Dieu, de la conscience eschatologique chrétienne, d’une part, et du culte idolâtrique des traditions sacro-saintes, de quelque ordre qu’elles soient : principes de conservation sociale, principes monarchiques, nationalistes, principes d’autorité, de famille, de propriété, de l’autre. Et ce qui est vrai de tous ces principes l’est également des principes révolutionnaires, démocratiques, socialistes. Il ne suffit pas d’affirmer la vérité de la théologie apophatique, négative, il faut également affirmer celle de la sociologie apophatique, négative. La sociologie cataphatique, surtout lorsqu’on lui donne un fondement religieux, est pour l’homme une source d’esclavage. Or, le livre que voici est consacré à la lutte contre l’esclavage de l’homme. La philosophie exposée dans ce livre est une philosophie délibérément personnaliste ; je n’y parle de l’homme, du monde, de Dieu que d’après ma propre expérience vécue ; c’est la philosophie d’un homme concret, ayant des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, et non une philosophie inspirée par la raison ou l’esprit du monde. Pour compléter l’explication de mon évolution spirituelle, j’ajouterai encore que je perçois le monde sous un aspect toujours nouveau, comme par une première intuition, bien que la vérité qu’il exprime me soit connue depuis longtemps. Ce serait mal comprendre ce livre que d’y chercher l’exposé d’un programme concret ou une solution pratique de questions sociales. C’est un livre philosophique, dont l’auteur s’attache avant tout à faire ressortir la nécessité d’une réforme spirituelle.
|

