|
[207]
Socrate et le Sage Indien
Cheminements vers la sagesse
 Postface Postface
par
FRANÇOIS DAUMAS
Professeur d’Égyptologie de la Faculté
des Lettres de Lyon
- Futurum tempus est, cum adpareat Aegyptios incassum pia mente divinitatem sedula religione servasse.
ASCLEPIUS, 24.
Un des problèmes les plus intéressants soulevés par les découvertes des cent dernières années est celui des rapports entre la pensée grecque et celle des anciens pays orientaux, au premier rang desquels se détache l’Égypte. Le cas de Platon, dont l’œuvre nous est entièrement parvenue et dont la biographie est dans une bonne lumière historique, est particulièrement favorable à l’étude.
Sachant que nous nous y intéressions depuis bien longtemps déjà, le docteur Roger Godel nous a honoré de la première lecture de son livre sur Platon à Héliopolis d’Égypte. Dans cette méditation philosophique, qu’a éveillée la contemplation des monuments grandioses élevés par l’architecte Imhotep à Saqqara, ou la vue de l’obélisque mélancolique qui dresse encore, à Mataria, le nom de Sesostris dans le ciel, il ne cherche pas à étudier, au point de vue historique, quelles relations on peut établir entre les conceptions platoniciennes telles qu’elles [208] apparaissent lumineusement dans les dialogues et ce que nous pouvons reconstituer des idées égyptiennes grâce aux fragments épars qui, après deux mille ans de sommeil, sont peu à peu sortis de la nuit. C’est seulement un essai pour saisir ce qui, dans une civilisation apparemment si éloignée de la grecque, a pu intéresser Platon et nourrir sa pensée. Intuition et déduction s’y jouent dans une gerbe d’idées merveilleuses qui nous captive et nous enchante. Mais c’est l’intérêt de ce petit livre que jamais la construction intellectuelle n’y sort du réel. Elle a le constant souci de rester sans cesse en contact avec ce que nous pouvons savoir de ce passé prestigieux et, sans chercher à faire de l’histoire, le docteur Godel s’appuie toujours sur elle et n’avance prudemment que protégé par elle.
Pourtant, pour qui a parcouru la littérature du sujet, ces dernières années, il semble que les portes maintenant sont à jamais fermées.
Récemment encore on nous a montré, revenant à des arguments développés jadis tout au long, que le voyage de Platon en Égypte, attesté seulement à la fin de l’époque hellénistique, n’avait aucun fondement historique. C’était le fruit tardif d’un hellénisme abâtardi qui, reniant le règne de la raison pure, fleur du génie grec en sa maturité, essayait de faire remonter aux sources troubles et douteuses de l’Orient le grand courant philosophique de l’Hellade. Et, d’ailleurs, qu’est-ce qu’un philosophe aurait bien pu recueillir dans l’amas de puérilités et de mythes grossiers qui fait le fond de la pensée égyptienne ? Rien à tirer de ces grimoires où l’intelligence déficiente le cède trop souvent à l’image pour vraiment arriver à saisir tant soit peu le réel. Et puis, à supposer qu’il y eût quelque élément de valeur, jamais Platon qui n’a point su la langue égyptienne, n’aurait réussi à le connaître. Jalousement gardé, défendu par le double voile d’une écriture indéchiffrable et d’une langue difficile, le secret des conceptions égyptiennes était si bien caché qu’aucun Grec n’aurait pu y avoir accès.
[209]
Si ces raisonnements, qui ne manquent pas de vraisemblance, étaient confirmés, il est certain qu’il n’y aurait plus qu’à abandonner la recherche et à s’occuper d’autre chose. Et pourtant a-t-on bien scruté les textes ? Le voyage de Platon n’est-il qu’une création légendaire postérieure de deux ou trois siècles au philosophe ? Faut-il admettre que la pensée égyptienne est si indigente ? — Et si quelques-uns au moins des mythes, prières ou textes moraux étaient des œuvres belles et dignes d’attention ? N’oublions pas qu’au siècle dernier, en France, Victor Cousin était tout heureux d’avoir découvert sur les quais, parmi de vieux livres, « un certain Aquinate » qui ne manquait pas d’originalité. Et on ne saurait en vouloir trop aux égyptologues si, allant au plus pressé, ils essayent de publier et de traduire les textes avant d’en tenter une interprétation définitive qui peut être seulement le fruit d’une comparaison. Ce n’est point ici le lieu d’examiner tous ces problèmes. Deux points cependant requièrent notre attention si nous voulons vraiment sentir tout ce que les pages, pourtant si personnelles, du livre portent en elles de réalité jadis profondément vécue : Dans quelle mesure le voyage de Platon est-il de l’histoire et non de la légende tardive ? Quel intermédiaire Platon a-t-il pu utiliser pour pénétrer les arcanes de la sagesse égyptienne ?
*
* *
Il faut bien reconnaître que toutes les sources qui nous renseignent sur le voyage de Platon en Égypte sont tardives. Strabon, Diodore, Plutarque, si bien informés soient-ils, viennent après ces siècles où l’hellénisme, déferlant sur le monde antique, avait fait miroiter les prestiges de son art et de sa pensée de l’Indus à l’Espagne et de la Chersonnèse Taurique au Soudan. Il avait retiré de son expérience du monde le sentiment de trésors accumulés dans l’ancien Orient et s’était aperçu que les gymnosophistes de l’Inde, les mages [210] de la Chaldée ou les prophètes d’Égypte possédaient une sagesse et des connaissances qui n’étaient pas à dédaigner. Or, ces idées de l’époque hellénistique, nous ne les possédons bien souvent que dans les témoignages d’écrivains postérieurs. Mais, si nous remontons un peu dans le passé, que nous est-il parvenu de la littérature philosophique grecque avant Platon ? quelques fragments qui laissent plus de place aux conjectures des érudits qu’ils ne fournissent un aliment à notre légitime curiosité. La transmission de l’œuvre de Platon, au complet et, dans l’ensemble, en bon état est un véritable miracle. Il faut donc, si nous voulons avoir quelques jalons sûrs, avancer avec une prudente critique et examiner chaque cas particulier au lieu de déclarer que les témoignages tardifs ne peuvent être pris en considération. Si nous procédions ainsi pour les présocratiques, que pourrions-nous savoir d’eux ?
Or, nous possédons les travaux d’un érudit ancien, tout à fait médiocre mais foncièrement honnête, qui, ayant fait des lectures étendues, a composé des « Vies et sentences des philosophes illustres ». Le bon Diogène Laërce n’était même pas toujours très soigneux et perdait parfois ses références, mais avec une certaine ingénuité, il ne manquait pas en recopiant ses fiches, de signaler à qui il avait emprunté sa notice. Ces procédés de l’historien sont bien connus pour que nous n’y insistions pas. Lisons donc ce qu’il nous dit du voyage de Platon en Égypte :

« Ensuite, à l’âge de vingt-huit ans, à ce que dit Hermodore, il se réfugia à Mégare auprès d’Euclide avec aussi [211] quelques autres socratiques. Ensuite, c’est à Cyrène qu’il s’en alla auprès de Théodore, le mathématicien, et, de là-bas, en Italie auprès des pythagoriciens Philolaos et Eurytos ; et de là en Égypte auprès des « prophètes » où, dit-on, Euripide aussi l’aurait accompagné. Y étant tombé malade, il fut guéri par les prêtres au moyen d’une cure d’eau de mer. C’est pourquoi aussi il dit :
« La mer lave tous les maux des hommes... »
Nous sommes sûrs d’une chose, c’est que l’ensemble de la notice a été puisé chez Hermodore qui est résumé au moins jusqu’à  en effet, introduit ou bien un « on dit », lieu commun de rhétorique, tradition incontrôlable, ou bien tout simplement, une fiche sans référence, copiée, comme elle se rapportait au voyage en Égypte, aussitôt après la mention qu’Hermodore faisait de celui-ci. En allant même plus loin, on peut conjecturer avec la plus grande vraisemblance que, terminée la petite phrase concernant Euripide, Diogène reprend le résumé d’Hermodore qui constitue sa source principale en ce passage. en effet, introduit ou bien un « on dit », lieu commun de rhétorique, tradition incontrôlable, ou bien tout simplement, une fiche sans référence, copiée, comme elle se rapportait au voyage en Égypte, aussitôt après la mention qu’Hermodore faisait de celui-ci. En allant même plus loin, on peut conjecturer avec la plus grande vraisemblance que, terminée la petite phrase concernant Euripide, Diogène reprend le résumé d’Hermodore qui constitue sa source principale en ce passage.
Une chose nous frappe immédiatement, c’est qu’Euripide n’a pu accompagner Platon en Égypte pour la raison très simple qu’il était mort en 406 et que le voyage de Platon ne peut être antérieur à 396, d’après ce que nous dit Diogène Laërce lui-même. Faut-il donc rejeter en bloc toute la notice comme entachée d’une fantaisie que trahit la chronologie déficiente ? Ce ne serait pas de bonne méthode. Ce qui est fantaisiste, c’est l’amalgame de Diogène dont la chronologie n’était pas à quelques années près. À une notice cohérente attribuée à Hermodore, il a ajouté, de son cru, un on-dit qui est une sottise. Mais le reste est-il si mauvais ?
C’est un résumé d’Hermodore de Syracuse. Or ce dernier était un des membres actifs de l’Académie qui y avait vécu au moins durant les dix dernières années du Maître. Il y enseignait sans doute comme professeur spécialisé et écrivit sur la doctrine de Platon un ouvrage [212] qui contenait beaucoup de détails biographiques puisés à la meilleure source. Les renseignements qui émanent de lui sont considérés par les historiens comme du meilleur aloi. Et ainsi, nous revoici en plein cœur de l’histoire. Ce sont des documents contemporains de Platon, bien mieux, émanant de ses disciples, qui ont établi la solide tradition de son voyage en Égypte. Point n’est besoin ici d’examiner dans le détail les autres témoignages et de montrer qu’on en peut tirer plus d’une indication précieuse. Il suffit que nous ayons mis en bonne lumière historique un fait qui nous paraît capital : le grand voyage d’un philosophe grec en un pays où il pouvait, comme en Égypte, entrer en contact avec une vieille tradition sapientiale.
*
* *
Lorsqu’on voit comment les peuples paraissant les plus reculés au monde découvrent aux investigations, pourvu qu’elles soient patientes et menées avec amour, une pensée souvent fort belle et toujours très digne d’intérêt, comment les Bantous ou les Dogons de l’Afrique noire ont laissé entrevoir des structures spirituelles et métaphysiques fortement charpentées et d’une puissance qui étonna les missionnaires et les savants, on pourrait imaginer facilement qu’un peuple, créateur d’arts plastiques aussi parfaits que ceux de l’Égypte, pouvait offrir à un philosophe observateur et chercheur comme Platon, une moisson abondante. Nous ne pouvons ici essayer de montrer la valeur de la pensée égyptienne. L’entreprise dépasserait le cadre de ces quelques pages. Mais chaque nouvelle étude qui paraît sur le sujet vient apporter une nouvelle pierre jadis arrachée à l’édifice en ruines et peu à peu nous voyons se dessiner une construction, formée par les siècles, qui ne manque ni de grandeur, ni de vérité. Sans doute, dans cette structure sociale, les génies individuels [213] tiennent moins de place qu’en notre temps. Mais la valeur de la pensée n’en est pas moins grande et plus d’une intuition métaphysique ou morale née dans les cercles sacerdotaux de l’Égypte antique, dut faire l’admiration de Platon.
Reste pourtant une autre question que nous devons au moins aborder. Comment Platon put-il avoir accès à la pensée égyptienne sans connaître la langue du pays ? qui a pu le renseigner ?
Ici encore, des travaux récents vont nous permettre de répondre. Tout d’abord la chancellerie pharaonique a, depuis fort longtemps, entretenu des interprètes. Il y en avait à la cour sous la XVIIIe dynastie pour traduire les lettres rédigées en accadien que l’on a retrouvées à Tel el Amarna et, depuis plusieurs siècles, les Grecs jouaient un tel rôle en Égypte que Psammétique, dès la fin du VIIe siècle, avait déjà, en confiant de jeunes Égyptiens aux mercenaires grecs, constitué un corps d’interprètes qui fonctionnait encore au temps d’Hérodote. Un certain nombre d’Égyptiens savaient le grec. Et pas seulement les interprètes officiels, mais aussi quelques prêtres des temples majeurs. Cela nous pouvons le conjecturer du fait que des tours syntaxiques grecs, comme le très particulier 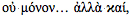 étaient passés dans la langue démotique dès l’époque des Ptolémées. Il fallait un long temps d’accoutumance et une habitude de la langue très grande, en ce temps où grammaires et dictionnaires n’existaient pas, pour que pût s’exercer cette influence du grec sur la langue égyptienne courante à ce moment. Du reste, lorsqu’un siècle et demi environ après le voyage de Platon, les prêtres se réuniront en concile à Canope, en 238, pour fêter l’anniversaire de la naissance et de la montée sur le trône de Ptolémée III Évergète, ils rédigeront en grec, en démotique et en hiéroglyphes leur décret, faisant preuve d’une grande maîtrise dans leur traduction. étaient passés dans la langue démotique dès l’époque des Ptolémées. Il fallait un long temps d’accoutumance et une habitude de la langue très grande, en ce temps où grammaires et dictionnaires n’existaient pas, pour que pût s’exercer cette influence du grec sur la langue égyptienne courante à ce moment. Du reste, lorsqu’un siècle et demi environ après le voyage de Platon, les prêtres se réuniront en concile à Canope, en 238, pour fêter l’anniversaire de la naissance et de la montée sur le trône de Ptolémée III Évergète, ils rédigeront en grec, en démotique et en hiéroglyphes leur décret, faisant preuve d’une grande maîtrise dans leur traduction.
C’est qu’au surplus, les temples possédaient des sections d’un organisme général appelé « la maison de [214] vie », commun à toute l’Égypte. Une étude récente d’une grande pénétration a réussi à nous donner une idée de ce qu’était cette institution que nous n’arrivons à connaître un peu que par des allusions éparses dans la littérature égyptienne.
Tout d’abord, c’était au sein de cette institution que s’élaboraient et se rédigeaient les écrits théologiques, c’est-à-dire toutes les compositions qui étaient apparentées, de près ou de loin, à la philosophie. La théologie était la mère de toutes les autres connaissances. C’est à cette partie de leur travail que les gens de la maison de vie liaient la rédaction des hymnes et chants sacrés qui reflètent si souvent leurs conceptions métaphysiques. C’est fort probablement là aussi que naquit le genre didactique particulièrement florissant en Egypte. L’aspect religieux de la littérature sapientiale montre qu’on ne doit guère séparer les scribes des théologiens.
C’est là encore qu’étaient composés, enseignés et conservés les livres que l’on qualifiait de magiques. Mais il faut prendre garde ici de n’être point dupe de notre vocabulaire. Ce n’est point la magie au sens péjoratif que nous entendons aujourd’hui. Comme le bwanga des Bantous, elle désigne l’ensemble des forces nécessaires à la protection de la vie et à son accroissement. A ce titre elle comprend la médecine qui peut consister en incantations et remèdes bizarres ou répugnants, mais aussi en essais parfaitement rationnels et expérimentaux pour guérir. Les deux genres étaient pratiqués dès l’époque la plus ancienne, comme nous en avons la preuve par les papyrus médicaux qui nous sont parvenus.
Le rituel lui-même n’était pas conçu autrement que comme l’entretien et le renforcement de la vie divine dans les corps terrestres des dieux. C’est la reproduction en notre monde des soins que les dieux reçoivent dans leur monde à eux. À ce titre, il appartenait aussi à la maison de vie et pouvait pencher vers une magie déconcertante ou arriver à traduire en de très beaux symboles [215] les conceptions théologiques les plus élevées des penseurs égyptiens.
Bien plus, les artistes faisaient partie de la maison de vie. Plus que d’autres encore, ils devaient être soumis aux règlements minutieux établis par ceux qui avaient étudié à fond les choses divines. Ne tenaient-ils pas dans leurs mains, grâce au prestige de leur art, la possibilité de créer des êtres nouveaux, comme la divinité ? Construisant un temple les architectes devaient en faire une image symbolique du monde que la divinité avait créé et sur lequel elle régnait. Le pouvaient-ils inventer ou représenter à leur guise ? Ne trahiraient-ils pas les intentions du Créateur et les besoins du culte ? Les peintres et les sculpteurs, eux, créaient des corps nouveaux aux dieux et aux hommes. C’était une véritable « mise au monde » qu’ils exécutaient en sculptant les « images vivantes » et les « répliques » qu’étaient leurs statues. Aussi devaient-ils se conformer aux textes sacrés dans lesquels, de toute antiquité, le sage dieu Thot avait consigné les règles de la création artistique. Et, bien souvent, les récits égyptiens font allusion à cette recherche des rois pieux et savants qui fouillent la maison de vie et finissent par retourner à sa source, à Héliopolis, pour y découvrir la véritable forme des dieux, telle qu’elle avait été déterminée aux temps primordiaux.
L’Astronomie et les Mathématiques, indispensables servantes de qui doit connaître l’univers et le temps précis et de qui veut calculer les proportions exactes pour donner aux monuments et aux objets une parfaite conformité avec le réel, y étaient aussi cultivées.
Ce tableau rapide qui laisse encore dans l’ombre l’organisation et la composition de cette sorte d’Université, comme on l’a appelée, permet d’imaginer qu’à l’ombre d’un seul grand temple, Platon pouvait trouver avec qui s’entretenir et que l’amitié et le commerce des sages recommandés par Socrate, pouvait germer et fleurir aux pieds des grands obélisques et près du lac sacré dans l’eau calme duquel se reflétait l’éclat du soleil levant. [216] Sans doute des vaniteux, des charlatans et de piètres esprits faisaient aussi partie du personnel sacerdotal d’Héliopolis aux environs de 390 avant notre ère, comme il s’en trouve dans nos sociétés savantes actuelles, laïques ou religieuses. Mais comment Platon parmi eux n’eût-il pas rencontré quelque âme élevée avec laquelle il pût se lier ? Cette âme que le docteur Godel évoque à plusieurs reprises, le descendant de Solon dut la trouver. Que ce fût à Héliopolis, à Hermopolis magna ou à Saïs, le pays qui nous a livré tant de remarquables productions intellectuelles, reflets d’une réflexion profonde, devait encore posséder des sages. L’Hellade du Ve siècle, alors que la civilisation qu’elle avait créée s’effondrait lentement, avait cependant des Proclus et des Olympiodore qui eussent pu commenter Platon à un étranger. Pour vivre encore cinq à six siècles, la vieille vision du monde qu’avait créée l’Égypte devait être comprise et interprétée correctement par ceux à qui le soin avait été commis de la conserver et de la parfaire et il aurait fallu un œil très averti, au début du IVe siècle, pour discerner que cette culture éclatante, vivant seulement sur l’acquis, n’était plus créatrice et marchait à un irrémédiable déclin.
Ce fut une part du génie de la Grèce d’avoir su recueillir, sur les fleurs épanouies mais fragiles de cette plante millénaire, le miel impérissable dont elle devait nous transmettre le goût. Sa tradition ininterrompue nous a conservé l’essence même de ce que l’Égypte et, au-delà, l’Orient ancien, lui avait donné. C’est le grec qui nous permit de retrouver la clef de l’ancien égyptien. Et maintenant que des paysages nouveaux se découvrent pour nous par-delà les horizons des Cyclades, nous plongeons dans les millénaires, nous retrouvons dans la mémoire de l’humanité des souvenirs perdus depuis deux mille ans qui, nous permettant de mieux nous connaître, nous donneront peut-être la force de nous conduire mieux.
Accompagnant Platon à son retour d’Héliopolis, la [217] méditation du docteur Godel nous permet de voir ce qu’ont d’éternellement présent et d’éternellement vrai les images lumineuses de la chevauchée céleste des âmes vers le zénith, vers le lieu où les dieux vivent de vérité et de justice. Par-delà les formulations et les vêtements qu’on lui donne, la pensée continue sa marche et l’ensemble des points sur lesquels nous la saisissons, forme une ligne, une direction qui pointe vers la lumière. C’est alors que la recherche historique conduit vraiment à la clarté. Si elle n’arrivait point à être autre chose qu’un long tâtonnement dans l’incertitude de la nuit, elle ne vaudrait pas une heure de peine.
Castelnau-le-Lez, le 18 août 1955.
[218]
|

