[7]
DE L’ÊTRE
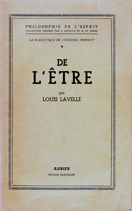 INTRODUCTION INTRODUCTION
À LA DIALECTIQUE
DE L’ÉTERNEL PRÉSENT
[8]
[9]
Lorsque nous avons fait paraître en 1928 la première édition de ce livre, nous avions déjà publié deux ouvrages : La Dialectique du monde sensible et La Perception visuelle de la profondeur, qui avaient été présentés comme thèses de doctorat, et dont le premier avait été composé dans la solitude de la captivité au camp de Giessen en Allemagne, de 1916 à 1918. Mais ces deux livres étaient loin d’exprimer les premières démarches d’une pensée destinée ensuite à s’élargir ; car celle-ci demeurait attachée depuis longtemps à la considération de l’immédiation entre le moi et l’être, c’est-à-dire de ce pouvoir que j’ai de dire moi, ou de prendre contact avec l’être dans ma propre participation à l’être : là a toujours été pour nous l’expérience primitive que toutes les autres spécifient.
Et que l’on nous permette de dire que, bien avant que le mot de philosophie eût un sens pour nous, nous pouvons évoquer deux émotions de notre tout jeune âge qui n’ont cessé d’accompagner pour nous la conscience même de la vie, et dont aucune autre n’est venue ternir la fraîcheur : la première, issue de la découverte de ce miracle permanent de l’initiative par laquelle je peux toujours introduire quelque nouveau changement dans le monde, par exemple remuer le petit doigt, et dont le mystère réside moins encore dans le mouvement que je produis que dans ce fiat tout intérieur qui me permet de le produire, et la seconde de la découverte de cette présence toujours actuelle dont je ne réussis jamais à m’évader, dont la pensée de l’avenir ou celle du passé tentent vainement de me divertir, de telle sorte que le temps lui-même, loin de faire de ma vie une oscillation indéfinie entre le néant et l’être, me permet seulement, grâce à une relation entre les formes différentes de la présence dont ma liberté est l’arbitre, de constituer dans l’être un être qui est le mien.
Cependant, avant que ces thèmes pussent être approfondis, [10] les loisirs de la captivité nous avaient conduit à nous demander, dans une sorte de parenthèse, mais où nous devions trouver une contre-épreuve de ces deux intuitions fondamentales, ce que pouvait devenir le monde des choses et comment pouvaient apparaître la qualité et l’ensemble des données sensibles si l’être n’était rien de plus qu’un acte qui ne devenait notre être propre que par une démarche de participation. C’est ainsi que nous avions été conduit à montrer que les différents sensibles limitent et achèvent les différentes opérations par lesquelles se réalise notre propre participation à l’être, et que la vue jouit dans la représentation du monde d’un privilège évident, puisque, bien qu’elle m’oblige à percevoir l’objet dans son rapport avec moi, c’est-à-dire comme phénomène, elle le détache pourtant du moi en lui donnant une sorte d’indépendance apparente, grâce précisément à la profondeur.
Mais il fallait ensuite essayer d’appréhender la notion de l’Être dans son extrême pureté au risque d’être accusé de ne plus saisir que le vide d’une abstraction, là où précisément on aspirait à décrire la genèse concrète de notre existence elle-même. Telle était la tâche à laquelle nous nous sommes consacré d’abord. Cependant cette étude de l’être n’était à son tour que le premier moment d’une entreprise plus vaste à laquelle nous donnions déjà le nom de Dialectique de l’Éternel Présent et qui devait elle-même comprendre cinq volumes : de l’Être, de l’Acte, du Temps, de l’Ame et de la Sagesse, dont les trois premiers ont déjà paru, dont les deux derniers sont encore sur le chantier. Mais au moment où l’on nous demande de rééditer ce petit livre de l’Être par lequel une telle dialectique était inaugurée, il peut être utile de confronter les principes qu’il avait posés et qui, dans leur sobriété presque excessive, ne pouvaient manquer de produire certains malentendus, avec les développements qu’ils ont reçus ultérieurement et qui peuvent servir à en justifier la signification et à en montrer la fécondité. Peut-être même nous saura-t-on gré de définir leur relation avec les thèmes fondamentaux de cette philosophie de l’existence qui est accueillie avec tant de faveur par la conscience contemporaine et qui en exprime si fidèlement l’état de crise.
[11]
I
Introduire de nouveau le problème de l’Être dans la philosophie pouvait apparaître il y a une vingtaine d’années comme une sorte de paradoxe : il n’y avait pas de notion qui fût alors plus décriée, il n’y en a pas qui nous soit devenue plus familière. Mais on nous avait habitué à un ascétisme intellectuel qui faisait de l’être tantôt une notion vide et tantôt un objet hors d’atteinte. Le positivisme et le kantisme avaient triomphé : nous ne pouvions rien espérer connaître de plus que les phénomènes, leur mode de coordination, ou les conditions logiques qui nous permettent de les penser. Fallait-il se résigner à dire que les phénomènes se suffisent à eux-mêmes et qu’ils ne sont les phénomènes de rien ? Ou qu’il y a derrière eux une chose inaccessible et qui sera à jamais pour nous comme si elle n’était rien ? Le positivisme est une sorte de synthèse objective du savoir qui demeure muette sur la possibilité à la fois du savoir et de cette réalité dont il est le savoir. Et, dans le kantisme, le savoir lui-même dont on prétend nous expliquer la formation nous laisse cependant étranger à l’être : il est le produit d’une union mystérieuse entre une activité purement formelle, qui est celle de l’entendement, et une matière purement subjective que la sensibilité ne cesse de nous fournir ; et si l’être véritable se révèle à nous dans l’acte moral, encore ne réussit-on pas à montrer comment cet acte même suppose comme sa condition ou comme son effet l’opposition de cette forme et de cette matière dont notre expérience est précisément la synthèse.
Ce livre exprimait par conséquent une réaction contre le subjectivisme phénoméniste à l’intérieur duquel la philosophie avait fini par nous enfermer. Pourquoi en effet fallait-il, ou bien nier l’être, ou bien affirmer qu’il était au delà de tout ce qui pouvait nous être donné, alors qu’il y avait pourtant un être du donné et que, dans sa nature propre de donné, il portait en lui le même caractère de l’être qui appartenait à ce non-donné auquel on voulait le réduire, mais que l’on ne pouvait concevoir à son tour que comme un donné possible ? [12] Il y a plus : nous ne pouvions faire autrement que d’attribuer l’être à la fois au sujet et au phénomène et même de les considérer l’un et l’autre comme des aspects de l’être obtenus seulement par l’analyse. Que le sujet lui-même fût l’auteur de cette analyse, cela ne pouvait empêcher de le considérer aussi comme en étant le premier objet au sein d’une réalité infinie qui le dépassait de toutes parts et à laquelle il ne réussissait jamais à être co-extensif. Et qu’aucun des modes de cette réalité ne pût lui apparaître autrement que dans ses rapports avec lui, cela ne réussissait point à prouver que c’étaient là autant de modes de son propre moi, puisque ce moi lui-même se définissait au contraire par opposition avec eux. Car le moi ne peut se poser autrement qu’en posant le tout de l’être, de telle sorte que ce tout de l’être est non pas postérieur à la position du moi par lui-même, mais supposé et impliqué par elle comme la condition de sa propre possibilité. C’est une présence à laquelle je participe ; et même on peut dire que je découvre la présence toute pure, qui est la présence de l’être au moi, avant de découvrir la présence subjective, qui est la présence du moi à l’être. Celle-ci apparaît comme étant un effet de la réflexion ; c’est elle qui me permettra de pénétrer dans l’intimité même de cet être qui n’était d’abord pour moi que l’immensité d’une chose. Ainsi je pourrai distinguer des formes différentes de l’être, chercher quelles sont leurs relations et l’origine même de ces différences et de ces relations. Je ne m’évade jamais de l’être ; et il est contradictoire que je puisse le nier, puisque je pose, en le niant, mon être qui le nie. Imaginer qu’il n’y a rien, c’est substituer au monde son image qui n’est pas rien ; vouloir se placer avant la naissance de l’être ou après son abolition, c’est le penser encore soit comme une possibilité, soit comme un souvenir ; et me refouler moi-même dans le néant où j’ensevelis tout ce qui est, c’est supposer qu’il existe quelqu’un qui en juge et m’ériger moi-même en témoin de son existence idéale. Toutes les formes particulières de l’être peuvent disparaître : on a montré justement que poser le néant, c’est étendre au tout, par une extrapolation illégitime, ce qui ne convient qu’à la partie et que la destruction de la partie comme telle, c’est toujours son remplacement par un autre. [13] Il y a plus : une telle opération ne saurait dans aucun cas entamer l’être même qui la fait ; et ceux qui voudraient faire la place la plus grande au néant ne réussissent à le poser que par un acte de néantisation qui non seulement suppose l’être qu’il néantit, mais encore, en tant qu’il est constitutif de la conscience, lui donne à elle-même son être idéal (ou spirituel) [1].
Ce que nous voulions démontrer par cette critique, c’est donc que nous sommes de plain-pied avec l’Être, qu’il est vain de vouloir définir le sujet, comme on le fait presque toujours, en disant qu’il se constitue soit en se séparant de l’être, soit par une quête de l’être : car, d’une part, cette séparation, même si elle était possible, ferait de lui seulement un être séparé, bien qu’elle consistât plutôt dans un privilège accordé à cette forme de l’être qui est moi en tant qu’elle peut servir de repère à toutes les autres ; et, d’autre part, cette quête de l’être n’est pas étrangère à l’être, car il y a un être de la quête elle-même qui nous permet seulement de mesurer la distance entre l’être qui dit moi et le tout dont il participe. Il est donc impossible d’imaginer que je ne sois pas de niveau avec l’Être. Je ne m’en détache qu’afin de fixer mes propres limites que j’entreprends toujours de dépasser. Et bien que je lui sois toujours uni de fait, je cherche à faire de cette union un acte subjectif qui fonde et édifie l’être qui est mon être.
C’est donc une même chose d’exclure le néant et d’affirmer l’universalité de l’être. On a confondu quelquefois le néant avec l’être pur, c’est-à-dire avec l’être privé de toute détermination. Mais la simplicité du mot être ne doit pas nous abuser, car l’être pur, c’est non pas sans doute le total, mais [14] la source de toutes les déterminations que l’on obtient non pas en y ajoutant, mais en le divisant, en actualisant séparément toutes les puissances qu’il recèle. Quant à l’universalité de l’être, elle éclate dès que l’on aperçoit qu’il est impossible de rien poser autrement qu’en posant l’être même de ce que l’on pose, de telle sorte que la nature même de ce que l’on pose n’est précisément, à l’égard de l’être, qu’une de ses déterminations possibles parmi une infinité d’autres.
On rencontrera plus de difficultés à admettre l’univocité de l’être ; et la résurrection de ce mot emprunté au Moyen Age a montré que la querelle qui opposait les scotistes aux thomistes n’est pas encore éteinte. Pourtant l’universalité et l’univocité ne sont que les deux expressions qui définissent l’unité de l’être quand on le considère tour à tour au point de vue de l’extension et au point de vue de la compréhension. Mais quel paradoxe malgré tout de dire qu’il n’y a pas de degrés de l’être, que c’est le même être qui est dit du tout et de la partie, de l’âme et du corps, d’un songe et d’un événement, de l’idée et de la chose, de l’action spirituelle la plus pure et de la vapeur la plus fugitive ! Cependant, outre que le paradoxe serait peut-être d’introduire le plus et le moins au cœur de l’être lui-même et non pas seulement dans ses déterminations, il importe de remarquer que l’échelle de l’être serait toujours une échelle entre l’être et le néant, alors qu’entre ces deux termes il n’y a point d’intermédiaire. C’est un infini qui les sépare : aussi de chaque chose faut-il dire qu’elle est ou qu’elle n’est pas ; et encore dire qu’elle n’est pas, c’est dire qu’elle n’est pas ce qu’on croit qu’elle était et qu’elle est autre chose. Mais l’être, c’est toujours l’être absolu ; il n’y a rien au-dessous de lui, il n’y a rien au-dessus. Il n’y a pas en particulier derrière lui de principe plus haut qui le fonde, par exemple le possible ou la valeur, car de ces principes mêmes il faudrait dire qu’ils sont (bien que d’une autre manière que l’être tel qu’il nous est donné dans une expérience sensible). S’ils n’étaient pas, quelle efficacité pourrait-on leur prêter ? Comment pourrait-on en avoir l’idée, ou seulement les nommer ? Ainsi nous sommes astreints à considérer toute raison d’être comme intérieure à l’être, ou bien encore, dès que nous cherchons à justifier l’être comme [15] nous justifions les existences particulières, à dire qu’il est lui-même sa propre justification.
Mais on objectera peut-être que l’univocité ne pourrait être maintenue qu’en faisant de l’être, contrairement à notre dessein, la plus abstraite des notions et telle qu’en exprimant seulement la position de tout ce qui peut être, elle resterait étrangère au contenu de ce qui est. Cependant on ne négligera pas la valeur ontologique de cet acte de position sans lequel rien ne pourrait être posé et qui, loin d’être indifférent à ce qu’il pose, en est l’essence constitutive. Ensuite, on n’oubliera pas que l’être d’une chose n’est pas distinct de cette chose, mais qu’il est cette chose elle-même considérée, si l’on peut dire, dans la totalité actuelle de ses attributs. Ce n’est pas tout encore : car cette chose ne peut être isolée, circonscrite dans des frontières susceptibles de définir son être séparé, en tant qu’il est véritablement indépendant de tous les autres. Car elle est suspendue dans le tout par des relations qui l’unissent à toutes les parties du tout. Ainsi l’être qui lui est propre réside dans ses relations avec le tout ; c’est son inscription dans le tout ou son appartenance au tout qui donne l’être à chaque chose, si misérable qu’elle puisse être. Tel est le sens véritable de l’univocité dont on voit qu’elle réside moins dans un caractère unique, présent dans chacun des modes de l’être, que dans l’unité concrète de l’être dont ils sont tous un aspect et sans laquelle aucun d’eux ne serait capable de subsister. De là le prestige incomparable de la notion de relation qui n’exprime rien de plus dans le langage de la gnoséologie que l’identité de l’être et du tout dans le langage de l’ontologie.
On comprend dès lors comment la notion d’être est antérieure non pas seulement à la distinction du sujet et de l’objet, mais encore à la distinction de l’essence et de l’existence et contient en elle ces deux couples d’opposés. Car le sujet et l’objet se distinguent de l’être à partir du moment où le moi se constitue comme un centre de référence auquel le tout peut être rapporté comme un spectacle. Et la distinction de l’essence et de l’existence naît dans le moi dès qu’il fait de l’être tout entier un être de pensée dans lequel il actualise cette forme d’être qui sera lui-même.
[16]
Cependant l’univocité de l’être ne porte aucune atteinte, comme on le pense, à l’analogie de l’être, bien que ces deux termes aient été opposés avec beaucoup de vigueur. Et même les deux notions s’appellent au lieu de s’exclure. Ce sont deux perspectives différentes et complémentaires sur l’être dont la première considère son unité omniprésente et la seconde ses modes différenciés. Ceux-ci ne méritent le nom d’être que par l’être même que le tout leur donne, mais chacun l’exprime à sa manière et de telle sorte que, si l’on considère son contenu, il y a toujours une correspondance entre la partie et le tout dont la correspondance entre les parties est le corollaire. C’est cette double correspondance qui est l’objet propre de la philosophie et qui permet de considérer l’être et la relation comme deux termes inséparables.
II
Cependant la description qui précède a besoin d’être approfondie. Aussi longtemps que l’on ne dépasse pas la notion d’être, il nous semble, tant nous sommes habitués à considérer toute réalité comme affectant la forme d’une chose, qu’il y ait un primat de l’objectivité sur la subjectivité. Et si nous nous bornons à montrer que l’être que nous saisissons, c’est un être qui nous est propre en tant qu’il implique un être qui nous dépasse et dans lequel il est pour ainsi dire situé, nous continuons obscurément à considérer cet être qui nous est propre comme un corps qui occupe une place déterminée dans l’infinité de l’espace. Mais ce n’est là qu’une image qu’il faut interpréter. Il importe de montrer maintenant que l’être est acte, comment toute description est une genèse et pourquoi la relation elle-même ne prend sa véritable signification que si elle se change en participation.
Or, il est facile de voir que rien de ce qui est objet ou chose n’a de sens autrement que par rapport à un sujet qui le pense comme extérieur à lui, bien qu’il ne soit actualisé que par lui, ce qui est justement le sens que nous donnons au mot apparence ou phénomène. Quant à ce sujet lui-même, il réside dans l’acte intérieur qu’il accomplit et que l’on ne [17] peut pas réduire à la pensée d’un objet ou d’une chose, car le propre de cet acte, c’est d’engager l’existence même du moi, c’est de la faire être dans une opération qu’il lui faut accomplir et sans laquelle il ne serait rien, par laquelle il dispose du oui et du non, que l’on peut définir comme étant sa liberté, qui fait de lui à chaque instant le premier commencement de lui-même, et porte le nom de pensée dès qu’elle s’applique à quelque objet pour se le représenter et le nom de volonté dès qu’elle s’applique à lui pour le modifier. Encore est-il vrai que cet objet ne cesse de le dépasser et que le moi ne réussit jamais à le réduire à sa propre opération, qui, dans l’ordre intellectuel, garde toujours un contenu perceptif ou conceptuel et, dans l’ordre volontaire, ne parvient jamais à pousser la modification jusqu’à l’infini, c’est-à-dire à en faire une création.
Cet acte intérieur est inséparable à la fois de l’initiative qui le met en jeu et de la conscience qui l’éclaire. C’est là seulement où il s’exerce que nous pouvons dire moi. Il est notre être même au point où il se fonde sans qu’il nous soit possible de le récuser. Il est véritablement un absolu qui n’est l’apparence ou le phénomène de rien. Son essence est de se produire lui-même avant de produire aucun effet, qui doit être considéré comme extérieur à lui et comme étant la marque à la fois de sa manifestation et de sa limitation, bien plutôt que de sa puissance et de sa fécondité. Et la philosophie commence là où précisément l’être cesse d’être confondu avec l’objet, mais s’identifie avec cet acte intérieur et invisible et qui est tel qu’il faut seulement l’accomplir pour qu’il soit.
On voit dès lors l’absurdité qu’il y aurait à vouloir que cet acte constitutif du moi fût lui-même situé dans un monde formé seulement d’objets et de phénomènes. Les objets ou les phénomènes sont les marques propres de sa limitation, qu’il ne cesse lui-même d’éprouver : mais ils n’expriment pas seulement cette limitation ou, du moins, ils l’expriment en lui apportant aussi, sous la forme de données qu’il est obligé de recevoir ou de subir, tout ce qui lui manque et qui lui fait croire que sans elles il ne posséderait rien : d’où il conclut facilement que sans elles il ne serait rien. Cependant la limitation du moi lui est, en un certain sens, intérieure. Ou encore [18] le moi n’est pas intériorité pure ; en lui l’intériorité est toujours liée à l’extériorité : il a un corps, il y a pour lui un monde. Quelle que soit en lui la puissance d’abstraction ou de méditation, son intériorité ne peut jamais être ni parfaite, ni séparée. Elle s’ouvre devant lui comme un infini auquel le moi ne réussit jamais à s’égaler. On comprend alors que la passivité puisse reculer en nous sans jamais s’abolir. Notre acte peut toujours devenir plus pur. Ainsi l’expérience intérieure que nous prenons de nous-même et qui est inséparable de l’expérience de nos limites, n’appelle pas seulement une extériorité qui les exprime, mais une intériorité qui les fonde et dans laquelle nous pouvons pénétrer toujours plus profondément. Et il est bien remarquable que le moi puisse penser à s’accroître tantôt en exerçant une domination de plus en plus étendue sur le monde des objets et tantôt au contraire en se repliant toujours davantage sur le monde secret où il trouve l’origine et la signification de son existence manifestée.
Le moi se découvre lui-même dans l’acte de la pensée, c’est-à-dire dans la participation à un univers de pensée qui dépasse singulièrement sa pensée actuelle et exercée. Il implique l’affirmation non seulement de l’universalité de la pensée dont il participe, mais de l’universalité de l’être dont sa pensée le rend participant. Par conséquent on peut dire que je ne puis saisir ma propre intériorité comme imparfaite que par la limitation et la participation d’une intériorité parfaite qui est première par rapport à elle, ou que l’acte que j’accomplis (dont l’imperfection s’exprime peut-être par le fait qu’il ne peut être qu’un acte de consentement ou de refus) est inséparable d’un acte sans passivité dont il est lui-même la limitation et la participation.
On demandera maintenant quel est le sens de cette subjectivité qui dépasse ma subjectivité propre, de cette intériorité qui est au delà de l’intériorité du moi, de cet acte qui transcende l’acte que j’accomplis. Toutefois il n’y a sans doute aucune contradiction à admettre que le moi soit débordé vers le dedans aussi bien que vers le dehors, puisqu’il est précisément la relation qui les unit et que peut-être même le dehors n’est rien de plus que le dedans même, en tant que le moi le subit au lieu d’y pénétrer. De plus, on demandera comment [19] pourrait se produire le progrès dans le sens de l’intériorité autrement que par une intériorité absolue qu’il faut définir non pas objectivement comme un univers réalisé, mais subjectivement comme le moteur suprême de tous les mouvements par lesquels nous sommes capables de nous intérioriser toujours davantage. Enfin cette découverte initiale qui est la découverte de la présence du moi dans l’être et que nous définissons comme une expérience de participation permet de donner un sens aux deux mots de transcendant et d’immanent, de comprendre pourquoi ils sont pour nous comme deux contraires, mais qui s’opposent au point même où ils se rejoignent. Car le transcendant, c’est cela même qui me dépasse toujours, mais où je ne cesse jamais de puiser, et l’immanent c’est cela même que j’ai réussi à y puiser et que je finis par considérer comme mien en oubliant la source même d’où il ne cesse de jaillir. La doctrine de la participation, c’est en effet celle d’un être-source et dont il faut dire que je ne le saisis que dans ses effets, bien que ces effets mêmes soient pour moi comme rien si je ne retrouve pas en eux le goût de la source.
Ce serait une erreur grave sur la participation que de penser que l’être dont je participe par un acte puisse être lui-même autre chose qu’un acte. Mais on élèvera des difficultés contre la possibilité même de cette participation d’un acte par un acte, là où précisément le propre de l’acte, c’est, semble-t-il, de fonder la séparation, l’indépendance et même la suffisance de l’être qui l’accomplit. Toutefois, s’il y a une expérience reconnue et pour ainsi dire populaire de la participation, si le mot même a un sens et désigne une sortie de soi par laquelle chacun éprouve la présence d’une réalité qui le dépasse, mais qu’il est capable de faire sienne, cette participation, qui est toujours active ou affective, et active jusque dans l’affection qu’elle produit, est aussi une coopération, c’est-à-dire non point une opération répétée et imitée, mais une action commune, et dont chacun prend sa part ou qu’il consent à assumer. A mon égard et aussi longtemps que je ne l’accomplis pas, une telle action n’est rien de plus qu’une puissance pure : mais comment pourrais-je la mettre en œuvre et en faire un facteur de communion avec autrui, si [20] elle n’impliquait pas au-dessus de lui et de moi comme une efficacité toujours disponible et qui, selon la manière dont nous lui livrons ou lui refusons passage, nous sépare ou nous unit ? Aussi faut-il dire que nous ne participons jamais à l’existence des choses, mais seulement à la vie des personnes, ou à l’existence des choses dans la mesure où elle est pour la vie même des personnes un moyen de communication chargé de signification spirituelle, et à la vie des personnes dans la mesure où elle suppose entre celles-ci et nous une communauté d’origine et de fin.
Il y a plus : il ne peut y avoir de participation qu’à un acte qui n’est pas nôtre, et que nous ne parvenons jamais à faire tout à fait nôtre. C’est donc elle qui fonde à la fois notre indépendance et notre subordination à l’égard de tout ce qui est. Notre indépendance réside dans cet acte même à proportion du pouvoir que nous avons précisément de le faire nôtre, notre subordination dans la distance qui nous en sépare et qui s’exprime par tout ce que nous sommes obligés de subir.
Si d’un tel acte on prétend que nous ne pouvons rien dire, sinon précisément dans la mesure où nous l’accomplissons, et qu’il nous enferme dans nos propres limites, on répondra non seulement que tout acte apparaît comme un dépassement, et que l’expérience que nous avons de ses limites, c’est précisément l’expérience de tout ce qui en nous présente un caractère de passivité, mais encore que tout acte qui s’exerce en nous est l’actualisation d’une possibilité et que toute possibilité est pour nous inséparable du tout de la possibilité. Or, il y a entre le tout de la possibilité et la possibilité que nous actualisons comme nôtre une relation qui, dans le monde intérieur, n’est pas sans rapport avec la relation que nous établissons dans le monde extérieur entre le corps qui nous affecte et que nous sentons comme nôtre et la totalité des corps qui remplissent l’espace et qui ne sont à notre égard que de simples représentations. L’analogie est ici si profonde que, par comparaison à notre propre corps, les représentations se réduisent pour nous à des actions possibles. Nous vivons donc dans un monde de possibles. Et ces possibles ne sont pas inventés par nous ; ils nous dépassent, ils s’imposent à nous ; c’est en eux que nous constituons ce [21] que nous sommes et jusque là ils ne sont pour nous que de simples objets de pensée.
Cependant le mot de possible n’a de sens, ou du moins il ne s’oppose à l’être, que lorsqu’il s’agit de cet être que nous actualisons par une opération qui est nôtre. En lui-même il est un être, et en disant qu’il est un être de pensée nous marquons assez nettement qu’il est un être spirituel qui ne s’est pas encore incarné. Les possibles, il est vrai, ne se présentent jamais à nous que sous une forme séparée ; ils sont en tant que possibles le produit même de cette séparation qui est à son tour la condition de la participation ; entre tous ces possibles, il nous appartiendra de choisir celui qui s’accomplira en nous. Mais le tout de la possibilité n’est plus un possible : c’est l’être même considéré comme participable et non plus comme participé. En soi, il n’est plus ni participé, ni participable ; il est l’absolu considéré comme un acte sans passivité, à l’intérieur duquel toute existence particulière se constitue elle-même par une double opposition, d’une part, entre la possibilité qui la dépasse et l’opération qu’elle accomplit et, d’autre part, entre cette opération elle-même et la donnée qui lui répond. Et c’est à l’absolu que le sujet emprunte par analyse non seulement la possibilité, telle qu’il la conçoit d’abord par son entendement avant de l’actualiser par sa volonté, mais encore la force même de l’actualiser. La dissociation entre l’entendement et la volonté est la condition à la fois de la naissance de la conscience et de l’exercice de la liberté. On ne manquera pas toutefois de remarquer que la possibilité, loin d’entrer avec l’être dans une relation d’opposition, comme on le croit presque toujours, exprime seulement une relation entre deux aspects de l’être, ici entre le tout de l’être et une existence particulière. Mais cette relation est susceptible d’être renversée, car si le tout de l’être n’est qu’une possibilité infinie à l’égard de toute existence particulière qui ne parvient jamais à l’actualiser, ce sont les existences particulières qui, à l’égard du tout de l’être où elles s’actualisent, ne sont plus, comme le montre le rôle joué en elles par le temps et par le désir, que des possibilités toujours remises sur le métier. Il est remarquable enfin que la théologie puisse dire de Dieu à la fois qu’il est l’être de tous les [22] êtres (vers lequel chaque être tend pour s’accomplir) et qu’il est aussi le tout-puissant, comme si la puissance était au-dessus de l’existence qui l’actualise à notre niveau.
Il importe cependant encore de répondre à une triple objection, car :
- 1° on peut alléguer que l’acte pur ou absolu doit posséder une suffisance parfaite et que l’on voit mal comment il aura besoin de créer, même si cette création consiste uniquement à communiquer son être même ou à le faire participer par d’autres êtres. Mais peut-être faut-il dire précisément que la suffisance parfaite consiste non pas dans une fermeture sur soi, mais dans cette puissance infinie de créer, c’est-à-dire de se donner, là où le propre de la créature en tant qu’elle est passive et imparfaite est toujours de recevoir. Ce que l’on vérifierait peut-être dans les rapports que les hommes ont les uns avec les autres, et où les lois de l’activité spirituelle trouvent encore une application imparfaite et approchée.
- 2° On nous dira aussi que nous ne savons rien de ces rapports dont nous parlons toujours entre Dieu et les créatures, qu’il y a là une hypothèse invérifiable, et que toute dialectique descendante est par conséquent impossible. Mais la réplique sera que l’origine de toute dialectique, c’est l’expérience de la participation où nous saisissons le rapport vivant de notre être propre et de ce qui le dépasse, non point comme un pur au-delà dont on ne peut rien dire, mais comme une présence où nous puisons sans cesse et qui ne cesse de nous enrichir.
- 3° Et on répondra facilement au reproche de panthéisme en montrant que Dieu ne peut communiquer à un autre être que l’être même qui lui est propre, c’est-à-dire un être qui est causa sui, de telle sorte que tout rapport que nous avons avec lui nous libère, comme tout rapport que nous avons avec la nature nous asservit, ou encore qu’il ne crée lui-même que des libertés, le monde étant l’instrument de cette création plutôt qu’il n’en est l’objet.
[23]
III
Si l’expérience initiale est l’expérience de la participation par laquelle le moi constitue l’existence qui lui est propre, on comprend sans peine qu’elle s’oriente en deux sens différents ou qu’elle comporte deux extrémités entre lesquelles elle ne cesse d’osciller et dont aucune ne peut être considérée isolément. L’une est celle de l’acte pur, ou de l’acte qui n’est qu’acte (et que l’on retrouve sous une forme moins dépouillée dans les expressions de puissance créatrice ou même d’élan vital et d’énergie cosmique, mais à laquelle il faut maintenir une intériorité spirituelle absolue pour la mettre au-dessus de toute limitation et par conséquent de toute passivité et de toute donnée) et l’autre est formée par le monde, où l’infinité de l’acte accuse encore sa présence par cette infinité de choses et d’états qui semblent naître de la participation elle-même et qui traduisent indivisiblement à la fois en nous et hors de nous ce qui la dépasse et ce qui lui répond [2].
Nous dirons du monde qu’il remplit l’intervalle qui sépare l’acte pur de l’acte de participation. C’est pour cela que ce monde est un monde donné, mais c’est pour cela aussi que sa richesse est inépuisable. Et loin de penser qu’à mesure que l’activité intérieure se développe davantage, elle fait reculer la représentation que nous avons de l’univers extérieur et tend à la dissoudre, il faut dire au contraire que le propre de cette activité intérieure, c’est de multiplier à l’infini les distinctions qualitatives que nous pouvons établir entre les choses, de telle sorte que le monde, qui apparaît comme une masse confuse à la conscience naissante, découvre à une conscience plus délicate et plus complexe une variété d’aspects de plus en plus grande. Il est vrai que tous ces aspects du donné, l’intelligence, à mesure qu’elle croît, tentera de les couvrir d’un réseau de plus en plus serré de relations conceptuelles, [24] que l’art cherchera en eux l’expression des exigences les plus raffinées de la sensibilité, que la volonté en fera le véhicule de plus en plus docile de tous les actes par lesquels elle cherchera à obtenir une communion avec les autres volontés.
Cependant la question est d’abord de savoir comment s’exerce cette liberté par laquelle le moi pose son existence propre comme une existence dont il est l’auteur. Or, si toutes les libertés puisent dans le même acte dont elles participent l’initiative même qui les fait être, il faut à la fois qu’elles lui demeurent unies et qu’elles s’en détachent, c’est-à-dire que leur coïncidence actuelle avec l’être ne cesse jamais de s’affirmer et qu’elles puissent constituer pourtant en lui un être qu’elles ne cessent elles-mêmes de se donner. Cette double condition se trouve réalisée précisément à l’intérieur du présent, qui est une présence totale, c’est-à-dire la présence même de l’être, et qui est telle que nous pouvons distinguer en elle des modes différents et, par les relations que nous établirons entre eux, constituer précisément l’être qui nous est propre. Mais cette relation entre les différents modes de la présence, c’est le temps, où nous distinguons d’abord une présence possible ou imaginée, c’est-à-dire que nous n’avons pas encore faite nôtre, mais qui le deviendra par une action qu’il dépend de nous d’accomplir (cette présence, c’est l’avenir) ; qui est appelée elle-même à se convertir en une présence actuelle ou donnée dans laquelle notre existence et notre responsabilité se trouvent engagées à l’égard de l’ensemble du monde (c’est la présence dans l’instant) ; qui se convertit à son tour en une présence remémorée ou spirituelle (c’est la présence du passé) qui constitue notre secret, qui n’a de sens que pour nous, et qui est proprement tout ce que nous sommes.
La liaison de l’avenir et du possible justifie le caractère indéterminé à la fois de l’un et de l’autre : mais il n’y a de possibilité qu’à partir de la participation, soit que nous considérions celle-ci comme une analyse de l’être imparticipé, et plus précisément comme un acte de pensée destiné à anticiper un acte du vouloir, soit que nous considérions dans chaque possible l’accord dont il doit témoigner à la fois avec les autres possibles et avec leurs formes déjà réalisées, afin [25] que l’unité de l’être ne soit pas rompue. — La liaison de l’existence avec le présent accuse d’une part l’impossibilité de ne point considérer comme actuel tout acte s’accomplissant soit dans sa forme pure, soit dans sa forme participée, et d’autre part la nécessité d’introduire notre moi lui-même dans un monde donné, où s’exprime sa solidarité avec tous les autres modes de l’existence en tant que nous leur imposons notre action ou que nous subissons la leur. — La liaison de notre être réalisé avec le passé montre assez comment il se libère alors à la fois de son indétermination, qui ne cessait de l’affecter aussi longtemps qu’il n’était qu’un être possible et de la servitude à laquelle il était réduit aussi longtemps qu’il était engagé dans le monde des corps : c’est notre passé qui pèse sur nous comme poids étranger ; mais notre passé présent exprime le choix vivant que nous avons fait de nous-mêmes ; il est cet être spirituel et invisible où notre liberté ne cesse à la fois de s’éprouver et de se nourrir. Notre incidence avec le monde nous avait permis d’entrer en communication avec tout ce qui est et qui nous dépasse ; tous ces contacts ont été spiritualisés ; il ne subsiste plus d’eux maintenant que leur essence significative et désincarnée.
*
* *
Cette théorie du temps défini comme le moyen même de la participation est destinée à préparer une théorie de l’âme humaine. Car l’âme n’est point une chose, mais une possibilité qui se choisit et qui se réalise. D’une manière plus précise, elle est le rapport qui s’établit dans le temps entre notre être possible et notre être accompli. Elle est une conscience, mais dans laquelle on ne trouve jamais rien de plus que la pensée du passé et de l’avenir dont il faut dire qu’ils ne trouvent qu’en elle leur subsistance. Et comme en témoigne l’introspection dès que nous l’interrogeons, la conscience est un mouvement continu et réciproque entre la pensée de ce qui n’est plus et la pensée de ce qui n’est pas encore : elle ne cesse de passer de l’un à l’autre et de les convertir l’un dans l’autre. Dans le présent instantané elle ne trouve pas autre chose qu’une réalité donnée, c’est-à-dire le monde ou la matière. [26] Elle se constitue en s’en détachant. Mais c’est dans l’instant aussi qu’elle exerce son acte propre, qui est un acte de liberté, et cet acte ne peut s’accomplir qu’en s’arrachant à la présence donnée afin de créer le temps, c’est-à-dire le rapport de l’avenir et du passé ; le temps est donc le véhicule même de la liberté. Seulement la conversion de l’avenir en passé exige une traversée de la présence donnée où notre conscience témoigne de sa limitation et par conséquent de sa solidarité avec toutes les autres consciences ; c’est ici que l’âme fait l’expérience de sa relation avec le corps et avec le monde dont on voit assez bien le rôle, qui est de fournir aux différentes consciences les instruments qui les séparent et aussi qui les unissent. Or, le possible et le souvenir ne peuvent pas appartenir à l’esprit pur : ils ne rompent jamais tout rapport avec le corps dont on peut dire que sans lui l’un ne pourrait pas être appelé, ni l’autre rappelé ; le corps les distingue et les joint ; il dissocie le temps de l’éternité, mais l’y situe.
Une telle analyse permet d’établir un tableau systématique des différentes puissances du moi ; il faut en effet qu’il puisse se constituer lui-même dans le temps grâce à une double puissance volitive et mnémonique qui, en s’exerçant, forme tout le contenu de notre vie intérieure ; qu’il puisse atteindre par une double puissance représentative et noétique, c’est-à-dire sous la forme d’un objet qui est donné et d’un concept qui est pensé, cela même qui le dépasse et qui n’est qu’un non-moi en rapport avec moi ; il faut enfin qu’une communication puisse s’établir entre moi et l’autre que moi, grâce à une puissance affective inséparable elle-même d’une puissance expressive. Et peut-être faut-il reconnaître que la distinction d’un triple domaine, celui de la formation du moi, de l’exploration du non-moi et de la découverte d’un autre moi, avec la corrélation, dans chacun de ces domaines, d’une action qu’il faut accomplir et d’une donnée qui lui répond, suffit à déterminer d’une manière assez satisfaisante les repères fondamentaux par lesquels on peut mesurer le champ de la conscience et décrire le jeu infiniment varié de ses opérations et de ses états.
[27]
*
* *
On montrera enfin que, si le propre de la sagesse, c’est de chercher à obtenir cette maîtrise de soi qui nous empêche de nous laisser jamais troubler, ni accabler par l’événement, celle-ci ne peut être obtenue par une tension de notre activité séparée, qui, pour marquer que nous sommes capables de nous suffire, accuse notre conflit avec l’univers et cache mal une défaite continue en cherchant à la transformer en une apparente victoire. C’est seulement dans la mesure où notre activité se reconnaît elle-même comme une activité de participation — toujours sollicitée par une présence qui ne lui manque jamais et qui demande d’elle un consentement qu’elle donne seulement quelquefois et qu’elle marchande toujours — qu’elle sera capable de surmonter cette triple dualité entre ce qu’elle désire et ce qu’elle a, entre son effort et la résistance que le monde lui oppose, entre le moi qu’elle assume et le moi d’autrui, d’où dérivent tous les malheurs inséparables de la condition même de la conscience. La sagesse n’est pas de les approfondir, mais de les apaiser.
Elle n’y parvient nullement par l’emploi des deux moyens qui lui sont souvent proposés tantôt séparément et tantôt simultanément : à savoir en premier lieu par une résignation indifférente à l’égard de la réalité telle qu’elle nous est donnée et que l’on nous demande de considérer comme nous étant étrangère ; car cette réalité donnée est mêlée à notre vie comme la matière et l’effet de notre action, de telle sorte qu’une parfaite indifférence à son égard n’est ni possible ni désirable ; en second lieu par une sorte d’abdication de notre activité propre en faveur d’une activité qui agirait en nous sans nous et par laquelle il suffirait de se laisser porter, comme on le voit dans le quiétisme et dans certaines formes de l’abandon ; mais si le sommet de la participation est aussi le sommet de la liberté, il ne faut pas qu’en poussant la première jusqu’à la limite, on accepte de ruiner l’autre.
C’est que la sagesse n’est donc rien de plus que la discipline de la participation, c’est-à-dire une certaine proportionnalité que nous savons établir entre nos actes et nos états, [28] où la dualité de la nature humaine se trouve respectée, mais où, au lieu de permettre que nos actes soient déterminés par nos états, nos états dessinent si exactement la forme de nos actes qu’ils paraissent les exprimer et les suivre et qu’ils s’en distinguent à peine. Les Anciens avaient toujours lié le bonheur à la sagesse, comme si la sagesse résidait dans une certaine disposition de l’activité dont le bonheur fût le reflet ou l’effet dans notre vie affective. Et il y avait pour eux une union si étroite entre les deux termes qu’aucun des deux ne pouvait exister sans l’autre, comme s’ils étaient les deux faces d’une même réalité : tel est le point sans doute où la participation reçoit sa forme la plus parfaite. Et on peut bien aujourd’hui la considérer comme impossible à atteindre. Mais ce serait un mauvais signe si on la méprisait et si la conscience s’épuisait dans la recherche d’états plus violents et finissait par se complaire dans sa propre impuissance et son propre tourment. Car où la conscience croit s’aiguiser davantage, elle est la proie des forces qu’elle ne domine plus : la lumière lui est ôtée. On rabaisse vainement comme trop facile ce qui ne peut être obtenu que par une force que l’on a perdue.
IV
Bien que nous nous abstenions en général de toute polémique et même que nous jugions toute polémique inutile, bien que chaque doctrine doive nécessairement apparaître, dans une philosophie de la participation, comme exprimant un aspect de la vérité et une certaine perspective sur la totalité du réel, il semble pourtant que nous ne puissions pas nous dispenser de confronter notre conception de l’être avec une conception qui en est, d’une certaine manière, l’inverse et qui a obtenu dans ces derniers temps un retentissement considérable bien au delà des cercles où s’enferme presque toujours la pensée philosophique. Ainsi entre ces deux perspectives différentes, le lecteur sera conscient du choix qu’il pourra faire et des conséquences qu’il implique, tant en ce qui concerne la représentation de l’univers que la conduite de la vie.
[29]
La nouvelle philosophie de l’existence nous propose tout d’abord d’opposer l’être en soi et l’être pour soi. Mais on ne peut pourtant mettre en doute que l’en soi et le pour soi ne soient deux aspects différents de l’Être total ou, si l’on veut, qu’ils ne soient contenus en lui. On répondra sans doute en prétendant que l’être total est précisément l’être en soi, puisque l’être pour soi le suppose et n’est obtenu à son égard que par une démarche de négation ou de « néantisation ». Et à l’argument que l’être en soi ne peut être appréhendé pourtant que sous la forme du phénomène, on répliquera que celui-ci enveloppe et déjà affirme un être dont il est le phénomène, c’est-à-dire dont la transphénoménalité nous oblige à le considérer comme se suffisant à lui-même indépendamment de l’acte de conscience qui le pose. Ce qui est la signification même du réalisme en tant qu’au lieu de réaliser le phénomène, il le greffe sur la chose en soi. Inversement, l’être pour soi, ou l’être même de la conscience, le seul qui puisse dire moi, sera non seulement un être incapable de se suffire, mais qui se constitue pour ainsi dire en fonction de cette insuffisance même, non pas qu’il soit simplement, comme on l’a dit souvent, recherche, inquiétude ou privation, mais parce qu’il introduit le néant en lui pour être, ou que son être même réside dans la néantisation de l’en soi.
Or la position que nous avons adoptée est toute différente. Nous pensons qu’il n’y a d’en soi ou de soi que là où une conscience est capable de dire moi. Là est le seul point du monde où l’être et la connaissance coïncident. L’être pour soi est donc le seul être en soi, qui est un absolu parce qu’il n’est le phénomène de rien. Cependant il reste vrai que la conscience est toujours conscience de quelque chose, mais qui n’a d’être que pour elle et par rapport à elle, et qui est précisément l’être d’un phénomène. Aussi loin que l’on dépasse l’aspect que l’objet peut nous offrir, il est encore un objet qui nous offre un nouvel aspect de lui-même ; il est toujours ce qui se montre ou qui pourrait se montrer à quelqu’un. L’expression d’objet absolu est une contradiction : c’est ce qui, n’ayant d’existence que par rapport au pour soi du sujet, devrait être posé pourtant indépendamment de ce rapport. Or là où ce rapport cesse, nous ne pouvons assigner à l’objet [30] aucune autre existence que celle d’un pour soi qui lui est propre et qui est seul capable de fonder son en soi : telle est, en effet, la thèse essentielle de la monadologie, et aussi de toutes les doctrines qui réduisent le monde à une action que Dieu exerce sur les consciences, à un langage qu’il ne cesse de leur faire entendre.
Derrière cette néantisation apparente destinée à fonder l’être du pour soi, il y a une démarche qui est bien familière aux philosophes et à laquelle Descartes a donné une forme particulièrement saisissante, mais qui reçoit ici un sens opposé à celui qu’il avait voulu lui donner. Nul mieux que Descartes n’a marqué comment le cogito lui-même se fonde non pas seulement sur le doute, mais sur cet anéantissement du monde qui n’en laisse subsister que la pure pensée, et qui en réalise en quelque sorte l’absence. Mais ce n’était pas pour introduire le néant au cœur de la conscience (bien qu’elle se détermine elle-même comme finie dans sa relation vivante avec l’infini) ; c’était au contraire pour lui donner accès dans l’absolu de l’être par la possibilité qu’elle a de se mettre au-dessus de tous les phénomènes et même de les nier en vertu précisément de l’ascendant ontologique qu’elle a sur eux ; et c’est en eux qu’elle nous découvre cette insuffisance d’être, ou cette part de néant, qui fait que l’être même qu’ils possèdent leur vient d’ailleurs, du moi ou de Dieu, et qu’il a toujours besoin d’être ressuscité.
On conviendra que la philosophie de l’existence a le grand mérite de fonder l’existence sur la liberté [3] en faisant, il est vrai, non point proprement de l’existence « un défaut du néant », mais de la liberté elle-même une sorte d’irruption du néant dans l’être. Dès lors on n’éprouvera pas de peine à [31] accorder que l’existence elle-même précède l’essence, au lieu d’être fondée sur elle et d’en être seulement la forme manifestée. Car on acceptera à la fois l’identité de l’existence et de la liberté, et la primauté de l’existence par rapport à l’essence, mais à condition de résoudre certaines difficultés qui sont inséparables de ces deux thèses : car on demandera comment cette liberté est engagée elle-même dans une situation, ce que l’on ne peut expliquer qu’en faisant de la liberté et de la situation les deux aspects corrélatifs de l’acte de participation. De plus, on ne se laissera pas arrêter par cette affirmation que c’est cette liberté absolue que Descartes prête à Dieu qu’il faut attribuer à l’homme, car, bien que Descartes lui-même ait soutenu que la liberté est indivisible et qu’elle est en nous ce qu’elle est en Dieu, toutefois il ne faut pas oublier qu’elle n’est pas associée en Dieu à une nature, qu’elle n’est point affrontée en lui comme en nous à des possibles dont il semble qu’ils viennent d’ailleurs et entre lesquels on peut dire qu’elle aura à choisir, mais sans qu’il lui appartienne de les créer. Car si l’on ne demande pas quelle est l’origine de la liberté, qui est toujours le premier commencement d’elle-même, on peut du moins demander quelle est l’origine de ces possibles qui lui sont offerts et qui remplissent l’intervalle qui sépare la liberté divine de la nôtre.
Ainsi la primauté de l’existence par rapport à l’essence suppose, semble-t-il, deux postulats, à savoir : le premier, que le propre de la liberté, c’est de faire éclater dans le tout de l’être des possibles sans lesquels elle ne serait rien ; or ces possibles ne sont pas l’effet de la néantisation de l’être en soi, car ils appartiennent eux aussi au domaine de l’être, en tant précisément qu’ils dépassent le domaine de l’être réalisé ; et le second, que l’essence a plus de valeur que l’existence, ou du moins qu’elle est la valeur qui doit justifier l’existence, puisque c’est vers elle que l’existence tend, qu’elle a seulement pour objet de l’acquérir. Nous savons par conséquent que l’existence se trouve entre une possibilité que la participation fait jaillir de l’acte pur comme la condition même de sa liberté, et une essence que cette liberté forge peu à peu au cours du temps par l’actualisation de cette possibilité.
On a beaucoup admiré en général les analyses consacrées [32] dans l’Être et le néant à la conscience de soi et à la relation entre le moi et les autres. La conscience de soi est caractérisée par la mauvaise foi, une mauvaise foi en quelque sorte constitutionnelle, puisqu’elle est inséparable d’un être qui n’est pas ce qu’il est et qui est ce qu’il n’est pas. Qu’est-ce à dire, sinon qu’il s’agit d’un être qui se crée et ne peut jamais faire de lui-même une chose créée ? Ne faut-il pas dire alors que la sincérité est une entreprise vaine et qu’on ne peut jamais produire la coïncidence avec soi ? Mais cela signifie simplement qu’il ne faut jamais parler de soi comme d’une chose, ni même peut-être jamais parler de soi, ou encore que l’être du moi réside dans une possibilité qu’il n’épuise pas, de telle sorte qu’il ne peut se réduire lui-même, ni à une possibilité déjà réalisée et qu’il dépasse toujours, ni à une possibilité encore en suspens et qu’il éprouve en lui, sans qu’il soit jamais assuré de la rendre réelle. De là cette ambiguïté de la conscience qui fait que le moi semble toujours se chercher sans réussir à se trouver. Mais la mauvaise foi ou ce qu’on appelle de ce nom naît quand on transporte sur le plan théorique, où le réel est considéré comme déjà donné, cet être qui n’a de subsistance que sur le plan pratique, c’est-à-dire dont l’être est de se faire, et qui tente vainement de transformer en donné l’acte même par lequel il se fait.
On le voit bien dans le rapport que le moi de chacun de nous soutient avec le moi des autres. Car la connaissance que nous en avons fait que les autres hommes sont pour nous des objets ou des corps, alors que nous savons pourtant qu’ils sont aussi pour nous des consciences comme nous. Et c’est parce que nous savons qu’ils sont eux-mêmes des consciences, qu’ils peuvent nous réduire eux aussi à l’état d’objets ou de corps. De là ces analyses pénétrantes et déjà célèbres du regard et de l’amour où l’on décrit dans le moi une double oscillation entre un moi qui se sait moi pour lui-même, alors qu’il peut considérer les autres comme des objets, et un moi qui, sachant que les autres aussi peuvent dire moi, sent qu’il peut être à son tour rabaissé par eux au rang d’un objet. Faut-il en conclure que chacun soit obligé tantôt de se subordonner l’autre, en faisant de lui un objet, soit spontanément, soit volontairement, par une sorte de jalousie et de [33] cruauté, et tantôt de se subordonner à l’autre en sentant qu’il n’est qu’un objet pour lui et par une sorte d’abaissement et de complaisance à n’être pour lui rien de plus ? C’est nier qu’il puisse y avoir une relation entre les sujets, c’est-à-dire une communication entre les consciences, puisque chaque sujet est astreint à faire des autres un objet en devenant à son tour un objet pour lui, bien que chacun d’eux sache de l’autre qu’il est aussi un sujet et n’en profite que pour l’avilir ou demander qu’il l’avilisse. C’est que la communication entre les consciences n’est possible sans doute qu’au-dessus de l’une et de l’autre et dans une intériorité profonde et secrète qui leur est commune où chacune d’elles pénètre par la médiation de l’autre. Mais là où cette intériorité fait défaut, là où elle est mise en doute, les individus restent affrontés comme des ennemis : ils habitent ensemble dans un Enfer où la subjectivité d’un autre n’est pour la mienne qu’un échec ou un scandale ; l’une des deux doit être niée ou asservie, c’est-à-dire réduite à cet objet, ou à ce corps, qui la limite, et dont on voit bien qu’il est pour elle un moyen de porter témoignage et non point de détruire ou de se laisser détruire.
Cependant le malheur de notre condition provient, nous dit-on, de l’opposition entre le pour soi et l’en soi et de l’ambition que nous avons de vouloir qu’ils coïncident. Ce serait pour nous devenir Dieu. Mais cette ambition est irréalisable, elle est une contradiction, s’il est vrai qu’il faut que le néant s’insinue dans l’en soi pour constituer l’être du pour soi. Seulement les choses se passeraient tout autrement si c’était dans le pour soi que se découvrait à nous l’absolu de l’être ou du soi. Et sans doute il est vrai qu’il ne se découvre jamais que sous une forme participée, c’est-à-dire où l’intériorité est toujours mêlée d’extériorité ; mais, au lieu de dire qu’il est absent de nous, — comme une fin que nous ne pouvons jamais atteindre, — il faut dire qu’il nous est présent comme une source que nous ne pouvons jamais épuiser. Alors le désespoir qui naît du désir idolâtre de posséder un objet infini qui recule toujours se change en la joie d’une activité qui ne saurait défaillir et nous apporte une révélation qui ne s’interrompt plus.
[34]
On peut conclure sur la philosophie de l’existence en disant qu’elle est une expression cruelle de l’époque où nous vivons, qui ne pouvait manquer de s’y reconnaître, qu’elle décrit en traits singulièrement amers la misère de l’homme en tant qu’il se sent abandonné dans le monde, prisonnier de sa solitude et incapable de la vaincre, ignorant de son origine, livré à un destin incompréhensible, et certain seulement d’une chose, c’est qu’il est voué à la mort, qui un jour l’engloutira. On ne s’étonnera pas que le primat de l’existence s’exprime par un primat du moi individuel en tant qu’il n’y a pas pour lui d’autre existence véritable que la sienne. Mais comment la découvrirait-il autrement que par l’émotivité et, dans l’émotivité même, par les émotions les plus vives qui sont toujours des émotions négatives et le séparent d’un monde qui l’ignore, qui lui est toujours étranger et peut-être même hostile ? De là le privilège de l’inquiétude, de l’angoisse et du souci. De là, l’absurdité de toutes choses, bien que nous voyions mal dans un pareil monde d’où peut venir la raison qui les juge telles. De là la nausée que nous éprouvons devant elles et qui suppose pourtant en nous une délicatesse qui n’en tolère pas le spectacle. On ne peut s’empêcher de juger qu’il y a beaucoup de complaisance dans cette considération de la pure misère de l’homme que l’on pense relever seulement par la conscience même qu’on en prend. Mais cette conscience ne suffit pas. Ou du moins elle n’a de valeur que si elle devient un moyen qui nous délivre. Cela n’est possible que par cette transfiguration de l’émotion qui, au lieu de la réduire à un ébranlement subjectif, la porte elle-même jusqu’à cette extrême pointe où l’amour et la raison ne font qu’un, que par cette transfiguration de la liberté qui, au lieu d’un pouvoir arbitraire de l’individu, en fait la volonté éclairée de la valeur. L’homme, dit-on, se dépasse vers l’avenir, mais il faut qu’il ait le pouvoir de le faire ; ce n’est pas l’avenir qui est le transcendant, mais une puissance trans-temporelle à laquelle nous participons et qui nous ouvre sans cesse un nouvel avenir. La philosophie de l’existence est une psychologie de l’homme déchu et malheureux, mais qui n’entend point se relever de sa déchéance ni s’arracher à son malheur. Elle ne trouve un succès profond que dans les [35] âmes déjà désespérées, ou qui veulent l’être. Elle évoque Pascal, et plus près de nous Kierkegaard, mais pour ne retenir que l’une des faces de cette double expérience de grandeur et de misère qui est constitutive à leurs yeux de la condition humaine. Elle se définit elle-même comme une phénoménologie. Elle ne peut pas être tenue pour une métaphysique. Elle veut être un humanisme, mais qui considère l’homme isolément et brise toutes ses attaches avec l’être où il trouve sa propre raison d’être, la lumière qui l’éclaire, l’éternité qui le soutient et la clef de sa propre vocation temporelle.
Il n’y a que deux philosophies entre lesquelles il faut choisir : celle de Protagoras selon laquelle l’homme est la mesure de toutes choses, mais la mesure qu’il se donne est aussi sa propre mesure ; et celle de Platon qui est aussi celle de Descartes, que la mesure de toutes choses, c’est Dieu et non point l’homme, mais un Dieu qui se laisse participer par l’homme, qui n’est pas seulement le Dieu des philosophes, mais le Dieu des âmes simples et vigoureuses, qui savent que la vérité et le bien sont au-dessus d’elles, et ne se refusent jamais à ceux qui les cherchent avec assez de courage et d’humilité.
[1] Les difficultés d’une telle entreprise sont comparables à celles qu’avait rencontrées Descartes lorsqu’il avait voulu démontrer qu’il n’existe de mouvement que dans le plein. Et sans doute la solution la plus facile serait de donner au temps une valeur absolue et de faire émerger l’être du néant de manière à faire parcourir aux choses tout l’intervalle qui sépare le néant de l’être. Mais il nous a semblé que, si notre vie temporelle se déployait toujours dans le temps comme le passage de l’un de ses modes à un autre, c’était par la solidarité de tous ces modes qu’elle acquérait son caractère de gravité en témoignant du retentissement de la moindre de ses démarches sur la totalité même de l’être.
[2] Cette analyse montre assez nettement pourquoi l’intelligible et le sensible doivent toujours à la fois s’opposer et se correspondre, sans que le premier absorbe jamais l’autre. C’est de cette opposition et de cette correspondance que nous avions essayé de donner un premier exemple dans notre Dialectique du monde sensible (1923).
[3] On remarquera que cette philosophie de l’existence est comme une ellipse à deux foyers : car tantôt il semble que c’est l’en soi qui apparaît comme exprimant le fond même de l’être, tantôt il semble que c’est la liberté, qui pourtant suppose cet en soi qu’elle néantise. Mais il suffirait de partir au contraire de la liberté comme du seul et véritable en soi pour que l’en soi dont le phénomène nous révèle et nous cache la présence ne fût plus qu’une chimère. Nous nous trouverions ainsi amenés à passer de l’en soi transphénoménal à un en soi en quelque sorte cisphénoménal. Et la réduction de l’être à l’acte permettrait de considérer le phénomène comme exprimant dans la liberté à la fois sa manifestation et sa limitation.
|

