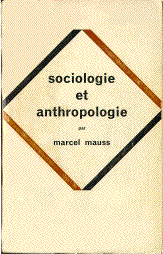
Par Claude Lévi-Strauss

Peu d'enseignements sont restés aussi ésotériques et peu, en même temps, ont exercé une influence aussi profonde que celui de Marcel Mauss. Cette pensée rendue parfois opaque par sa densité même, mais toute sillonnée d'éclairs, ces démarches tortueuses qui semblaient égarer au moment où le plus inattendu des itinéraires conduisait au cœur des problèmes, seuls ceux qui ont connu et écouté l'homme peuvent en apprécier pleinement la fécondité et dresser le bilan de leur dette à son égard. Nous ne nous étendrons pas ici sur son rôle dans la pensée ethnologique et sociologique française. Il a été examiné ailleurs [2]. Qu'il suffise de rappeler que l'influence de Mauss ne s'est pas limitée aux ethnographes, dont aucun ne pourrait dire y avoir échappé, mais aussi aux linguistes, psychologues, historiens des religions et orientalistes, si bien que, dans le domaine des sciences sociales et humaines, une pléiade de chercheurs français lui sont, à quelque titre, redevables de leur orientation. Pour les autres, l'œuvre écrite restait trop dispersée et souvent difficilement accessible. Le hasard d'une rencontre ou d'une lecture pouvait éveiller des échos durables : on en reconnaîtrait volontiers quelques-uns chez Radcliffe-Brown, Malinowski, Evans-Pritchard, Firth, Herskovits, Lloyd Warner, Redfield, Kluckhohn, Elkin, Held et beaucoup d'autres. Dans l'ensemble, l’œuvre et la pensée de Marcel Mauss ont agi plutôt par l'intermédiaire de collègues et de disciples en contact régulier ou occasionnel avec lui, que directement, sous forme de paroles ou d'écrits. C'est cette situation paradoxale à quoi vient remédier un recueil de mémoires et de communications qui sont loin d'épuiser la pensée de Mauss, et dont il faut espérer qu'il inaugure seulement une série de volumes où l’œuvre entier - déjà publié ou inédit, élaboré seul ou en collaboration - pourra être, enfin, appréhendé dans sa totalité.
Des raisons pratiques ont présidé au choix des études rassemblées dans ce volume. Cependant, cette sélection de hasard permet déjà de dégager certains aspects d'une pensée dont elle réussit, encore qu'imparfaitement, à illustrer la richesse et la diversité.
I

On est d'abord frappé par ce qu'on aimerait appeler le modernisme de la pensée de Mauss. L'Essai sur l'Idée de Mort introduit au cœur de préoccupations que la médecine dite psychosomatique a rendues à l'actualité au cours de ces dernières années seulement. Certes, les travaux sur lesquels W. B. Cannon a fondé une interprétation physiologique des troubles nommés par lui homéostatiques remontent-ils à la première guerre mondiale. Mais c'est à une époque beaucoup plus récente [3] que l'illustre biologiste a compris dans sa théorie ces phénomènes singuliers, qui semblent mettre immédiatement en rapport le physiologique et le social, sur lesquels Mauss attirait l'attention dès 1926, non point, sans doute, parce qu'il les aurait découverts, mais comme un des premiers à souligner leur authenticité, leur généralité, et surtout leur extraordinaire importance pour la juste interprétation des rapports entre l'individu et le groupe.
Le même souci, qui domine l'ethnologie contemporaine, du rapport entre groupe et individu, inspire aussi la communication sur les techniques du corps par laquelle se clôt ce volume. En affirmant la valeur cruciale, pour les sciences de l'homme, d'une étude de la façon dont chaque société impose à l'individu un usage rigoureusement déterminé de son corps, Mauss annonce les plus actuelles préoccupations de l'École anthropologique américaine, telles qu'elles allaient s'exprimer dans les travaux de Ruth Benedict, Margaret Mead, et de la plupart des ethnologues américains de la jeune génération. C'est par l'intermédiaire de l'éducation des besoins et des activités corporelles que la structure sociale imprime sa marque sur les individus : « On exerce les enfants... à dompter des réflexes... on inhibe des peurs... on sélectionne des arrêts et des mouvements. » Cette recherche de la projection du social sur l'individuel doit fouiller au plus profond des usages et des conduites ; dans ce domaine, il n'y a rien de futile, rien de gratuit, rien de superflu : « L'éducation de l'enfant est pleine de ce qu'on appelle des détails, mais qui sont essentiels. » Et encore : « Des foules de détails, inobservés et dont il faut faire l'observation composent l'éducation physique de tous les âges et des deux sexes. »
Non seulement Mauss établit ainsi le plan de travail qui sera, de façon prédominante, celui de l'ethnographie moderne au cours de ces dix dernières années, mais il aperçoit en même temps la conséquence la plus significative de cette nouvelle orientation, c'est-à-dire le rapprochement entre ethnologie et psychanalyse. Il fallait beaucoup de courage et de clairvoyance à un homme, issu d'une formation intellectuelle et morale aussi pudique que celle du néo-kantisme qui régnait dans nos universités à la fin du siècle dernier, pour partir, comme il le fait ici, à la découverte « d'états psychiques disparus de nos enfances, » produits de « contacts de sexes et de peaux, » et pour se rendre compte qu'il allait se trouver « en pleine psychanalyse, probablement assez fondée ici. » D'où l’importance, pleinement aperçue par lui, du moment et des modalités du sevrage et de la manière dont le bébé est manié. Mauss entrevoit même une classification des groupes humains en « gens à berceaux,... gens sans berceaux » Il suffit de citer les noms et les recherches de Margaret Mead, Ruth Benedict, Cora Du Bois, Clyde Kluckhohn, D. Leighton, E. Erikson, K. Davis, J. Henry, etc., pour mesurer la nouveauté de ces thèses, présentées en 1934, c'est-à-dire l'année même où paraissaient les Patterns of Culture, encore très éloignés de cette position du problème et au moment où Margaret Mead était en train d'élaborer sur le terrain, en Nouvelle-Guinée, les principes d'une doctrine très voisine, et dont on sait l'énorme influence qu'elle était destinée à exercer.
A deux points de vue différents, Mauss reste d'ailleurs en avance sur tous les développements ultérieurs. En ouvrant aux recherches ethnologiques un nouveau territoire, celui des techniques du corps, il ne se bornait pas à reconnaître l'incidence de ce genre d'études sur le problème de l'intégration culturelle : il soulignait aussi leur importance intrinsèque. Or, à cet égard, rien n'a été fait, ou presque. Depuis dix ou quinze ans, les ethnologues ont consenti à se pencher sur certaines disciplines corporelles, mais seulement dans la mesure où ils espéraient élucider ainsi les mécanismes par lesquels le groupe modèle les individus à son image. Personne, en vérité, n'a encore abordé cette tâche immense dont Mauss soulignait l'urgente nécessité, à savoir l'inventaire et la description de tous les usages que les hommes, au cours de l'histoire et surtout à travers le monde, ont fait et continuent de faire de leurs corps. Nous collectionnons les produits de l'industrie humaine ; nous recueillons des textes écrits ou oraux. Mais les possibilités si nombreuses et variées dont est susceptible cet outil, pourtant universel et placé à la disposition de chacun, qu'est le corps de l'homme, nous continuons à les ignorer, sauf celles. toujours partielles et limitées, qui rentrent dans les exigences de notre culture particulière.
Pourtant, tout ethnologue ayant travaillé sur le terrain sait que ces possibilités sont étonnamment variables selon les groupes. Les seuils d'excitabilité, les limites de résistance sont différents dans chaque culture. L'effort « irréalisable », la douleur « intolérable », le plaisir « inouï » sont moins fonction de particularités individuelles que de critères sanctionnés par l'approbation ou la désapprobation collectives. Chaque technique, chaque conduite, traditionnellement apprise et transmise, se fonde sur certaines synergies nerveuses et musculaires qui constituent de véritables systèmes, solidaires de tout un contexte sociologique. Cela est vrai des plus humbles techniques, comme la production du feu par friction ou la taille d'outils de pierre par éclatement ; et cela l'est bien davantage de ces grandes constructions à la fois sociales et physiques que sont les différentes gymnastiques (y compris la gymnastique chinoise, si différente de la nôtre, et la gymnastique viscérale des anciens Maori, dont nous ne connaissons presque rien), ou les techniques du souffle, chinoise et hindoue, ou encore les exercices du cirque qui constituent un très ancien patrimoine de notre culture et dont nous abandonnons la préservation au hasard des vocations individuelles et des traditions familiales.
Cette connaissance des modalités d'utilisation du corps humain serait, pourtant, particulièrement nécessaire à une époque où le développement des moyens mécaniques à la disposition de l'homme tend à le détourner de l'exercice et de l'application des moyens corporels, sauf dans le domaine du sport, qui est une partie importante, mais une partie seulement des conduites envisagées par Mauss, et qui est d'ailleurs variable selon les groupes. On souhaiterait qu'une organisation internationale comme l'UNESCO s'attachât à la réalisation du programme tracé par Mauss dans cette communication. Des Archives internationales des Techniques corporelles, dressant l'inventaire de toutes les possibilités du corps humain et des méthodes d'apprentissage et d'exercice employée-, pour le montage de chaque technique, représenteraient une oeuvre véritablement internationale : car il n'y a pas, dans le monde, un seul groupe humain qui ne puisse apporter à l'entreprise une contribution originale. Et de plus, il s'agit là d'un patrimoine commun et immédiatement accessible à l'humanité tout entière, dont l'origine plonge au fond des millénaires, dont la valeur pratique reste et restera toujours actuelle et dont la disposition générale permettrait, mieux que d'autres moyens, parce que sous forme d'expériences vécues, de rendre chaque homme sensible à la solidarité, à la fois intellectuelle et physique, qui l'unit à l'humanité tout entière. L'entreprise serait aussi éminemment apte à contrecarrer les préjugés de race, puisque, en face des conceptions racistes qui veulent voir dans l'homme un produit de son corps, on montrerait au contraire que c'est l'homme qui, toujours et partout, a su faire de son corps un produit de ses techniques et de ses représentations.
Mais ce ne sont pas seulement des raisons morales et pratiques qui continuent de militer en sa faveur. Elle apporterait des informations d'une richesse insoupçonnée sur des migrations, des contacts culturels ou des emprunts qui se situent dans un passé reculé et que des gestes en apparence insignifiants, transmis de génération en génération, et protégés par leur insignifiance même, attestent souvent mieux que des gisements archéologiques ou des monuments figurés. La position de la main dans la miction chez l'homme, la préférence pour se laver dans l'eau courante ou dans l'eau stagnante, toujours vivante dans l'usage de fermer ou de laisser ouverte la bonde d'un lavabo pendant que l'eau coule, etc., autant d'exemples d'une archéologie des habitudes corporelles qui, dans l'Europe moderne (et à plus forte raison ailleurs), fournirait à l'historien des cultures des connaissances aussi précieuses que la préhistoire ou la philologie.
*
* *
Nul plus que Mauss, qui se plaisait à lire les limites de l'expansion celtique dans la forme des pains à l'étalage des boulangers, ne pouvait être sensible à cette solidarité du passé et du présent, s'inscrivant dans les plus humbles et les plus concrets de nos usages. Mais en soulignant l'importance de la mort magique ou des techniques du corps, il pensait aussi établir un autre type de solidarité, qui fournit son thème principal à une troisième communication publiée dans ce volume : Rapports réels et pratiques de la Psychologie et de la Sociologie. Dans tous ces cas, on est en présence d'un genre de faits « qu'il faudrait étudier bien vite : de ceux où la nature sociale rejoint très directement la nature biologique de l'homme » [4]. Ce sont bien là des faits privilégiés qui permettent d'attaquer le problème des rapports entre sociologie et psychologie.
C'est Ruth Benedict qui a enseigné aux ethnologues et aux psychologues contemporains que les phénomènes à la description desquels ils s'attachent les uns et les autres sont susceptibles d'être décrits dans un langage commun, emprunté à la psychopathologie, ce qui constitue par soi-même un mystère. Dix ans auparavant, Mauss s'en était aperçu avec une lucidité si prophétique que l'on peut imputer au seul abandon dans lequel ont été laissées les sciences de l'homme dans notre pays que l'immense domaine, dont l'entrée se trouvait ainsi repérée et ouverte, ne fut pas aussitôt mis en exploitation. Dès 1924 en effet, s'adressant aux psychologues, et définissant la vie sociale comme « un monde de rapports symboliques », Mauss leur disait : « Tandis que vous ne saisissez ces cas de symbolisme qu'assez rarement et souvent dans des séries de faits anormaux, nous, nous en saisissons d'une façon constante de très nombreux, et dans des séries immenses de faits normaux. » Toute la thèse des Patterns of Culture est anticipée dans cette formule, dont leur auteur n'a certainement jamais eu connaissance ; et c'est dommage : car l'eussent-elles connue avec les développements qui l'accompagnent, que Ruth Benedict et son école se fussent plus aisément défendues contre certains reproches qu'elles ont parfois mérités.
En s'attachant à définir un système de corrélations entre la culture du groupe et le psychisme individuel, l'École psycho-sociologique américaine risquait en effet de s'enfermer dans un cercle. Elle s'était adressée à la psychanalyse pour lui demander de signaler les interventions fondamentales qui, expression de la culture du groupe, déterminent des attitudes individuelles durables. Dès lors, ethnologues et psychanalystes allaient être entraînés dans une discussion interminable sur la primauté respective de chaque facteur. Une société tient-elle ses caractères institutionnels des modalités particulières de la personnalité de ses membres, ou cette personnalité s'explique-t-elle par certains aspects de l'éducation de la petite enfance, qui sont, eux-mêmes, des phénomènes d'ordre culturel ? Le débat devra rester sans issue, à moins qu'on ne s'aperçoive que les deux ordres ne sont pas, l'un par rapport à l'autre, dans une relation de cause à effet (quelle que soit, d'ailleurs, la position respective qu'on attribue à chacun) mais que la formulation psychologique n'est qu'une traduction, sur le plan du psychisme individuel, d'une structure proprement sociologique. C'est, d'ailleurs, ce que Margaret Mead souligne très opportunément dans une publication récente [5], en montrant que les tests de Rorschach, appliqués à des indigènes, n'apprennent à l'ethnologue rien qu'il ne connaisse déjà par des méthodes d'investigation proprement ethnologiques, bien qu'ils puissent fournir une utile traduction psychologique de résultats établis de façon indépendante.
C'est cette subordination du psychologique au sociologique que Mauss met utilement en lumière. Sans doute, Ruth Benedict n'a jamais prétendu ramener des types de cultures à des troubles psycho-pathologiques, et encore moins expliquer les premiers par les seconds. Mais il était tout de même imprudent d'utiliser une terminologie psychiatrique pour caractériser des phénomènes sociaux, alors que le rapport véritable s'établirait plutôt dans l'autre sens. Il est de la nature de la société qu'elle s'exprime symboliquement dans ses coutumes et dans ses institutions ; au contraire, les conduites individuelles normales ne sont jamais symboliques par elles-mêmes : elles sont les éléments à partir desquels un système symbolique, qui ne peut être que collectif, se construit. Ce sont seulement les conduites anormales qui, parce que désocialisées et en quelque sorte abandonnées à elles-mêmes, réalisent, sur le plan individuel, l'illusion d'un symbolisme autonome. Autrement dit, les conduites individuelles anormales, dans un groupe social donné, atteignent au symbolisme, mais sur un niveau inférieur et, si l'on peut dire, dans un ordre de grandeur différent et réellement incommensurable à celui dans lequel s'exprime le groupe. Il est donc à la fois naturel et fatal que, symboliques d'une part et traduisant de l'autre (par définition) un système différent de celui du groupe, les conduites psycho-pathologiques individuelles offrent à chaque société une sorte d'équivalent, doublement amoindri (parce que individuel et parce que pathologique) de symbolismes différents du sien propre, tout en étant vaguement évocateurs de formes normales et réalisées à l'échelle collective.
Peut-être pourrait-on aller plus loin encore. Le domaine du pathologique ne se confond jamais avec le domaine de l'individuel, puisque les différents types de troubles se rangent en catégories, admettent une classification et que les formes prédominantes ne sont pas les mêmes selon les sociétés, et selon tel ou tel moment de l'histoire d'une même société. La réduction du social au psychologique, tentée par certains par l'intermédiaire de la psycho-pathologie, serait encore plus illusoire que nous ne l'avons admis jusqu'à présent, si l'on devait reconnaître que chaque société possède ses formes préférées de troubles mentaux et que ceux-ci ne sont pas, moins que les formes normales, fonction d'un ordre collectif que l'exception même ne laisse pas indifférent.
Dans son mémoire sur la magie, sur lequel nous reviendrons plus loin, et dont il faut considérer la date pour le juger avec équité, Mauss note que, si « la simulation du magicien est du même ordre que celle qu'on constate dans les états de névroses, » il n'en est pas moins vrai que les catégories où se recrutent les sorciers : « infirmes, extatiques, nerveux et forains, forment en réalité des espèces de classes sociales. » Et il ajoute : « Ce qui leur donne des vertus magiques, ce n'est pas tant leur caractère physique individuel que l'attitude prise par la société à l'égard de tout leur genre. » Il pose ainsi un problème qu'il ne résout pas, mais que nous pouvons essayer d'explorer à sa suite.
Il est commode de comparer le shaman en transe ou le protagoniste d'une scène de possession a un névrosé. Nous l'avons fait nous-même [6] et le parallèle est légitime en ce sens que, dans les deux types d'états, interviennent vraisemblablement des éléments communs. Néanmoins, des restrictions s'imposent : en premier lieu, nos psychiatres mis en présence de documents cinématographiques relatifs à des danses de possession, se déclarent incapables de ramener ces conduites à l'une quelconque des formes de névroses qu'ils ont coutume d'observer. D'autre part et surtout, les ethnographes en contact avec des sorciers, ou avec des possédés habituels ou occasionnels, contestent que ces individus, à tous égards normaux en dehors des circonstances socialement définies où ils se livrent à leurs manifestations, puissent être considérés comme des malades. Dans les sociétés à séances de possession, la possession est une conduite ouverte à tous ; les modalités en sont fixées par la tradition, la valeur en est sanctionnée par la participation collective. Au nom de quoi affirmerait-on que des individus correspondant à la moyenne de leur groupe, disposant dans les actes de la vie courante de tous leurs moyens intellectuels et physiques, et manifestant occasionnellement une conduite significative et approuvée, devraient être traités comme des anormaux ?
La contradiction que nous venons d'énoncer peut se résoudre de deux façons différentes. Ou les conduites décrites sous le nom de « transe » et de « possession » n'ont rien à voir avec celles que, dans notre propre société, nous appelons psycho-pathologiques ; ou on peut les considérer comme étant du même type, et c'est alors la connexion avec des états pathologiques qui doit être considérée comme contingente et comme résultant d'une condition particulière à la société où nous vivons. Dans ce dernier cas, on serait en présence d'une deuxième alternative : soit que les prétendues maladies mentales, en réalité étrangères à la médecine, doivent être considérées comme des incidences sociologiques sur la conduite d'individus que leur histoire et leur constitution personnelles ont partiellement dissociés du groupe ; soit qu'on reconnaisse chez ces malades la présence d'un état vraiment pathologique, mais d'origine physiologique, et qui créerait seulement un terrain favorable, ou, si l'on veut, « sensibilisateur », à certaines conduites symboliques qui continueraient de relever de la seule interprétation sociologique.
Nous n'avons pas besoin d'ouvrir un semblable débat ; si l'alternative a été rapidement évoquée, c'est seulement pour montrer qu'une théorie purement sociologique des troubles mentaux (ou de ce que nous considérons comme tels) pourrait être élaborée sans crainte de voir un jour les physiologistes découvrir un substrat bio-chimique des névroses. Même dans cette hypothèse, la théorie resterait valide. Et il est relativement aisé d'en imaginer l'économie. Toute culture peut être considérée comme un ensemble de systèmes symboliques au premier rang desquels se placent le langage, les règles matrimoniales, les rapports économiques, l'art, la science, la religion. Tous ces systèmes visent à exprimer certains aspects de la réalité physique et de la réalité sociale, et plus encore, les relations que ces deux types de réalité entretiennent entre eux et que les systèmes symboliques eux-mêmes entretiennent les uns avec les autres. Qu'ils n'y puissent jamais parvenir de façon intégralement satisfaisante, et surtout équivalente, résulte d'abord des conditions de fonctionnement propres à chaque système : ils restent toujours incommensurables ; et ensuite, de ce que l'histoire introduit dans ces systèmes des éléments allogènes, détermine des glissements d'une société vers une autre, et des inégalités dans le rythme relatif d'évolution de chaque système particulier. Du fait, donc, qu'une société est toujours donnée dans le temps et dans l'espace, donc sujette à l'incidence d'autres sociétés et d'états antérieurs de son propre développement ; du fait aussi que, même dans une société théorique qu'on imaginerait sans relation avec aucune autre, et sans dépendance vis-à-vis de son propre passé, les différents systèmes de symboles dont l'ensemble constitue la culture ou civilisation resteraient irréductibles entre eux (la traduction d'un système dans un autre étant conditionnée par l'introduction de constantes qui sont des valeurs irrationnelles), il résulte qu'aucune société n'est jamais intégralement et complètement symbolique ; ou, plus exactement, qu'elle ne parvient jamais à offrir à tous ses membres, et au même degré, le moyen de s'utiliser pleinement à l'édification d'une structure symbolique qui, pour la pensée normale, n'est réalisable que sur le plan de la vie sociale. Car c'est, à proprement parler, celui que nous appelons sain d'esprit qui s'aliène, puisqu'il consent à exister dans un monde définissable seulement par la relation de moi et d'autrui [7]. La santé de l'esprit individuel implique la participation à la vie sociale, comme le refus de s'y prêter (mais encore selon des modalités qu'elle impose) correspond à l'apparition des troubles mentaux.
Une société quelconque est donc comparable à un univers où des masses discrètes seulement seraient hautement structurées. Dans toute société donc, il serait inévitable qu'un pourcentage (d'ailleurs variable) d'individus se trouvent placés, si l'on peut dire, hors système ou entre deux ou plusieurs systèmes irréductibles. A ceux-là, le groupe demande, et même impose, de figurer certaines formes de compromis irréalisables sur le plan collectif, de feindre des transitions imaginaires, d'incarner des synthèses incompatibles. Dans toutes ces conduites en apparence aberrantes, les « malades » ne font donc que transcrire un état du groupe et rendre manifeste telle ou telle de ses constantes. Leur position périphérique par rapport à un système local n'empêche pas qu'au même titre que lui, ils ne soient partie intégrante du système total. Plus exactement, s'ils n'étaient pas ces témoins dociles, le système total risquerait de se désintégrer dans ses systèmes locaux. On peut donc dire que pour chaque société, le rapport entre conduites normales et conduites spéciales est complémentaire. Cela est évident dans le cas du shamanisme et de la possession ; mais ce ne serait pas moins vrai de conduites que notre propre société refuse de grouper et de légitimer en vocations, tout en abandonnant le soin de réaliser un équivalent statistique à des individus sensibles (pour des raisons historiques, psychologiques, sociologiques ou physiologiques, peu importe) aux contradictions et aux lacunes de la structure sociale.
Nous voyons bien comment et pourquoi un sorcier est un élément de l'équilibre social ; la même constatation s'impose pour les danses ou cérémonies à possession [8]. Mais si notre hypothèse est exacte, il s'ensuivrait que les formes de troubles mentaux caractéristiques de chaque société, et le pourcentage des individus qui en sont affectés, sont un élément constitutif du type particulier d'équilibre qui lui est propre. Dans une remarquable et récente étude, après avoir remarqué qu'aucun shaman « n'est, dans la vie quotidienne, un individu « anormal », névrosé ou paranoïaque ; sans quoi il serait considéré comme un fou, et non comme un shaman », Nadel maintient qu'il existe une relation entre les troubles pathologiques et les conduites shamanistiques ; mais qui consiste moins dans une assimilation des secondes aux premiers, que dans la nécessité de définir les premiers en fonction des secondes. Précisément parce que les conduites shamanistiques sont normales, il résulte que, dans les sociétés à shamans, peuvent rester normales certaines conduites qui, ailleurs, seraient considérées comme (et seraient effectivement) pathologiques. Une étude comparative de groupes shamanistiques et non-shamanistiques, dans une aire géographique restreinte, montre que le shamanisme pourrait jouer un double rôle vis-à-vis des dispositions psychopathiques : les exploitant d'une part, mais de l'autre, les canalisant et les stabilisant. Il semble, en effet, que, sous l'influence du contact avec la civilisation, la fréquence des psychoses et des névroses tende à s'élever dans les groupes sans shamanisme, tandis que dans les autres, c'est le shamanisme lui-même qui se développe, mais sans accroissement des troubles mentaux [9]. On voit donc que les ethnologues qui prétendent dissocier complètement certains rituels de tout contexte psycho-pathologique sont inspirés d'une bonne volonté un peu timorée. L'analogie est manifeste, et les rapports sont peut-être même susceptibles de mesure. Cela ne signifie pas que les sociétés dites primitives se placent sous l'autorité de fous ; mais plutôt que nous-mêmes traitons à l'aveugle des phénomènes sociologiques comme s'ils relevaient de la pathologie, alors qu'ils n'ont rien à voir avec elle, ou tout au moins, que les deux aspects doivent être rigoureusement dissociés. En fait, c'est la notion même de maladie mentale qui est en cause. Car si, comme l'affirme Mauss, le mental et le social se confondent, il y aurait absurdité, dans les cas où social et physiologique sont directement en contact, à appliquer à l'un des deux ordres une notion (comme celle de maladie) qui n'a de sens que dans l'autre.
En nous livrant a une excursion, que d'aucuns jugeront sans doute imprudente, jusqu'aux plus extrêmes confins de la pensée de Mauss et peut-être même au-delà, nous n'avons voulu que montrer la richesse et la fécondité des thèmes qu'il offrait à la méditation de ses lecteurs ou auditeurs. A cet égard, sa revendication du symbolisme comme relevant intégralement des disciplines sociologiques a pu être, comme chez Durkheim, imprudemment formulée : car, dans la communication sur les Rapports de la Psychologie et de la Sociologie, Mauss croit encore possible d'élaborer une théorie sociologique du symbolisme, alors qu'il faut évidemment chercher une origine symbolique de la société. Plus nous refuserons à la psychologie une compétence s'exerçant à tous les niveaux de la vie mentale, plus nous devrons nous incliner devant elle comme seule capable (avec la biologie) de rendre compte de l'origine des fonctions de base. Il n'en est pas moins vrai que toutes les illusions qui s'attachent aujourd'hui à la notion de « personnalité modale » ou de « caractère national », avec les cercles vicieux qui en découlent, tiennent à la croyance que le caractère individuel est symbolique par lui-même, alors que, comme Mauss nous en avertissait (et les phénomènes psycho-pathologiques exceptés) il ne fournit que la matière première, ou les éléments, d'un symbolisme qui - nous l'avons vu plus haut - même sur le plan du groupe, ne parvient jamais à se parachever. Pas plus sur le plan du normal que sur celui du pathologique, l'extension au psychisme individuel des méthodes et des procédés de la psychanalyse ne peuvent donc parvenir à fixer l'image de la structure sociale, grâce à un miraculeux raccourci qui permettrait à l'ethnologie de s'éviter elle-même.
Le psychisme individuel ne reflète pas le groupe ; encore moins le préforme-t-il. On aura très suffisamment légitimé la valeur et l'importance des études qui se poursuivent aujourd'hui dans cette direction en reconnaissant qu'il le complète. Cette complémentarité entre psychisme individuel et structure sociale fonde la fertile collaboration réclamée par Mauss, qui s'est réalisée entre ethnologie et psychologie ; mais cette collaboration ne restera valable que si la première discipline continue à revendiquer, pour la description et l'analyse objective des coutumes et des institutions, une place que l'approfondissement de leurs incidences subjectives peut consolider, sans parvenir jamais à la faire passer au second plan.
II

Tels sont, nous semble-t-il, les points essentiels sur lesquels les trois essais : Psychologie et Sociologie, L'Idée de Mort et Les Techniques du Corps peuvent toujours utilement diriger la réflexion. Les trois autres qui complètent ce volume (et même en occupent la majeure partie) : Théorie générale de la Magie, Essai sur le don et Notion de Personne [10], mettent en présence d'un autre et plus décisif encore aspect de la pensée de Mauss, qui fût mieux ressorti si l'on eût pu jalonner les vingt années qui séparent la Magie du Don de quelques points de repère : L'Art et le Mythe [11] ; Anna-Virâj [12] ; Origine de la Notion de Monnaie [13] ; Dieux Ewhe de la Monnaie et du Change [14] ; Une Forme archaïque de Contrat chez les Thraces [15] ; Commentaires sur un Texte de Posidonius [16] ; et si le capital Essai sur le don eût été accompagné des textes qui témoignent de la même orientation : De quelques Formes primitives de Classification (en collaboration avec Durkheim) [17] ; Essai sur les Variations saisonnières des Sociétés eskimo [18] ; Gilft, Gift [19] ; Parentés à Plaisanteries [20] ; Wette, Wedding [21] ; Biens masculins et féminins en Droit celtique [22] ; Les Civilisations [23] ; Fragment d'un Plan de Sociologie générale descriptive [24].
En effet, et bien que l'Essai sur le don soit, sans contestation possible, le chef-d'œuvre de Mauss, son ouvrage le plus justement célèbre et celui dont l'influence a été la plus profonde, on commettrait une grave erreur en l'isolant du reste. C'est l'Essai sur le don qui a introduit et imposé la notion de fait social total ; mais on aperçoit sans peine comment cette notion se relie aux préoccupations, différentes en apparence seulement, que nous avons évoquées au cours des paragraphes précédents.
On pourrait même dire qu'elle les commande, puisque, comme elles mais de façon plus inclusive et systématique, elle procède du même souci de définir la réalité sociale ; mieux encore : de définir le social comme la réalité. Or, le social n'est réel qu'intégré en système, et c'est là un premier aspect de la notion de fait total : « Après avoir forcément un peu trop divisé et abstrait, il faut que les sociologues s'efforcent de recomposer le tout. » Mais le fait total ne réussit pas à être tel par simple réintégration des aspects discontinus : familial, technique, économique, juridique, religieux, sous l'un quelconque desquels on pourrait être tenté de l'appréhender exclusivement. Il faut aussi qu'il s'incarne dans une expérience individuelle, et cela à deux points de vue différents : d'abord dans une histoire individuelle qui permette d' « observer le comportement d'êtres totaux, et non divisés en facultés ; » ensuite dans ce qu'on aimerait appeler (en retrouvant le sens archaïque d'un terme dont l'application au cas présent est évidente), une anthropologie, c'est-à-dire un système d'interprétation rendant simultanément compte des aspects physique, physiologique, psychique et sociologique de toutes les conduites : « La seule étude de ce fragment de notre vie qui est notre vie en société ne suffit pas. »
Le fait social total se présente donc avec un caractère tri-dimensionnel. Il doit faire coïncider la dimension proprement sociologique avec ses multiples aspects synchroniques ; la dimension historique, ou diachronique ; et enfin la dimension physio-psychologique. Or, c'est seulement chez des individus que ce triple rapprochement peut prendre place. Si l'on s'attache à cette « étude du concret qui est du complet, » on doit nécessairement s'apercevoir que « ce qui est vrai, ce n'est pas la prière ou le droit, mais le Mélanésien de telle ou telle île, Rome, Athènes. »
Par conséquent, la notion de fait total est en relation directe avec le double souci, qui nous était apparu seul jusqu'à présent, de relier le social et l'individuel d'une part, le physique (ou physiologique) et le psychique de l'autre. Mais nous en comprenons mieux la raison, qui est elle-même double : d'une part, c'est seulement au terme de toute une série de réductions qu'on sera en possession du fait total, lequel comprend : 1° différentes modalités du social (juridique, économique, esthétique, religieux, etc.) ; 2° différents moments d'une histoire individuelle (naissance, enfance, éducation, adolescence, mariage, etc.) ; 3° différentes formes d'expression, depuis des phénomènes physiologiques comme des réflexes, des sécrétions, des ralentissements et des accélérations, jusqu'à des catégories inconscientes et des représentations conscientes, individuelles ou collectives. Tout cela est bien, en un sens, social, puisque c'est seulement sous forme de fait social que ces éléments de nature si diverse peuvent acquérir une signification globale et devenir une totalité. Mais l'inverse est également vrai : car la seule garantie que nous puissions avoir qu'un fait total corresponde à la réalité, au lieu d'être l'accumulation arbitraire de détails plus ou moins véridiques, est qu'il soit saisissable dans une expérience concrète : d'abord, d'une société localisée dans l'espace ou le temps, « Rome, Athènes » ; mais aussi d'un individu quelconque de l'une quelconque de ces sociétés, « le Mélanésien de telle ou telle île ». Donc, il est bien vrai qu'en un sens, tout phénomène psychologique est un phénomène sociologique, que le mental s'identifie avec le social. Mais, dans un autre sens, tout se renverse la preuve du social, elle, ne peut être que mentale autrement dit, nous ne pouvons jamais être sûrs d'avoir atteint le sens et la fonction d'une institution, si nous ne sommes pas en mesure de revivre son incidence sur une conscience individuelle. Comme cette incidence est une partie intégrante de l'institution, toute interprétation doit faire coïncider l'objectivité de l'analyse historique ou comparative avec la subjectivité de l'expérience vécue. En poursuivant ce qui nous était apparu comme une des orientations de la pensée de Mauss, nous étions parvenu tout à l'heure à l'hypothèse d'une complémentarité entre le psychique et le social. Cette complémentarité n'est pas statique, comme le serait celle des deux moitiés d'un puzzle, elle est dynamique et provient de ce que le psychique est à la fois simple élément de signification pour un symbolisme qui le déborde, et seul moyen de vérification d'une réalité dont les aspects multiples ne peuvent être saisis sous forme de synthèse en dehors de lui.
Il y a donc beaucoup plus, dans la notion de fait social total, qu'une recommandation à l'adresse des enquêteurs, pour qu'ils ne manquent pas de mettre en rapport les techniques agricoles et le rituel, ou la construction du canot, la forme de l'agglomération familiale et les règles de distribution des produits de la pêche. Que le fait social soit total ne signifie pas seulement que tout ce qui est observé fait partie de l'observation ; mais aussi, et surtout, que dans une science où l'observateur est de même nature que son objet, l'observateur est lui-même une partie de son observation. Nous ne faisons pas ainsi allusion aux modifications que l'observation ethnologique apporte inévitablement au fonctionnement de la société où elle s'exerce, car cette difficulté n'est pas propre aux sciences sociales ; elle intervient partout où l'on se propose de faire des mesures fines, c'est-à-dire où l'observateur (lui-même, ou ses moyens d'observation) sont du même ordre de grandeur que l'objet observé. D'ailleurs, ce sont les physiciens qui l'ont mise en évidence, et non les sociologues auxquels elle s'impose seulement de la même façon. La situation particulière des sciences sociales est d'une autre nature, qui tient au caractère intrinsèque de son objet d'être à la fois objet et sujet, ou, pour parler le langage de Durkheim et de Mauss, « chose » et « représentation ». Sans doute pourrait-on dire que les sciences physiques et naturelles se trouvent dans le même cas, puisque tout élément du réel est un objet, mais qui suscite des représentations, et qu'une explication intégrale de l'objet devrait rendre compte simultanément de sa structure propre, et des représentations par l'intermédiaire desquelles nous appréhendons ses propriétés. En théorie, cela est vrai : une chimie totale devrait nous expliquer, non seulement la forme et la distribution des molécules de la fraise, mais comment une saveur unique résulte de cet arrangement. Cependant, l'histoire prouve qu'une science satisfaisante n'a pas besoin d'aller aussi loin et qu'elle peut, pendant des siècles, et éventuellement des millénaires (puisque nous ignorons quand elle y parviendra) progresser dans la connaissance de son objet à l'abri d'une distinction éminemment instable, entre des qualités propres à l'objet, qu'on cherche seules à expliquer, et d'autres qui sont fonction du sujet et dont la considération peut être laissée de côté.
Quand Mauss parle de faits sociaux totaux, il implique au contraire (si nous l'interprétons correctement) que cette dichotomie facile et efficace est interdite au sociologue, ou tout au moins, qu'elle ne pouvait correspondre qu'à un état provisoire et fugitif du développement de sa science. Pour comprendre convenablement un fait social, il faut l'appréhender totalement, c'est-à-dire du dehors comme une chose, mais comme une chose dont fait cependant partie intégrante l'appréhension subjective (consciente et inconsciente) que nous en prendrions si, inéluctablement hommes, nous vivions le fait comme indigène au lieu de l'observer comme ethnographe. Le problème est de savoir comment il est possible de réaliser cette ambition, qui ne consiste pas seulement à appréhender un objet, simultanément, du dehors et du dedans, mais qui demande bien davantage : car il faut que l'appréhension interne (celle de l'indigène, ou tout au moins celle de l'observateur revivant l'expérience indigène) soit transposée dans les termes de l'appréhension externe, fournissant certains éléments d'un ensemble qui, pour être valide, doit se présenter de façon systématique et coordonnée.
La tâche serait irréalisable si la distinction répudiée par les sciences sociales entre l'objectif et le subjectif était aussi rigoureuse que doit l'être la même distinction, quand elle est provisoirement admise par les sciences physiques. Mais précisément, ces dernières s'inclinent temporairement devant une distinction qu'elles veulent rigoureuse, tandis que les sciences sociales repoussent définitivement une distinction qui, chez elles, ne saurait être que floue. Qu'entendons-nous par là ? C'est que, dans la mesure même où la distinction théorique est impossible, elle peut être poussée beaucoup plus loin dans la pratique, jusqu'à rendre un de ses termes négligeable, au moins par rapport à l'ordre de grandeur de l'observation. Une fois posée la distinction entre objet et sujet, le sujet lui-même peut à nouveau se dédoubler de la même façon, et ainsi de suite, de façon illimitée, sans être jamais réduit à néant. L'observation sociologique, condamnée, semble-t-il, par l'insurmontable antinomie que nous avons dégagée au paragraphe précédent, s'en lire grâce à la capacité du sujet de s'objectiver indéfiniment, c'est-à-dire (sans parvenir jamais à s'abolir comme sujet) de projeter au dehors des fractions toujours décroissantes de soi. Théoriquement au moins, ce morcellement n'a pas de limite, sinon d'impliquer toujours l'existence des deux termes comme condition de sa possibilité.
La place éminente de l'ethnographie dans les sciences de l'homme, qui explique le rôle qu'elle joue déjà dans certains pays, sous le nom d'anthropologie sociale et culturelle, comme inspiratrice d'un nouvel humanisme, provient de ce qu'elle présente sous une forme expérimentale et concrète ce processus illimité d'objectivation du sujet, qui, pour l'individu, est si difficilement réalisable. Les milliers de sociétés qui existent ou ont existé à la surface de la terre sont humaines, et à ce titre nous y participons de façon subjective : nous aurions pu y naître et pouvons donc chercher à les comprendre comme si nous y étions nés. Mais en même temps, leur ensemble, par rapport à l'une quelconque d'entre elles, atteste la capacité du sujet de s'objectiver dans des proportions pratiquement illimitées, puisque cette société de référence, qui ne constitue qu'une infime fraction du donné, est elle-même toujours exposée à se subdiviser en deux sociétés différentes, dont une irait rejoindre la masse énorme de ce qui, pour l'autre, est et sera toujours objet, et ainsi de suite indéfiniment. Toute société différente de la nôtre est objet, tout groupe de notre propre société, autre que celui dont nous relevons, est objet, tout usage de ce groupe même, auquel nous n'adhérons pas, est objet. Mais cette série illimitée d'objets, qui constitue l'Objet de l'ethnographie, et que le sujet devrait arracher douloureusement de lui si la diversité des mœurs et des coutumes ne le mettait en présence d'un morcellement opéré d'avance, jamais la cicatrisation historique ou géographique ne saurait lui faire oublier (au risque d'anéantir le résultat de ses efforts) qu'ils procèdent de lui, et que leur analyse, la plus objectivement conduite, ne saurait manquer de les réintégrer dans la subjectivité.
*
* *
Le risque tragique qui guette toujours l'ethnographe, lancé dans cette entreprise d'identification, est d'être la victime d'un malentendu ; c'est-à-dire que l'appréhension subjective à laquelle il est parvenu ne présente avec celle de l'indigène aucun point commun, en dehors de sa subjectivité même. Cette difficulté serait insoluble, les subjectivités étant, par hypothèse, incomparables et incommunicables, si l'opposition entre moi et autrui ne pouvait être surmontée sur un terrain, qui est aussi celui où l'objectif et le subjectif se rencontrent, nous voulons dire l'inconscient. D'une part, en effet, les lois de l'activité inconsciente sont toujours en dehors de l'appréhension subjective (nous pouvons en prendre conscience, mais comme objet) ; et de l'autre, pourtant, ce sont elles qui déterminent les modalités de cette appréhension.
Il n'est donc pas étonnant que Mauss, pénétré de la nécessité d'une étroite collaboration entre sociologie et psychologie, ait constamment fait appel à l'inconscient comme fournissant le caractère commun et spécifique des faits sociaux : « En magie comme en religion comme en linguistique, ce sont les idées inconscientes qui agissent. » Et dans ce même mémoire sur la magie, d'où la citation précédente est extraite, on assiste à un effort, sans doute encore indécis, pour formuler les problèmes ethnologiques autrement qu'à J'aide des « catégories rigides et abstraites de notre langage et de notre raison, » en termes d'une « psychologie non intellectualiste » étrangère à nos « entendements d'adultes européens, » où l'on aurait tout à fait tort de discerner un accord anticipé avec le prélogisme de Lévy-Bruhl, que Mauss ne devait jamais accepter. Il faut plutôt en rechercher le sens dans la tentative qu'il a lui-même faite, à propos de la notion de mana, pour atteindre une sorte de « quatrième dimension » de l'esprit, un plan sur lequel se confondraient les notions de « catégorie inconsciente » et de « catégorie de la pensée collective ».
Mauss voyait donc juste quand il constatait dès 1902 qu' « en somme, dès que nous en arrivons à la représentation des propriétés magiques, nous sommes en présence de phénomènes semblables à ceux du langage. » Car c'est la linguistique, et plus particulièrement la linguistique structurale, qui nous a familiarisés depuis lors avec l'idée que les phénomènes fondamentaux de la vie de l'esprit, ceux qui la conditionnent et déterminent ses formes les plus générales, se situent à l'étage de la pensée inconsciente. L'inconscient serait ainsi le terme médiateur entre moi et autrui. En approfondissant ses données, nous ne nous prolongeons pas, si l'on peut dire, dans le sens de nous-mêmes : nous rejoignons un plan qui ne nous paraît pas étranger parce qu'il recèle notre moi le plus secret ; mais (beaucoup plus normalement) parce que, sans nous faire sortir de nous-même, il nous met en coïncidence avec des formes d'activité qui sont à la fois nôtres et autres, conditions de toutes les vies mentales de tous les hommes et de tous les temps. Ainsi, l'appréhension (qui ne peut être qu'objective) des formes inconscientes de l'activité de l'esprit conduit tout de même à la subjectivation ; puisqu'en définitive, c'est une opération du même type qui, dans la psychanalyse, permet de reconquérir à nous-même notre moi le plus étranger, et, dans l'enquête ethnologique, nous fait accéder au plus étranger des autrui comme à un autre nous. Dans les deux cas, c'est le même problème qui se pose, celui d'une communication cherchée, tantôt entre un moi subjectif et un moi objectivant, tantôt entre un moi objectif et un autre subjectivé. Et, dans les deux cas aussi, la recherche la plus rigoureusement positive des itinéraires inconscients de cette rencontre, tracés une fois pour toutes dans la structure innée de l'esprit humain et dans l'histoire particulière et irréversible des individus ou des groupes, est la condition du succès.
Le problème ethnologique est donc, en dernière analyse, un problème de communication ; et cette constatation doit suffire à séparer radicalement la voie suivie par Mauss, en identifiant inconscient et collectif de celle de Jung, qu'on pourrait être tenté de définir pareillement. Car ce n'est pas la même chose de définir l'inconscient comme une catégorie de la pensée collective ou de le distinguer en secteurs, selon le caractère individuel ou collectif du contenu qu'on lui prête. Dans les deux cas, on conçoit l'inconscient comme un système symbolique ; mais pour Jung, l'inconscient ne se réduit pas au système : il est tout plein de symboles, et même de choses symbolisées qui lui forment une sorte de substrat. Ou ce substrat est inné : mais sans hypothèse théologique, il est inconcevable que le contenu de l'expérience la précède ; ou il est acquis : or, le problème de l'hérédité d'un inconscient acquis ne serait pas moins redoutable que celui des caractères biologiques acquis. En fait, il ne s'agit pas de traduire en symboles un donné extrinsèque, mais de réduire à leur nature de système symbolique des choses qui n'y échappent que pour s'incommunicabiliser. Comme le langage, le social est une réalité autonome (la même, d'ailleurs) ; les symboles sont plus réels que ce qu'ils symbolisent, le signifiant précède et détermine le signifié. Nous retrouverons ce problème à propos du mana.
Le caractère révolutionnaire de l'Essai sur le don est de nous engager sur cette voie. Les faits qu'il met en lumière ne constituent pas des découvertes. Deux ans auparavant, M. Davy avait analysé et discuté le potlatch sur la base des enquêtes de Boas et de Swanton, dont Mauss lui-même s'était attaché à souligner l'importance dans son enseignement dès avant 1914 ; et tout l'Essai sur le don émane, de la façon la plus directe, des Argonauts of Western Pacific que Malinowski avait publiés deux ans auparavant aussi, et qui devaient, indépendamment, le conduire à des conclusions très voisines de celles de Mauss [25] ; parallélisme qui inciterait à regarder les indigènes mélanésiens eux-mêmes comme les véritables auteurs de la théorie moderne de la réciprocité. D'où vient donc le pouvoir extraordinaire de ces pages désordonnées, qui ont encore quelque chose du brouillon, où se juxtaposent de façon si curieuse les notations impressionnistes et, comprimée le plus souvent dans un appareil critique qui écrase le texte, une érudition inspirée, qui semble glaner au hasard des références américaines, indiennes, celtiques, grecques ou océaniennes, mais toujours également probantes ? Peu de personnes ont pu lire l'Essai sur le don sans ressentir toute la gamme des émotions si bien décrites par Malebranche évoquant sa première lecture de Descartes : le cœur battant, la tête bouillonnante, et l'esprit envahi d'une certitude encore indéfinissable, mais impérieuse, d'assister à un événement décisif de l'évolution scientifique.
Mais c'est que, pour la première fois dans l'histoire de la pensée ethnologique, un effort était fait pour transcender l'observation empirique et atteindre des réalités plus profondes. Pour la première fois, le social cesse de relever du domaine de la qualité pure : anecdote, curiosité, matière à description moralisante ou à comparaison érudite et devient un système, entre les parties duquel on peut donc découvrir des connexions, des équivalences et des solidarités. Ce sont d'abord les produits de l'activité sociale : technique, économique, rituelle, esthétique ou religieuse - outils, produits manufacturés, produits alimentaires, formules magiques, ornements, chants, danses et mythes - qui sont rendus comparables entre eux par ce caractère commun que tous possèdent d'être transférables, selon des modalités qui peuvent être analysées et classées et qui, même quand elles paraissent inséparables de certains types de valeurs, sont réductibles à des formes plus fondamentales, celles-là générales. Ils ne sont, d'ailleurs, pas seulement comparables, mais souvent substituables, dans la mesure où des valeurs différentes peuvent se remplacer dans la même opération. Et surtout, ce sont les opérations elles-mêmes, aussi diverses qu'elles puissent paraître à travers les événements de la vie sociale : naissance, initiation, mariage, contrat, mort ou succession ; et aussi arbitraires par le nombre et la distribution des individus qu'elles mettent en cause, comme récipiendaires, intermédiaires ou donateurs, qui autorisent toujours une réduction à un plus petit nombre d'opérations, de groupes ou de personnes, où l'on ne retrouve plus, en fin de compte, que les termes fondamentaux d'un équilibre, diversement conçu et différemment réalisé selon le type de société considéré. Les types deviennent donc définissables par ces caractères intrinsèques ; et comparables entre eux puisque ces caractères ne se situent plus dans un ordre qualitatif, mais dans le nombre et l'arrangement d'éléments qui sont eux-mêmes constants dans tous les types. Pour prendre un exemple chez un savant qui, mieux peut-être qu'aucun autre, a su comprendre et exploiter les possibilités ouvertes par cette méthode [26] : les interminables séries de fêtes et de cadeaux qui accompagnent le mariage en Polynésie, mettant en cause des dizaines, sinon des centaines de personnes, et qui semblent défier la description empirique, peuvent être analysées en trente ou trente-cinq prestations s'effectuant entre cinq lignées qui sont entre elles dans un rapport constant, et décomposables en quatre cycles de réciprocité entre les lignées A et B, A et C, A et D, et A et E ; le tout exprimant un certain type de structure sociale tel que, par exemple, des cycles entre B et C, ou entre E et B ou D, ou enfin, entre E et C soient exclus, alors qu'une autre forme de société les placerait au premier plan. La méthode est, d'une application si rigoureuse que si une erreur apparaissait dans la solution des équations ainsi obtenues, elle aurait plus de chance d'être imputable à une lacune dans la connaissance des institutions indigènes qu'à une faute de calcul. Ainsi, dans l'exemple qui vient d'être cité, on constate que le cycle entre A et B s'ouvre par une prestation sans contrepartie ; ce qui inviterait aussitôt à rechercher, si on ne la connaissait pas, la présence d'une action unilatérale, antérieure aux cérémonies matrimoniales, bien qu'en relation directe avec elles. Tel est exactement le rôle joué dans la société en question par l'abduction de la fiancée, dont la première prestation représente, selon la terminologie indigène elle-même, la « compensation ». On aurait donc pu la déduire, si elle n'avait pas été observée.
On remarquera que cette technique opératoire est très voisine de celle que Troubetzkoy et Jakobson mettaient au point, à la même époque où Mauss écrivait l'Essai, et qui devait leur permettre de fonder la linguistique structurale ; là aussi, il s'agissait de distinguer un donné purement phénoménologique, sur lequel l'analyse scientifique, n'a pas de prise, d'une infrastructure plus simple que lui, et à laquelle il doit toute sa réalité [27]. Grâce aux notions de « variantes facultatives », de « variantes combinatoires », de « termes de groupe » et de « neutralisation », l'analyse phonologique allait précisément permettre de définir une langue par un petit nombre de relations constantes, dont la diversité et la complexité apparente du système phonétique ne font qu'illustrer la gamme possible des combinaisons autorisées.
Comme la phonologie pour la linguistique, l'Essai sur le don inaugure donc une ère nouvelle pour les sciences sociales. L'importance de ce double événement (malheureusement resté, chez Mauss, à l'état d'esquisse) ne petit mieux être comparée qu'à la découverte de l'analyse combinatoire pour la pensée mathématique moderne. Que Mauss n'ait jamais entrepris l'exploitation de sa découverte et qu'il ait ainsi inconsciemment incité Malinowski (dont on peut reconnaître, sans faire injure à sa mémoire, qu'il fut meilleur observateur que théoricien) à se lancer seul, sur la base des mêmes faits et des conclusions analogues auxquelles ils étaient indépendamment parvenus, dans l'élaboration du système correspondant, est un des grands malheurs de l'ethnologie contemporaine.
Il est difficile de savoir dans quel sens Mauss aurait développé sa doctrine, s'il avait consenti à le faire. L'intérêt principal d'une de ses oeuvres les plus tardives, la Notion de Personne, également publiée dans ce volume, est moins dans l'argumentation, qu'on pourra trouver cursive et parfois négligente, que dans la tendance qui s'y fait jour d'étendre à l'ordre diachronique une technique de permutations que l'Essai sur le don concevait plutôt en fonction des phénomènes synchroniques. Quoi qu'il en soit, Mauss aurait probablement rencontré certaines difficultés à pousser plus avant l'élaboration du système, nous verrons pourquoi tout à l'heure. Mais il ne lui aurait certes pas donné la forme régressive qu'il devait recevoir de Malinowski, pour qui la notion de fonction, conçue par Mauss à l'exemple de l'algèbre, c'est-à-dire impliquant que les valeurs sociales sont connaissables en fonction les unes des autres, se transforme dans le sens d'un empirisme naïf, pour ne plus désigner que le service pratique rendu à la société par ses coutumes et ses institutions. Là où Mauss envisageait un rapport constant entre des phénomènes, où se trouve leur explication, Malinowski se demande seulement à quoi ils servent, pour leur chercher une justification. Cette position du problème anéantit tous les progrès antérieurs, puisqu'elle réintroduit un appareil de postulats sans valeur scientifique.
Que la position du problème telle que Mauss l'avait définie fut la seule fondée est, au contraire, attesté par les plus récents développements des sciences sociales, qui permettent de former l'espoir de leur mathématisation progressive. Dans certains domaines essentiels, comme celui de la parenté, l'analogie avec le langage, si fermement affirmée par Mauss, a pu permettre de découvrir les règles précises selon lesquelles se forment, dans n'importe quel type de société, des cycles de réciprocité dont les lois mécaniques sont désormais connues, permettant l'emploi du raisonnement déductif dans un domaine qui paraissait soumis à l'arbitraire le plus complet. D'autre part, en s'associant de plus en plus étroitement à la linguistique, pour constituer un jour avec elle une vaste science de la communication, l'anthropologie sociale peut espérer bénéficier des immenses perspectives ouvertes à la linguistique elle-même, par l'application du raisonnement mathématique à l'étude des phénomènes de communication [28]. Dès à présent, nous savons qu'un grand nombre de problèmes ethnologiques et sociologiques, soit sur le plan de la morphologie, soit même sur celui de l'art ou de la religion, n'attendent que le bon vouloir des mathématiciens qui, avec la collaboration d'ethnologues, pourraient leur faire accomplir des progrès décisifs, sinon encore vers une solution, mais au moins vers une unification préalable, qui est la condition de leur solution.
III

Ce n'est donc pas dans un esprit de critique, mais plutôt inspirés du devoir de ne pas laisser perdre ou corrompre la partie la plus féconde de son enseignement, que nous sommes conduit à rechercher la raison pour laquelle Mauss s'est arrêté sur le bord de ces immenses possibilités, comme Moïse conduisant son peuple jusqu'à une terre promise dont il ne contemplerait jamais la splendeur. Il doit y avoir quelque part un passage décisif que Mauss n'a pas franchi, et qui peut sans doute expliquer pourquoi le novum organum des sciences sociales du XXe siècle, qu'on pouvait attendre de lui, et dont il tenait tous les fils conducteurs, ne s'est jamais révélé que sous forme de fragments.
Un curieux aspect de l'argumentation suivie dans l'Essai sur le don nous mettra sur la voie de la difficulté. Mauss y apparaît, avec raison, dominé par une certitude d'ordre logique, à savoir que l'échange est le commun dénominateur d'un grand nombre d'activités sociales en apparence hétérogènes entre elles. Mais, cet échange, il ne parvient pas à le voir dans les faits. L'observation empirique ne lui fournit pas l'échange, mais seulement - comme il le dit lui-même - « trois obligations : donner, recevoir, rendre. » Toute la théorie réclame ainsi l'existence d'une structure, dont l'expérience n'offre que les fragments, les membres épars, ou plutôt les éléments. Si l'échange est nécessaire et s'il n'est pas donné, il faut donc le construire. Comment ? En appliquant aux corps isolés, seuls présents, une source d'énergie qui opère leur synthèse. « On peut... prouver que dans les choses échangées... il y a une vertu qui force les dons à circuler, à être donnés, à être rendus. » Mais c'est ici que la difficulté commence. Cette vertu existe-t-elle objectivement, comme une propriété physique des biens échangés ? Évidemment non ; cela serait d'ailleurs impossible, puisque les biens en question ne sont pas seulement des objets physiques, mais aussi des dignités, des charges, des privilèges, dont le rôle sociologique est cependant le même que celui des biens matériels. Il faut donc que la vertu soit conçue subjectivement ; mais alors, on se trouve placé devant une alternative : ou cette vertu n'est pas autre chose que l'acte d'échange lui-même, tel que se le représente la pensée indigène, et on se trouve enfermé dans un cercle ; ou elle est d'une nature différente, et par rapport à elle, l'acte d'échange devient alors un phénomène secondaire.
Le seul moyen d'échapper au dilemme eût été de s'apercevoir que c'est l'échange qui constitue le phénomène primitif, et non les opérations discrètes en lesquelles la vie sociale le décompose. Là comme ailleurs, mais là surtout, devait s'appliquer un précepte que Mauss lui-même avait déjà formulé dans l'Essai sur la Magie : « L'unité du tout est encore plus réelle que chacune des parties. » Au contraire, dans l'Essai sur le don, Mauss s'acharne à reconstruire un tout avec des parties, et comme c'est manifestement impossible, il lui faut ajouter au mélange une quantité supplémentaire qui lui donne l'illusion de retrouver son compte. Cette quantité, c'est le hau.
Ne sommes-nous pas ici devant un de ces cas (qui ne sont pas si rares) où l'ethnologue se laisse mystifier par l'indigène ? Non certes par l'indigène en général, qui n'existe pas, mais par un groupe indigène déterminé, où des spécialistes se sont déjà penchés sur des problèmes, se sont posé des questions et ont essayé d'y répondre. En l'occurrence, et au lieu de suivre jusqu'au bout l'application de ses principes, Mauss y renonce en faveur d'une théorie néo-zélandaise, qui a une immense valeur comme document ethnographique, mais qui n'est pas autre chose qu'une théorie. Or, ce n'est pas une raison parce que des sages maori se sont posé les premiers certains problèmes, et les ont résolus de façon infiniment intéressante, mais fort peu satisfaisante, pour s'incliner devant leur interprétation. Le hau n'est pas la raison dernière de l'échange : c'est la forme consciente sous laquelle des hommes d'une société déterminée, où le problème avait une importance particulière, ont appréhendé une nécessité inconsciente dont la raison est ailleurs.
A l'instant le plus décisif, Mauss est donc pris d'une hésitation et d'un scrupule. Il ne sait plus exactement s'il doit faire le tableau de la théorie, ou la théorie de la réalité, indigènes. En quoi il a raison dans une très large mesure : la théorie indigène est dans une relation beaucoup plus directe avec la réalité indigène que ne le serait une théorie élaborée à partir de nos catégories et de nos problèmes. C'était donc un très grand progrès, au moment où il écrivait, que d'attaquer un problème ethnographique à partir de sa théorie néo-zélandaise ou mélanésienne, plutôt qu'à l'aide de notions occidentales comme l'animisme, le mythe ou la participation. Mais, indigène ou occidentale, la théorie n'est jamais qu'une théorie. Elle offre tout au plus une voie d'accès, car ce que croient les intéressés, fussent-ils fuégiens ou australiens, est toujours fort éloigné de ce qu'ils pensent ou font effectivement. Après avoir dégagé la conception indigène, il fallait la réduire par une critique objective qui permette d'atteindre la réalité sous-jacente. Or, celle-ci a beaucoup moins de chance de se trouver dans des élaborations conscientes, que dans des structures mentales inconscientes qu'on peut atteindre à travers les institutions, et mieux encore dans le langage. Le hau est un produit de la réflexion indigène ; mais la réalité est plus apparente dans certains traits linguistiques que Mauss n'a pas manqué de relever, sans leur donner toute l'importance qui convenait : « Papou et Mélanésien, » note-t-il, « n'ont qu'un seul mot pour désigner l'achat et la vente, le prêt et l'emprunt. Les opérations antithétiques sont exprimées par le même mot. » Toute la preuve est là, que les opérations en question loin d'être « antithétiques », ne sont que deux modes d'une même réalité. On n'a pas besoin du hau pour faire la synthèse, parce que l'antithèse n'existe pas. Elle est une illusion subjective des ethnographes et parfois aussi des indigènes qui, quand ils raisonnent sur eux-mêmes - ce qui leur arrive assez souvent - se conduisent en ethnographes ou plus exactement en sociologues, c'est-à-dire en collègues avec lesquels il est loisible de discuter.
A ceux qui nous reprocheraient de tirer la pensée de Mauss dans un sens trop rationaliste, quand nous nous efforçons de la reconstruire sans faire appel à des notions magiques ou affectives dont l'intervention nous semble résiduelle, nous répondrons que cet effort pour comprendre la vie sociale comme un système de relations, qui anime l'Essai sur le don, Mauss se l'est explicitement assigné dès le début de sa carrière, dans l'Esquisse d'une théorie générale de la Magie qui inaugure ce volume. C'est lui, et non pas nous, qui affirme la nécessité de comprendre l'acte magique comme un jugement. C'est lui qui introduit dans la critique ethnographique une distinction fondamentale entre jugement analytique et jugement synthétique, dont l'origine philosophique se trouve dans la théorie des notions mathématiques. Ne sommes-nous pas, dès lors, fondé à dire que si Mauss avait pu concevoir le problème du jugement autrement que dans les termes de la logique classique, et le formuler en termes de logique des relations, alors, avec le rôle même de la copule, se seraient effondrées les notions qui en tiennent lieu dans son argumentation (il le dit expressément : « le mana... joue le rôle de la copule dans la proposition »), c'est-à-dire le mana dans la théorie de la magie, et le hau dans la théorie du don ?
*
* *
A vingt ans d'intervalle en effet, l'argumentation de l'Essai sur le don reproduit (au moins dans son début) celle de la Théorie de la Magie. Cela seul justifierait l'inclusion dans ce volume d'un travail dont il faut considérer la date ancienne (1902) pour ne pas commettre d'injustice en le jugeant, C'était l'époque où l'ethnologie comparée n'avait pas encore renoncé, en grande partie, à l'instigation de Mauss lui-même, et comme il devait le dire dans l'Essai sur le don, « à cette comparaison constante où tout se mêle et où les institutions perdent toute couleur locale et les documents leur saveur. » C'est plus tard seulement qu'il allait s'attacher à fixer l'attention sur des sociétés « qui représentent vraiment des maxima, des excès, qui permettent mieux de voir les faits que là où, non moins essentiels, ils restent encore petits et involués. » Mais pour comprendre l'histoire de sa pensée, pour dégager certaines de ses constantes, l'Esquisse offre une valeur exceptionnelle. Et cela est vrai, non seulement pour l'intelligence de la pensée de Mauss, mais pour apprécier l'histoire de l'École sociologique française, et la relation exacte entre la pensée de Mauss et celle de Durkheim. En analysant les notions de mana, de wakan, et d'orenda, en édifiant sur leur base une interprétation d'ensemble de la magie et en rejoignant par là ce qu'il considère comme des catégories fondamentales de l'esprit humain, Mauss anticipe de dix ans l'économie et certaines conclusions des Formes élémentaires de la Vie religieuse. L'Esquisse montre donc l'importance de la contribution de Mauss à la pensée de Durkheim ; elle permet de reconstituer quelque chose de cette intime collaboration entre l'oncle et le neveu qui ne s'est pas limitée au champ ethnographique, puisqu'on connaît, par ailleurs, le rôle essentiel joué par Mauss dans la préparation du Suicide.
Mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est la structure logique de l’œuvre. Elle est tout entière fondée sur la notion de mana, et on sait que, sous ce pont, beaucoup d'eau a passé depuis. Pour rattraper le courant, il faudrait d'abord intégrer à l'Esquisse les résultats plus récents obtenus sur le terrain et ceux tirés de l'analyse linguistique [29]. Il faudrait aussi compléter les divers types de mana en introduisant dans cette famille déjà vaste, et pas très harmonieuse, la notion, si fréquente chez les indigènes de l'Amérique du Sud, d'une sorte de mana substantiel et le plus souvent négatif : fluide que le shaman manipule, qui se dépose sur les objets sous une forme observable, qui provoque des déplacements et des lévitations et dont l'action est généralement considérée comme nocive. Ainsi le tsaruma des Jivaro, le nandé dont nous avons nous-même étudié la représentation chez les Nambikwara [30], et toutes les formes analogues signalées chez les Amniapâ, Apapocuva, Apinayé, Galibi, Chiquito, Lamisto, Chamieuro, Xebero, Yameo, lquito, etc. [31]. Que subsisterait-il de la notion de mana après une telle mise au point ? C'est difficile à dire ; en tout cas, elle en sortirait profanée. Non que Mauss et Durkheim aient eu tort, comme on le prétend parfois, de rapprocher des notions empruntées à des régions du monde éloignées les unes des autres, et de les constituer en catégorie. Même si l'histoire confirme les conclusions de l'analyse linguistique et que le terme polynésien mana soit un lointain rejeton d'un terme indonésien définissant l'efficace de dieux personnels, il n'en résulterait nullement que la notion connotée par ce terme en Mélanésie et en Polynésie soit un résidu, ou un vestige, d'une pensée religieuse plus élaborée. Malgré toutes les différences locales, il paraît bien certain que mana, wakan, orenda représentent des explications du même type ; il est donc légitime de constituer le type, de chercher à le classer, et de l'analyser.
La difficulté de la position traditionnelle en matière de mana nous paraît être d'une autre nature. A l'inverse de ce qu'on croyait en 1902, les conceptions du type mana sont si fréquentes et si répandues qu'il convient de se demander si nous ne sommes pas en présence d'une forme de pensée universelle et permanente, qui, loin de caractériser certaines civilisations, ou prétendus « stades » archaïques ou mi-archaïques de l'évolution de l'esprit humain, serait fonction d'une certaine situation de l'esprit en présence des choses, devant donc apparaître chaque fois que cette situation est donnée. Mauss cite dans l'Esquisse une remarque très profonde du Père Thavenet à propos de la notion de manitou chez les Algonkins : « ... Il désigne plus particulièrement tout être qui n'a pas encore un nom commun, qui n'est pas familier : d'une salamandre une femme disait qu'elle avait peur, c'était un manitou ; on se moque d'elle en lui disant le nom. Les perles des trafiquants sont les écailles d'un manitou et le drap, cette chose merveilleuse, est la peau d'un manitou. » De même, le premier groupe d'Indiens Tupi-Kawahib à demi civilisés, avec l'aide desquels nous devions pénétrer, en 1938, dans un village inconnu de la tribu, admirant les coupes de flanelle rouge dont nous leur faisions présent s'écriaient : O que é este bicho vermelho ? : « Qu'est-ce que c'est que cette bête rouge ? » ; ce qui n'était ni un témoignage d'animisme primitif, ni la traduction d'une notion indigène, mais seulement un idiotisme du falar cabóclo, c'est-à-dire du portugais rustique de l'intérieur du Brésil. Mais, inversement, les Nambikwara, qui n'avaient jamais vu de bœufs avant 1915, les désignent comme ils ont toujours fait des étoiles, du nom de alásu, dont la connotation est très voisine de l'algonkin manitou [32].
Ces assimilations ne sont pas si extraordinaires ; avec plus de réserve sans doute, nous en pratiquons qui sont du même type, quand nous qualifions un objet inconnu ou dont l'usage s'explique mal, ou dont l'efficacité nous surprend, de truc ou de machin. Derrière machin, il y a machine, et, plus lointainement, l'idée de force ou de pouvoir. Quant à truc, les étymologistes le dérivent d'un terme médiéval qui signifie le coup heureux aux jeux d'adresse ou de hasard, c'est-à-dire un des sens précis qu'on donne au terme indonésien où certains voient l'origine du mot mana [33]. Nous De disons certes pas d'un objet qu'il a « du truc » ou « du machin », mais dune personne, nous disons qu'elle a « quelque chose » et quand le slang américain attribue à une femme du « oomph », il n'est pas sûr, si l'on évoque l'atmosphère sacrée et tout imbue de tabous qui, en Amérique plus encore qu'ailleurs, imprègne la vie sexuelle, que nous soyons très éloignés du sens de mana. La différence tient moins aux notions elles-mêmes, telles que l'esprit les élabore partout inconsciemment, qu'au fait que, dans notre société, ces notions ont un caractère fluide et spontané, tandis qu'ailleurs elles servent à fonder des systèmes réfléchis et officiels d'interprétation, c'est-à-dire un rôle que nous-mêmes réservons à la science. Mais, toujours et partout, ces types de notions interviennent, un peu comme des symboles algébriques, pour représenter une valeur indéterminée de signification, en elle-même vide de sens et donc susceptible de recevoir n'importe quel sens, dont l'unique fonction est de combler un écart entre le, signifiant et le signifié, ou, plus exactement, de signaler le fait que dans telle circonstance, telle occasion, ou telle de leurs manifestations, un rapport d'inadéquation s'établit entre signifiant et signifié au préjudice de la relation complémentaire antérieure.
Nous nous plaçons donc sur une voie étroitement parallèle à celle de Mauss invoquant la notion de mana comme fondement de certains jugements synthétiques a priori. Mais nous nous refusons à le rejoindre, quand il va chercher l'origine de la notion de mana dans un autre ordre de réalités que les relations qu'elle aide à construire : ordre de sentiments, volitions et croyances, qui sont, du point de vue de l'explication sociologique, soit des épiphénomènes, soit des mystères, en tout cas des objets extrinsèques au champ d'investigation. Là est, à notre sens, la raison pour laquelle une enquête si riche, si pénétrante, si pleine d'illuminations, tourne court et aboutit à une conclusion décevante. En fin de compte, le mana ne serait que « l'expression de sentiments sociaux qui se sont formés tantôt fatalement, et universellement tantôt fortuitement, à l'égard de certaines choses, choisies pour la plupart d'une façon arbitraire... » [34]. Mais les notions de sentiment, de fatalité, de fortuité et d'arbitraire ne sont pas des notions scientifiques. Elles n'éclairent pas les phénomènes qu'on s'est proposé d'expliquer, elles y participent. On voit donc que clans un cas au moins, la notion de mana présente les caractères de puissance secrète, de force mystérieuse, que Durkheim et Mauss lui ont attribués : tel est le rôle qu'elle joue dans leur propre système. Là vraiment, le mana est mana, Mais en même temps, on se demande si leur théorie du mana est autre chose qu'une imputation à la pensée indigène de propriétés impliquées par la place très particulière que l'idée de mana est appelée à tenir dans la leur.
On ne saurait trop mettre en garde, par conséquent, les admirateurs sincères de Mauss qui seraient tentés de s'arrêter à cette première étape de sa pensée, et qui adresseraient leur reconnaissance, moins à ses analyses lucides qu'à son talent exceptionnel pour restituer, dans leur étrangeté et leur authenticité, certaines théories indigènes : car il n'aurait jamais cherché dans cette contemplation le paresseux refuge d'une pensée vacillante. A s'en tenir à ce qui n'est, dans l'histoire de la pensée de Mauss, qu'une démarche préliminaire, on risquerait d'engager la sociologie sur une voie dangereuse et qui serait même sa perte si, faisant un pas de plus, on réduisait la réalité sociale à la conception que l'homme, même sauvage, s'en fait. Cette conception deviendrait d'ailleurs vide de sens si son caractère réflexif était oublié. L'ethnographie se dissoudrait alors dans une phénoménologie verbeuse, mélange faussement naïf où les obscurités apparentes de la pensée indigène ne seraient mises en avant que pour couvrir les confusions, autrement trop manifestes, de celle de l'ethnographe.
Il n'est pas interdit d'essayer de prolonger la pensée de Mauss dans l'autre direction : celle que devait définir l'Essai sur le don, après avoir surmonté l'équivoque que nous avons déjà notée à propos du hau. Car si le mana est au bout de l'Esquisse, le hau n'apparaît heureusement qu'au début du Don et tout l'Essai le traite comme un point de départ, non comme un point d'arrivée. A quoi aboutirait-on, en projetant rétrospectivement sur la notion de mana la conception que Mauss nous invite à former de l'échange ? Il faudrait admettre que, comme le hau, le mana n'est que la réflexion subjective de l'exigence d'une totalité non perçue. L'échange n'est pas un édifice complexe, construit à partir des obligations de donner, de recevoir et de rendre, à l'aide d'un ciment affectif et mystique. C'est une synthèse immédiatement donnée à, et par, la pensée symbolique qui, dans l'échange comme dans toute autre forme de communication, surmonte la contradiction qui lui est inhérente de percevoir les choses comme les éléments du dialogue, simultanément sous le rapport de soi et d'autrui, et destinées par nature à passer de l'un à l'autre. Qu'elles soient de l'un ou de l'autre représente une situation dérivée par rapport au caractère relationnel initial. Mais n'en est-il pas de même pour la magie ? Le jugement magique, impliqué dans l'acte de produire la fumée pour susciter les nuages et la pluie, ne se fonde pas sur une distinction primitive entre fumée et nuage, avec appel au mana pour les souder l'un à l'autre, mais sur le fait qu'un plan plus profond de la pensée identifie fumée et nuage, que l'un est la même chose que l'autre, au moins sous un certain rapport, et cette identification justifie l'association subséquente, non le contraire. Toutes les opérations magiques reposent sur la restauration d'une unité, non pas perdue (car rien n'est jamais perdu), mais inconsciente, ou moins complètement consciente que ces opérations elles-mêmes. La notion de mana n'est pas de l'ordre du réel, mais de l'ordre de la pensée qui, même quand elle se pense elle-même, ne pense jamais qu'un objet.
C'est dans ce caractère relationnel de la pensée symbolique que nous pouvons chercher la réponse à notre problème. Quels qu'aient été le moment et les circonstances de son apparition dans l'échelle de la vie animale, le langage n'a pu naître que tout d'un coup. Les choses n'ont pas pu se mettre à signifier progressivement. A la suite d'une transformation dont l'étude ne relève pas des sciences sociales, mais de la biologie et de la psychologie, un passage s'est effectué, d'un stade où rien n'avait un sens, à un autre où tout en possédait. Or, cette remarque, en apparence banale, est importante, parce que ce changement radical est sans contrepartie dans le domaine de la connaissance qui, elle, s'élabore lentement et progressivement. Autrement dit, au moment où l'Univers entier, d'un seul coup, est devenu significatif, il n'en a pas été pour autant mieux connu, même s'il est vrai que l'apparition du langage devait précipiter le rythme du développement de la connaissance. Il y a donc une opposition fondamentale, dans l'histoire de l'esprit humain, entre le symbolisme, qui offre un caractère de discontinuité, et la connaissance, marquée de continuité. Qu'en résulte-t-il ? C'est que les deux catégories du signifiant et du signifié se sont constituées simultanément et solidairement, comme deux blocs complémentaires ; mais que la connaissance, c'est-à-dire le processus intellectuel qui permet d'identifier les uns par rapport aux autres certains aspects du signifiant et certains aspects du signifié - on pourrait même dire de choisir, dans l'ensemble du signifiant et dans l'ensemble du signifié, les parties qui présentent entre elles les rapports les plus satisfaisants de convenance mutuelle - ne s'est mise en route que fort lentement. Tout s'est passé comme si l'humanité avait acquis d'un seul coup un immense domaine et son plan détaillé, avec la notion de leur relation réciproque, mais avait passé des millénaires à apprendre quels symboles déterminés du plan représentaient les différents aspects du domaine. L'Univers a signifié bien avant qu'on ne commence à savoir ce qu'il signifiait ; cela va sans doute de soi. Mais, de l'analyse précédente, il résulte aussi qu'il a signifié, dès le début, la totalité de ce que l'humanité peut s'attendre à en connaître. Ce qu'on appelle le progrès de l'esprit humain et, en tout cas, le progrès de la connaissance scientifique, n'a pu et ne pourra jamais consister qu'à rectifier des découpages, procéder à des regroupements, définir des appartenances et découvrir des ressources neuves, au sein d'une totalité fermée et complémentaire avec elle-même.
Nous sommes apparemment très loin du mana ; cri fait, fort près. Car, bien que l'humanité ait toujours possédé une masse énorme de connaissances positives et que les différentes sociétés humaines aient consacré plus ou moins d'effort à les maintenir et à les développer, c'est tout de même à une époque très récente que la pensée scientifique s'est installée en maîtresse et que des formes de sociétés sont apparues, où l'idéal intellectuel et moral, en même temps que les fins pratiques poursuivies par le corps social, se sont organisés autour de la connaissance scientifique, choisie comme centre de référence de façon officielle et réfléchie. La différence est de degré, non de nature, mais elle existe. Nous pouvons donc nous attendre à ce que la relation entre symbolisme et connaissance conserve des caractères communs dans les sociétés non industrielles et dans les nôtres, tout en étant inégalement marqués. Ce n'est pas creuser un fossé entre les unes et les autres que de reconnaître que le travail de péréquation du signifiant par rapport au signifié a été poursuivi de façon plus méthodique et plus rigoureuse à partir de la naissance, et dans les limites d'expansion, de la science moderne. Mais, partout ailleurs, et constamment encore chez nous-mêmes (et pour fort longtemps sans doute), se maintient une situation fondamentale et qui relève de la condition humaine, à savoir que l'homme dispose dès son origine d'une intégralité de signifiant dont il est fort embarrassé pour faire l'allocation à un signifié, donné comme tel sans être pour autant connu. Il y a toujours une inadéquation entre les deux, résorbable pour l'entendement divin seul, et qui résulte dans l'existence d'une surabondance de signifiant, par rapport aux signifiés sur lesquels elle peut se poser. Dans son effort pour comprendre le monde, l'homme dispose donc toujours d'un surplus de signification (qu'il répartit entre les choses selon des lois de la pensée symbolique qu'il appartient aux ethnologues et aux linguistes d'étudier). Cette distribution d'Une ration supplémentaire - si l'on peut s'exprimer ainsi - est absolument nécessaire pour qu'au total, le signifiant disponible et le signifié repéré restent entre eux dans le rapport de complémentarité qui est la condition même de l'exercice de la pensée symbolique.
Nous croyons que les notions de type mana, aussi diverses qu'elles puissent être, et en les envisageant dans leur fonction la plus générale (qui, nous l'avons vu, ne disparaît pas dans notre mentalité et dans notre forme de société) représentent précisément ce signifiant flottant, qui est la servitude de toute pensée finie (mais aussi le gage de tout art, toute poésie, toute invention mythique et esthétique), bien que la connaissance scientifique soit capable, sinon de l'étancher, au moins de le discipliner partiellement. La pensée magique offre d'ailleurs d'autres méthodes de canalisation, avec d'autres résultats, et ces méthodes peuvent fort bien coexister. En d'autres termes, et nous inspirant du précepte de Mauss que tous les phénomènes sociaux peuvent être assimilés au langage, nous voyons dans le mana, le wakan, l'orenda et autres notions du même type, l'expression consciente d'une fonction sémantique, dont le rôle est de permettre à la pensée symbolique de s'exercer malgré la contradiction qui lui est propre. Ainsi s'expliquent les antinomies, en apparence insolubles, attachées à cette notion, qui ont tant frappé les ethnographes et que Mauss a mises en lumière : force et action ; qualité et état ; substantif, adjectif et verbe à la fois ; abstraite et concrète ; omniprésente et localisée. Et en effet, le mana est tout cela à la fois ; mais précisément, n'est-ce pas parce qu'il n'est rien de tout cela : simple forme, ou plus exactement symbole à l'état pur, donc susceptible de se charger de n'importe quel contenu symbolique ? Dans ce système de symboles que constitue toute cosmologie, ce serait simplement une valeur symbolique zéro, c'est-à-dire un signe marquant la nécessité d'un contenu symbolique supplémentaire à celui qui charge déjà le signifié, mais pouvant être une valeur quelconque à condition qu'elle fasse encore partie de la réserve disponible, et ne soit pas déjà, comme disent les phonologues, un terme de groupe [35].
Cette conception nous paraît être rigoureusement fidèle à la pensée de Mauss. En fait, ce n'est pas autre chose que la conception de Mauss traduite, de son expression originale en termes de logique des classes, dans ceux d'une logique symbolique qui résume les lois les plus générales du langage. Cette traduction n'est pas notre fait, ni le résultat d'une liberté prise à l'égard de la conception initiale. Elle reflète seulement une évolution objective qui s'est produite dans les sciences psychologiques et sociales au cours des trente dernières années, et dont la valeur de l'enseignement de Mauss est d'avoir été une première manifestation, et d'y avoir largement contribué. Mauss fut, en effet, un des tout premiers à dénoncer l'insuffisance de la psychologie et de la logique traditionnelles, et à faire éclater leurs cadres rigides en révélant d'autres formes de pensée, en apparence « étrangères à nos entendements d'adultes européens. » Au moment où il écrivait (rappelons-nous que l'essai sur la magie date d'une époque où les idées de Freud étaient complètement inconnues en France), cette découverte ne pouvait guère s'exprimer autrement que sous forme négative, par l'appel à une « psychologie non intellectualiste ». Mais que cette psychologie put un jour être formulée comme une psychologie autrement intellectualiste, expression généralisée des lois de la pensée humaine, dont les manifestations particulières, dans des contextes sociologiques différents, ne sont que les modalités, nul plus que Mauss n'eût eu raison de s'en réjouir. D'abord, parce que c'est l'Essai sur le don qui devait définir la méthode à employer dans cette tâche ; ensuite et surtout, parce que Mauss lui-même avait assigne comme but essentiel à l'ethnologie de contribuer à l'élargissement de la raison humaine. Il revendiquait donc, par avance, pour celle-ci, toutes les découvertes qui pourraient encore être faites, dans ces zones obscures où des formes mentales difficilement accessibles, parce qu'enfouies simultanément aux confins les plus reculés de l'Univers et dans les recoins les plus secrets de notre pensée, ne sont souvent perçues que réfractées dans une trouble auréole d'affectivité. Or, Mauss s'est montré toute sa vie obsédé par le précepte comtiste, qui réapparaît constamment dans ce volume, selon lequel la vie psychologique ne peut acquérir un sens que sur deux plans : celui du social, qui est langage ; ou celui du physiologique, c'est-à-dire l'autre forme, celle-là muette, de la nécessité du vivant. Jamais il n'est resté plus fidèle à sa pensée profonde et jamais il n'a mieux tracé à l'ethnologue sa mission d'astronome des constellations humaines, que dans cette formule où il a rassemblé la méthode, les moyens et le but dernier de nos sciences et que tout Institut d'Ethnologie pourrait inscrire à son fronton : « Il faut, avant tout, dresser le catalogue le plus grand possible de catégories ; il faut partir de toutes celles dont on peut savoir que les hommes se sont servis. On verra alors qu'il y a encore bien des lunes mortes, ou pâles, ou obscures, au firmament de la raison. »
CLAUDE LÉVI-STRAUSS.
[1] Depuis la troisième édition (1966), Sociologie et anthropologie comprend, selon le vœu exprimé par Georges Gurvitch avant sa mort, l'essai de Marcel Mauss sur les Sociétés Eskimos, paru initialement dans L'Année sociologique (tome IX, 1904-1905) et jamais réimprimé depuis. (Note des Éditeurs.)
[2] C. LÉVI-STRAUSS, La Sociologie française, in La Sociologie au XXe siècle, Presses Universitaires de France, 1947, vol. 2 (Twentieth Century Sociology, New York, 1946, chap. XVII).
[3] W. B. CANNON, a Voodoo » Death, American Anthropologist, n. s., vol. 44, 1942.
[4] Pour cet aspect de la pensée de Mauss, le lecteur aura intérêt à se reporter à deux autres articles, non Inclus dans le présent volume : Salutations par le Rire et les Larmes, Journal de Psychologie, 1922 ; L'Expression obligatoire des Sentiments, ibid., même date.
[5] M. MEAD, The Mountain Arapesh, v. American Museum of Natural History, Anthropological Papers, vol. 41, Part. 3, New York, 1949, p. 388.
[6] Le sorcier et sa magie, Les Temps modernes, mars 1949.
[7] Telle est bien, nous semble-t-il, la conclusion qui se dégage de la profonde étude du Dr Jacques LACAN, L'Agressivité en Psychanalyse, Revue française &,Psychanalyse, no 3, juillet-septembre 1948.
[8] Michel Leiris, Martinique, Guadeloupe, Haïti, Les Temps modernes, no 52, février 1950, p. 1352-1354.
[9] S. F. Nadel, Shamanism ln the Nuba Mountains, Journal of the Royal Anthropological Institute, vol. LXXVI, Part. 1, 1946 (publié en 1949).
[10] Celle-ci à compléter par : L'Âme et le Prénom, Communication à la Société de Philosophie, 1929.
[11] Revue Philosophique, 1909.
[12] Mélanges Sylvain Lévy, 1911.
[13] L'Anthropologie, 1913-1914.
[15] Revue des Études grecques, vol. XXXIV, 1921.
[16] Revue Celtique, 1925.
[17] Année Sociologique, VI, 1901-1902.
[18] Année Sociologique, IX, 1904-1905.
[19] Mélanges Adler, 1925.
[20] Rapport de l'École des Hautes Études, Annuaire, 1928.
[21] Procès-verbaux de la Société d'Histoire du Droit, 1928.
[22] Procès-verbaux des Journées d'Histoire du Droit, 1929.
[23] In : Civilisation, le moi et l'idée, Centre international de Synthèse, Première semaine, 2e fascicule, Paris, 1930.
[24] Annales Sociologiques, série A, fasc. 1, 1934.
[25] Voir sur ce point la note de MALINOWSKI (p. 41, no 57) dans son livre Crime and Custom in Savage Society, New York-Londres, 1926,
[26] Raymond FIRTH, We, The Tikopia, New York, 1936, chap. XV; Primitive Polynesian Economics, Londres, 1939, p. 323.
[27] N. S. TROUBETZKOY, Principes de Phonologie (Grundzüge der Phonologie, 1939) et les divers articles de R. JAKOBSON, publiés en annexe de la traduction française par J. GANTINEAU, Paris, 1949.
[28] N. WIENER, Cybernetics, New York et Paris, 1948. C. E. SHANNON and Warren WEAVER, The Mathematical Theory of Communication, University of Illinois Press, 1949.
[29] A. M. Hocart, Mana, Mon, no 46, 1914; Mana again, Man, no 79, 1922 ; Natural and supernatural, Mon, ne 78, 1932. H. IN Hogbin, Mana, Oceania, vol. 6, 1935-1936. A. CAPELL, The word « mana » : a linguistic study, Oceania, vol. 9, 1938. R. FIRTH, The Analysis of Mana : an empirical approach, Journal of the Polynesian Society, vol. 49, 1940; An Analysis of Mana, Polynesian Anthropological Studies, p. 189-218, Wellington, 1941. G. BLAKE PALMER, Ma a, some Christian and Moslem Parallels, Journal of Me Polynesian Society vol. 55, 1946. G. J. SCHNEEP El Concepto de Maria, Acta Anthropologica, vol. Il, no 3, Mexico, 1947. &'MALINOWSKI, Magie, Science and Religion, Boston, 1948.
[30] La Vie familiale et sociale des Indiens Nambikwara, Société des Américanistes, Paris, 1948, p. 95-98.
[31] Alfred METRAUX, La causa y el tratamiento mágico de las enfermedoctes entre los indios de la Region Tropical Sul-Americana, America Indigena, vol. 4, Mexico, 1944 ; Le Shamanisme chez les Indiens de l'Amérique du Sud tropicale, Acta Americana, vol. Il, non 3 et 4, 1944.
[32] C. LÉVI-STRAUSS, La Vie familiale, etc., l. c., pp. 98-99; The Tupikawahib, in Handbook of South American Indians, Washington, 1948, vol. 3, pp. 299-305.
On comparera avec les Dakota qui disent du premier cheval, apporté selon le mythe par l'éclair : « Il ne sentait pas comme un être humain et on pensa que ce pourrait Être un chien, mais il était plus gros qu'un chien de charge, aussi on l'appela sunka wakan, chien mystérieux » (M. W, Beckwith, Mythology of the Oglala Dakota, Journal of Armerican Folklore, vol. XLIII, 1930, P. 379).
[33] Sur cette dérivation du mot mana, cf. A. CAPELL, l.c.
[34] Aussi décisive. qu'ait été la démarche de Mauss assimilant les phénomènes sociaux au langage, elle devait, sur un point, mettre la réflexion sociologique en difficulté. Des idées telles que celles exprimées dans cette citation pouvaient, en effet, invoquer à leur profit ce qui devait, pendant longtemps, être considéré comme le rempart inexpugnable de la linguistique saussurienne : c'est-à-dire la théorie de la nature arbitraire du signe linguistique. Mais il n'est pas, non plus, de position qu'il soit aujourd'hui plus urgent de dépasser.
[35] Les linguistiques ont déjà été amenés à formuler des hypothèses de ce type. Ainsi : « Un phonème zéro... s'oppose à tous les autres phonèmes du français en ce qu'il ne comporte aucun caractère différentiel et aucune valeur phonétique constante. Par contre, le phonème zéro a pour fonction propre de s'opposer à l'absence de phonème. » B. JAKOBSON and J. Lotz, Notes on the French Phonemic Pattern, Word, vol. 5, no 2, août 1949, New York, 1949, p. 155.
On pourrait dire pareillement, en schématisant la conception qui a été proposée ici, que la fonction des notions de type mana est de s'opposer à l'absence de signification sans comporter par soi-même aucune signification particulière.

