|
“La fin des mémoires parallèles ?”
Un article publié dans l'ouvrage sous la direction de Robert Comeau et Bernard Dionne, À propos de L'HISTOIRE NATIONALE, pp. 91-101 Montréal: Les Éditions Septentrion, 1998, 160 pp.
- Introduction
-
- La résistance structurelle au comparatisme dans l'historiographie moderne
- Les modes d'existence du comparatisme dans l'historiographie après 1945
- Histoire comparative et histoire nationale : le cas du Québec
-
- Conclusion : une histoire mondiale ?
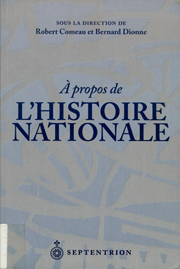
Introduction

Les temps sont à la comparaison... Crise de la nation comme entité identitaire, mondialisation, écroulement des grands paradigmes unificateurs, divers arguments peuvent être avancés, et l'ont été, pour justifier le réflexe comparatif en histoire. De fait, derrière la relative banalité et la longue histoire de l'appel à la comparaison [1] se profile un enjeu épistémologique important : quelle est la pertinence de la procédure comparative dans la détermination de l'objet historique comme dans son analyse ? Autrement dit, d'une part, la comparaison participe-t-elle directement à la dynamique de construction de l'objet d'analyse, ou n'intervient-elle qu'ex post facto, pour confronter cet objet prédéterminé à ses autres formes d'apparition, ailleurs ? D'autre part, quel est le statut de la comparaison dans l'analyse : sert-elle à la recherche de constantes, de réalité assez homogènes pour revêtir, à terme, le statut de quasi-lois, où n'a-t-elle pour but que de mesurer le degré d'unicité, d'originalité d'un objet particulier ? Bien sûr, surtout dans le deuxième de ces cas d'espèce, il ne s'agit par d'alternatives inconciliables. Il reste que l'ambiguïté potentielle du réflexe comparatif, si on en fait l'analyse, peut nous éclairer non seulement sur la façon dont se construit l'historiographie, mais aussi sur la place de l'espace national dans cette comparaison.
Car il faut bien voir que derrière les appels de plus en plus pressants à l'incontournable comparaison [2] se profile une interrogation fondamentale sur [92] la pertinence du cadre national dans l'analyse historique. Il nous semble donc important de s'interroger sur la place qu'occupe le cadre national dans la mise en œuvre de la procédure comparative en histoire. Plus spécifiquement, il s'agira d'abord de questionner les obstacles qu'a toujours rencontrés la comparaison dans la démarche historique. Dans un deuxième temps, on analysera brièvement les facteurs qui peuvent expliquer non seulement la persistance, mais l'essor relativement récent du réflexe comparatif. Enfin, il sera temps d'évaluer la place de l'espace national dans la dynamique comparative, tout en soulignant les limites et les ambiguïtés de celle-ci.
La résistance structurelle au comparatisme
dans l'historiographie moderne

Dans l'histoire de la discipline historique, l'analyse comparative n'a jamais vraiment occupé de place centrale, et pour cause. L'histoire est avant tout, dès ses origines, recherche identitaire attachée au groupe social de référence. La « comparaison » à l'œuvre ici est avant tout confrontation inégale avec l'étranger, établissement d'une distance qui assouvit à la fois notre soif de savoir et conforte, par la mise à distance, la cohérence, voire la supériorité du groupe. Il ne faut pas confondre curiosité ethnographique et recherche comparative... De même, le regard sur le passé, quels que soient ses présupposés méthodologiques ou idéologiques, est toujours, finalement, regard sur soi : sa tribu, sa nation, sa race, voire sa religion. Tout au long de l'histoire et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle au moins, les mémoires ainsi constituées sont toujours des mémoires parallèles, où la comparaison est avant tout réflexe de distanciation/affiliation identitaire.
L'avènement des grandes philosophies séculières de l'histoire, depuis l'ère des Lumières, n’a rien pour enrichir le réflexe comparatif. Ici, les différences sont systématiquement subsumées sous la totalisation de l'existant dans une trame historique continue, que ce soit la course vers le progrès, la marche de l'esprit ou la fin des luttes de classes. En strict parallèle, l'avènement de la Nation, comme cadre premier de référence collective au XIXe siècle, fait de l'histoire un instrument de mémoire, scientifique ou non [3], au service de cette communauté de citoyens. À partir de ce moment, la nation devient la matérialisation particulière de l'évolution du monde, son mode différent [93] d'exister étant au fondement principiel de son identité et de sa légitimité. Toute comparaison systématique est, sinon invalidée, du moins soumise au postulat de la centralité de la nation et de l'unicité de son existence.
On aurait cru que l'industrialisation à l'échelle continentale, la mondialisation des conflits, voire l'avènement concomitant d'États providence fondés sur des principes universellement validés à partir de la Déclaration des droits sociaux de 1948, que l'ensemble de ces phénomènes eût induit une dynamique d'élargissement des horizons de la recherche historique qui aurait dû placer le comparatisme au cœur de ses procédures. Certes, l'injonction adressée aux sciences sociales de saisir les phénomènes dans leur globalité, de Durkheim à Febvre, la mise sur pied d'une communauté internationale de chercheur, bientôt appuyée par la création d'organismes culturels planétaires comme l'Unesco, et finalement l'appel à une véritable histoire mondiale [4] ont permis un premier développement des recherches comparatives [5].
Mais l'histoire ne s'est pas seulement élargie aux dimensions de la planète. Elle a aussi - et surtout - explosé en une multitude éclatée de problématiques et de thèmes, de plus en plus pointus, de plus en plus incomparables. Ou plutôt, elle a laissé aux joies de la « synthèse » la tâche de comparer après coup le résultat de sa quête localisée de vérité, de mettre le général devant le fait accompli de la diversité du savoir produit [6]. On note trop peu souvent comment le développement de l'État providence, conco-mitant avec la création d'un espace public international, est un facteur de recentrage sur la nation, et non un principe d'universalisation, malgré le discours des chartes. L'histoire contemporaine, depuis 1945 au moins, vit ce paradoxe de s'éclater dans les limites non contestées des espaces nationaux. L'histoire globale chère à Febvre s'est retrouvée dans le corset étroit d'une histoire économique et sociale, puis culturelle, faite à l'échelle de la nation, du département ou de la région, de la ville, jusqu'à se retrouver postulée dans l'infinitésimal de la microhistoire... Le temps où sa possibilité même serait niée n'était pas loin [7].
[94]
Bien sûr, certains réflexes comparatifs sont nécessairement à l'œuvre dans l'histoire thématique issue de ces tendances. Ainsi, aucun chercheur n'oserait aujourd'hui traiter un sujet sans recourir à « l'historiographie » de ce sujet, c'est-à-dire aux travaux parus ici et ailleurs sur le même sujet [8]. Mais on aura noté qu'il s'agit ici non pas de comparaison entre deux ou plusieurs entités données, mais de travail conceptuel de mise à niveau d'un savoir particulier par rapport aux savoirs étrangers sur le même type de sujet. Il ne s'agit pas de faire l'histoire comparative de deux ou plusieurs villes, mais l'histoire d'une ville (ou du tissu urbain d'une région donnée) en tenant compte et s'aidant de ce que l'on sait des autres villes ou réseaux urbains. En fait l'empirisme rampant des procédures de l'historien ne fait qu'invalider davantage, en la rendant douteuse, la recherche comparative systématique. En effet, le découpage de plus en plus étroit et particulier du « réel » historique implique une « normalisation » à deux niveaux de l'objet sous étude. D'abord, son intégration dans une catégorie analytique générale postulée (exemple, histoire du commerce). Ce « général » assez particulier permet de définir au préalable les paramètres théoriques et méthodologiques de l'analyse. Mais une fois ces paramètres définis, l'objet doit être soumis, à un deuxième niveau, à une mise en contexte rigoureuse dans un espace temps particulier, par exemple le Québec de la fin du XIXe siècle. On voit que ni dans la détermination de l'objet ni dans sa mise en contexte spécifique, la comparaison systématique ne s'impose. Celle-ci, quand elle est entreprise, constitue tout au plus un exercice, la plupart du temps collectif, de confrontation des résultats disparates d'une recherche menée dans des contextes différents, mais sur un thème donné ; il s'agit, en somme, de juxtaposer a posteriori des projets de recherche, la plupart du temps conçus initialement dans une optique strictement locale [9].
En somme, dans les procédures de l'histoire d'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, le comparatisme n'est ni une exigence méthodologique ni un principe heuristique de production de savoir. Il est tout au plus une opération intellectuelle de détermination de l'objet ou un exercice de confrontation des résultats de recherche, exercice qui débouche d'ailleurs souvent [95] sur le constat d'une convergence fondamentale, au-delà des particularismes nationaux, du destin des sociétés, du moins dans le monde occidental [10].
On voit que, dans ce contexte, le « passage au mondial » du travail historien n'est pas une opération simple, au-delà du constat autogratifiant de l'internationalisation de la profession [11]. Il repose encore de façon écrasante sur le postulat du travail « sectoriel » préalable, au risque de voir ce « préalable » devenir permanent... Mais d'autres tendances sont aussi à l'œuvre.
Les modes d'existence du comparatisme
dans l'historiographie après 1945

Malgré les obstacles à l'analyse comparative qui viennent d'être brièvement analysés, celle-ci s'est néanmoins développée de façon remarquable dans certains domaines de la recherche historique. En fait, deux tendances sont ici à l'œuvre.
- Le postulat de l'explication par le supranational
Même si l'espace national reste, et de loin, le cadre référentiel premier de l'analyse historique [12], il est clair que certaines questions n'ont pu être exprimées et approfondies qu'à partir d'un cadre de référence qui soit explicitement international. Deux types de recherches viennent immédiatement à l'esprit en ce sens. Ainsi, le long débat sur la transition au capitalisme ne peut être heuristiquement pertinent que s'il transcende l'espace national. De Dobb et Sweezy à Wallerstein, le capitalisme est saisi comme une entité dont l'existence s'exprime à l'échelle mondiale. L'espace national est certes un de ses lieux important d'expression, mais surtout dans la mesure où l'analyse de [96] chaque formation sociale permet de spécifier et d'approfondir les formes de la transition à ce mode de production. On voit ici que l'analyse comparative est une condition de la recherche, et que l'étude d'un cadre national donné n'a de sens que dans la perspective de sa systématique confrontation avec les autres « cas ». C'est du moins l'esprit dans lequel a été mené le débat depuis plus de 40 ans [13].
Un des postulats de base de ce type de démarche est qu'il est possible de faire la théorie d'un concept, d'un phénomène, d'une manifestation de l'activité humaine, au-delà de la description empirique de ses manifestations locales. La comparaison est ici le moyen de transformer le particulier en général. Plus précisément, il ne s'agit pas de retrouver, dans l'effervescence de ses diverses manifestations, la « réalité » de l'histoire d'une nation, mais plutôt de saisir dans son fondement conceptuel, par-delà ses lieux de matérialisation, un phénomène donné. Ainsi, l'industrialisation ne peut faire l'objet d'une analyse théorique que si les connaissances empiriques servent, par le biais de la comparaison, de matériau premier à ce type de recherche. La démarche analytique en est ainsi profondément transformée. C'est un peu la démarche entreprise par une sociohistorienne comme T. Skocpol (1979), dans son analyse des modes de constitutions de l'État en conjoncture révolutionnaire.
- Le thématique au-delà de la nation
La démarche que l'on vient de décrire n'impliquait pas une négation de l'espace national comme vecteur d'analyse. Au contraire, la nation apparaissait comme unité privilégiée de la comparaison, sans en être l'objet central. Mais la dynamique de la recherche empirique peut aussi induire, d'une façon particulière, la recherche de type comparatif. C'est le cas quand le référent national en vient à s'estomper de plus en plus au profit de l'objet premier d'analyse, et que la poursuite de la « réalité » de l'objet l'emporte sur le réel national. Il ne s'agit pas ici de simple juxtaposition de recherches empiriques menées initialement dans le cadre national, mais au contraire de la mise au point explicite d'un questionnement commun sur un objet de recherche posé dans l'espace international. Une des formes privilégiées est l'enquête collective d'équipes d'historiens qui appliquent une problématique [97] commune au traitement d'une question soit au niveau continental, soit plus simplement en choisissant comme terrain d'analyse une pluralité d'espaces nationaux. Historiquement, une des premières formes de cette procédure analytique se retrouve dans les études qui tâchaient de mesurer soit les « étapes » (à la Rostow) de passage au stade industriel, soit plus simplement la vitesse relative de ce passage [14]. Depuis, ces démarches de comparaison systématique n'ont fait que s'approfondir et se diversifier, même si elles occupent encore un espace relativement marginal dans la discipline [15].
On l'a vu, le postulat derrière ce type de démarche est que la manifestation d'un phénomène donné, comme la délinquance juvénile, l'industrialisation, la Révolution, ne peut se comprendre qu'en transcendant l'espace national. La nation devient ainsi une toile de fond, voire, à terme, une variable analytique secondaire [16] à la démarche de l'historien. Il est maintenant temps d'analyser les implications de ce que j'ai appelé le « réflexe » comparatif dans l'historiographie québécoise.
Histoire comparative et histoire nationale :
le cas du Québec

- On est conduit à proposer que la culture québécoise traditionnelle s'est nourrie de fausses représentations quant à sa spécificité et à son identité, et qu'une enquête comparative axée sur la recherche des ressemblances serait une stratégie utile pour mettre un jour les véritables points de démarcation (Bouchard, 1993 : 40).
- Pour qu'elle se fonde sur l'existence d'une frontière, la comparaison, loin de toujours élargir notre vision, peut au contraire la restreindre, entraver une perception plus fluide et plus mobile des faits de culture, qui seule permettrait [98] de mieux appréhender d'emblée des communautés de « lieux », ou les « lieux communs ». Plutôt que la recherche d'analogies et de dissemblances par-delà les frontières, aussi perméables soient-elles, une définition plus labile de la culture pourrait nous autoriser à saisir de manière plus immédiate les faits d'« identité » qui redessineraient en chaque cas une nouvelle configuration (Dakhlia, 1995 : 39-40).
On le voit, quelle que soit la perception que l'on ait de la pertinence de l'exercice comparatif, celui-ci en appelle toujours à la notion de frontières, ou de limite séparant - dans l'implicite ou non - les pôles de la comparaison. De toute façon, ne serait-ce qu'en raison du centrage déjà mentionné des historiographies sur l'espace national, la comparaison pose toujours la question de la nation. Ainsi, l'exercice comparatif est la plupart du temps accompagné d'une volonté explicite d'élargir au-delà du cadre national le regard de l'historien [17]. Et cela d'autant plus que toute une série d'études, s'appuyant notamment sur l'approche postmoderniste, dénoncent de plus en plus la « substantification » de la nation [18], ou du moins la ramènent à un imaginaire, voire à un récit [19].
L'approche promue par G. Bouchard est exactement l'inverse, puisqu'il s'agit d'en arriver à une spécification de l'identité nationale par l'établissement d'une sorte d'inventaire objectif des différences qui la fondent. La voie proposée pour atteindre cet objectif est originale : procéder d'abord à une « démythification » des « fausses différences [20] », puis faire l'inventaire des ressemblances et des similitudes, notamment avec les autres collectivités américaines, vivant une expérience commune [21]. Le postulat est ici que l'identité se définit de façon plus rigoureuse à partir de la conscience des ressemblances que dans la valorisation mystifiante des différences. Plus précisément, la « positivité » des ressemblances dégagées par la recherche historique forme un tout qui fait sens, sur le fond de scène duquel peuvent mieux [99] se repérer, comme par une opération de soustraction, les traits marquants de notre différence, et donc de notre identité [22]. Ainsi est enfin dépassée l'impuissance du paradigme « modernisateur » (R. Rudin dirait « révisionniste ») à donner un contenu explicite à notre différence [23].
J'ai accordé une place importante au projet scientifique énoncé par G. Bouchard, car nous sommes ici en présence d'une tentative profondément originale et extrêmement révélatrice de dépasser à la fois les raccourcis de l'identité ethnique et les apories d'une histoire éclatée incapable de saisir globalement les différences de la formation sociale qu'elle étudie, tout en se démarquant fortement des remises en question relativistes ou « postmodernes » et en réaffirmant sa foi en la scientificité [24]. Il est clair qu’une telle approche peut stimuler des enquêtes utiles permettant de repérer l'existence de phénomènes dépassant les frontières nationales ou politiques [25]. Mais il reste à savoir en quoi l'inventaire de nos ressemblances peut nous permettre un regard plus explicite, plus clair, voire plus scientifique, sur notre identité nationale et sa construction historique.
Comme un individu, une nation n'est qu'une brève et fragile différence qui se reconstruit constamment en se transformant. Il s'agit d'un processus politique qui a, au fond, peu à voir avec l'anthropologie des comportements [100] ou la sémantique des perceptions. Les « ressemblances » repérables entre les expériences nationales n'en font aucunement une même expérience, mais des analogies la plupart du temps partielles et temporaires (et qui peuvent être aussi « trompeuses » que les différences postulées ! ...) . Dire que la nation est « unique » n'implique nullement, évidemment, un rapport d'antécédence analytique ou, pire, un postulat de pertinence supérieure. C'est simplement dire que l'existence nationale est une réalité politique, et qui comme telle accuse les traits spécifiques de ce mode d'existence.
La nation, dans son unicité, ne peut en effet être saisie comme la construction en série de traits plus ou moins anthropologiques, ou de caractéristiques « culturelles [26] » plus ou moins permanentes. Elle est le lieu où s'établit, de façon à la fois dialectique et contradictoire, et jamais de façon permanente, une série de rapports entre un cadre institutionnel, un vécu collectif pratique, une série de représentations partagées dont l'unicité est fondée sur la reconnaissance d'une autre, d'un « non-soi » collectif, et un foisonnement stochastique d'histoires individuelles et associatives. Elle représente donc une forme historique « générale » assez particulière, qui constitue en fait la forme dominante d'inscription collective des individus dans le temps, une forme qui associe la capacité de faire à un projet qui lie, inexorablement, tous les occupants d'un espace donné [27].
Il ne s'agit pas de dire que tout cela est parfaitement inexplicable scientifiquement. Il s'agit simplement d'affirmer que les règles traditionnelles de l'explication scientifique, normalisant le particulier par le général, postulant que l'explication n'est que comparaison d'unités d'analyse mises en série, édictant que le sens en vient que de la réduction de l'exceptionnel à la règle, en somme que l'ensemble des critères de scientificité fondés sur ce paradigme, emprunté (et jamais remis ... ) aux sciences exactes, ne permettent aucunement de saisir l'histoire des phénomènes collectifs où l'action et les intentions des hommes sont inextricablement mêlées. Qu'en somme l'histoire, et à plus forte raison l'histoire politique, doit générer un discours de vérité qui soit d'un autre ordre, et qui permette de saisir la réalité du moment autant que celle des structures.
[101]
Cela n'invalide évidemment aucunement la pertinence du réflexe comparatif Mais à condition que la comparaison ne soit pas simple subsomption du particulier dans le général, abolition de l'aléatoire au profit du « scientifiquement » prévisible [28]. Qu'elle permette certes d'interroger nos certitudes analytiques, voire de saper la vision partagée de la collectivité nationale, mais sans prétendre apporter de réponse que, par son statut même, elle ne peut produire. La comparaison nous renseigne sur ce qui est comparé, et encore à condition que l'objet conceptuel ainsi construit soit comparable. Une expérience, qu'elle soit individuelle ou collective, est toujours, à terme, incomparable, car elle est plus que la somme de traits partageables avec une autre expérience. Elle est la construction unique et temporaire de ces traits dans un moment particulier. Et le temps la détruit en la rendant caduque, ou en la transformant. C'est le défi que pose à notre compréhension les hommes et les femmes vivant dans le temps, toujours seuls et toujours ensemble.
Conclusion : une histoire mondiale ?

La tentative d'utiliser la comparaison, non pour comprendre un phénomène donné, non pour mettre en valeur une forme collective d'existence transcendant la nation, mais pour refonder celle-ci sur des bases positives, pose donc d'importants problèmes tant d'ordre épistémologique qu'heuristique. Au fond, et à terme, il me semble que l'enjeu est moins de comparer les expériences nationales comme telles que d'imaginer un moyen de les dépasser en inventant une expérience commune d'un autre ordre, celle de la communauté mondiale. S'il y a une histoire mondiale à faire, au-delà des comparaisons localisées, ce n'est pas seulement celle des modes économiques et sociaux d'existence de cette communauté. C'est aussi, et surtout, celle de la constitution de l'espèce en collectif politique. Cette histoire, dans tous les sens du terme, elle est à faire, que ce soit au-delà ou malgré la nation.
[1] « La méthode comparative est la seule qui convienne à la sociologie », E. Durkheim (1977 :124). Sur cette question, voir H.-G. Haupt (1995 :196-207).
[2] Un des derniers exemples se retrouve dans le recueil de contributions dirigé par G. Bouchard et Y. Lamonde (1997).
[3] Il n'existe ni contradiction logique ni hiatus historique entre le développement des grandes philosophies de l'histoire, le développement des nations et la scientifisation de l'histoire. Sur ce point, voir R. Koselleck (1990).
[4] Dont un des premiers manifestes a été le livre de G. Barraclough (1964).
[5] À preuve la fondation, en 1959, de la revue Comparative Studies in Society and History.
[6] Dans ce contexte, la « synthèse générale » est ainsi devenue une fédération lâche de thématiques agglomérées sous les catégories mères de l'économique, du social, du politique, du culturel, etc.
[7] Il est venu aux moments (parallèles et complémentaires ...) où l'histoire « nouvelle » renonçait à ses ambitions globalisantes (cf. le « tournant critique » des Annales en France) et où le postmodernisme contestait la pertinence du postulat globalisateur. Sur ce point, voir les diagnostics récents de G. Noiriel (1996), et J. Appleby et al. (1994).
[8] On notera en passant comment le sens du mot « historiographie » s'est déplacé en conséquence : il désigne de moins en moins l'analyse des conditions de production ou de possibilité du travail d'analyse historique à un moment donné de l'histoire, et de plus en plus l'état de la recherche sur un point donné. Il évoque dorénavant un résultat, non un type de questionnement.
[9] On retrouve divers exemples de cette procédure, dont l'intérêt est évidemment indéniable, dans notre « historiographie ». Voir par exemple F. Lebrun et N. Séguin, dir. (1987).
[10] On se retrouve ici au fondement épistémologique du phénomène de « normalisation » dénoncé avec virulence par Ronald Rudin (1995) dans le cas des historiens québécois. En fait, ce postulat que toute société, du moins dans l'espace des pays « développés », voit sa particularité subsumée sous l'incontournable impact des grandes « tendances modernisatrices » (industrialisation, urbanisa-tion, alphabétisation, démocratisation, émancipation des femmes, etc.), et ne peut en soi être « anormale », est au cœur de la démarche scientifique depuis 50 ans, J'y reviendrai.
[11] On retrouve un tel constat dans J. Boutier et A. Virmani (1995 : 296-305).
[12] Précisons qu'il ne s'agit pas d'affirmer ici que la nation est le pôle explicatif central. Plus simplement, l'argument est que les thèmes divers abordés sont partie d'une histoire nationale et s'y développent, même si, à terme, l'objet thématique déborde les limites nationales.
[13] La bibliographie est ici pléthorique. On trouvera un bilan dans J.-M. Fecteau (1986) et dans R. G. Holton (1985).
[14] On pense notamment aux études comparatives sur l'industrialisation française et anglaise à la fin du XVIlle siècle. Voir par exemple Pierre Léon, François Crouzet et Richard, Gascon, dit. (1972). On peut aussi mentionner les travaux de Palmer et Godechot sur la Révolution atlantique.
[15] Dans le champ de recherche qui m'est familier, on peut mentionner le beau travail collectif autour de P. Mandler, dir. (1990). L’analyse que l'on retrouve dans ce texte est aussi inspirée de ma participation à ce type d'équipe. Voir J.-G. Petit et al. (1998).
[16] Cette position est exprimée avec une particulière clarté, en ce qui concerne les conditions de compréhension des Rébellions de 1837-1838 dans les Canadas, par A. Greer (1995 : 18) : « The people involved in the two Canadas and in the United States spoke different languages, partook of different political cultures and cherished a variety of aspirations. Yet, for all this internal diversity, this was a single historical phenomenon, and no phase of it can be fully understood in isolation from the whole. »
[17] Ainsi A. Greer (1995 : 6) dénonce-t-il « the comparative isolation of Canadian historiography from large international currents ». De la même façon, G. Bouchard (1990 :262) déplore que les recherches soient « si massivement centrées sur le Québec [...] qu'elles ont fait tomber en défaveur, sinon en désuétude, la recherche sur des périodes plus anciennes ou sur d'autres espaces ».
[18] Voir notamment R. Brubaker (1996).
[19] Voir, dans des perspectives différentes mais complémentaires, B. Anderson (1991) et J. Létourneau (1992 : 765-785).
[20] Ce déboulonnement des « mythes fondateurs » de la nation est entrepris notamment dans G. Bouchard (1995b : 15-60).
[21] Bouchard nous invite à « percevoir les similitudes issues d'une même expérience continentale » (1995b : 16).
[22] « La comparaison s'avère plus instructive lorsque, sur un fond de similitude, elle fait ressortir les différences (Bouchard, 1995b : 349). « Nous sommes invités à réfléchir non pas sur ce qui nous distingue des autres, mais sur ce en quoi nous leur ressemblons. (Bouchard, 1990 : 263). » « Une reconnaissance des ressemblances peut ouvrir la voie à une réflexion plus éclairée sur les différences et nourrir une perception plus juste de soi et des autres (Bouchard, 1995b : 16). »
[23] « Tout en refusant de récuser le postulat de la différence ou de la spécificité québécoise, [le paradigme modernisateur] est impuissant à définir explicitement un contenu à ces notions (Bouchard, 1990 : 262). »
[24] « Pour tous les historiens qui ne se trouvent pas à l'aise dans la positon où les ont installés les théoriciens du relativisme historique et qui voudraient faire de leur discipline autre chose qu'un écho passif du présent, n'est-ce pas une occasion rêvée de viser à la fois l'objectivité de leur science, un développement original pour leur société et une contribution au domaine universel de l'anthropologie. Ici, l'histoire cesserait d'être uniquement mémoire pour devenir également conscience puis action (Bouchard, 1990 : 267). » L’épistémologie de Bouchard est traversée par cette vision où le particulier ne débouche sur le général et l'universel que par le biais de la médiation anthropologique : « C'est précisément sous ce rapport de la qualité du savoir, de sa richesse et de sa portée, qu'on peut parler d'enrichissement et de progrès, vers la maturité, et plus précisément d'une capacité accrue à convertir dans le langage universel de l'humanisme - et sans les trahir - des expériences collectives nécessairement particulières dans leur état brut (Bouchard, 1990 : 265). » Ainsi peut-on faire l'économie de la dimension politique. J'y reviendrai.
[25] Le profusion actuelle d'études sur le concept d'« américanité » en témoigne.
[26] Indépendamment du débat autour de son caractère heuristique, la notion de culture sert souvent de prétexte idéal, voire de bouée conceptuelle de sauvetage, pour l'intellectuel en mal de généralisation, et qui ne veut pas affronter la politisation incontournable de son objet.
[27] Les exigences propres à cette forme politique sont très lucidement décrites par D. Schnapper (1993 : 89-96).
[28] La vision, héritée de Weber comme de Febvre, du politique comme aléatoire échappant à l'explication scientifique transparaît dans le passage d'un article de G. Bouchard (1990 : 264-265), à propos de la « mise en veilleuse » de la querelle sur la Conquête : « Le dossier [...] est pratiquement évacué du champ d'enquête comme si l'histoire devenue science sociale craignait de perturber son objet en y introduisant une variable externe jugée trop aléatoire [...]. On peut y lire un autre signe de la place quasi exclusive désormais reconnue par l'historien à la « territorialité » québécoise, c'est-à-dire à tout ce qui relève de la dynamique sociale, économique et culturelle associée à cet espace. » Rien dans le reste de l'article ne vient montrer que l'auteur déplore l'évacuation de cette « variable aléatoire » du champ d'intérêt de l'historien, la « territorialité » célébrée ici étant, on l'aura compris dans la nomenclature en fin de citation, exempte de « dynamique » politique...
|

