Robert Fossaert
La révolution informatique
au service des sciences sociales.
Andresy, France, octobre 2012. Texte inédit.
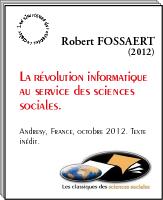
- (1) Quelques précautions
- (2) Un tri attentif
- (3) Quelques pistes essentielles
-
- (a) sur la crise
(b) sur les perspectives ouvertes aux principaux États
- (c) la loi du nombre
-
- (4) Des outils pour les sciences sociales
-
- (a) des normes
(b) des normes combinables
- (c) des agencements pratiques
Les disciplines qui s'efforcent d'étudier les choses sociales de façon aussi scientifique que possible sont souvent regardées avec dédain par les chercheurs qui exercent leurs talents du côté des choses naturelles. Souvent les dédaigneurs font masse des sciences humaines et sociales pour les opposer nettement aux sciences dures que seraient les disciplines tournées vers l'exploration de quelque aspect de la nature. A vrai dire, les expressions qui viennent d'être mises en italique sont lourdes de préjugés. Quelques précautions sont nécessaires pour clarifier ce qu'elles évoquent.
(1) Quelques précautions

En premier lieu, il faut garder souvenir des longs parcours accomplis par l'espèce animale-humaine pour articuler ses dires et inventer les écritures grâce auxquelles les membres de cette espèce peuvent connaître les actes et opinions des générations précédentes et éduquer les générations futures. Mais il ne faut pas se faire d'illusions sur la qualité des écrits passés et des dires présents. Le tri entrepris depuis des millénaires et sans cesse poursuivi demeure indispensable pour extraire du brouhaha humain les trésors qu'il véhicule. Peu à peu ces trésors ont été organisés en doctrines, assemblés en théologies, épurés en philosophies, raffinés en savoirs, mais la quintessence que chaque génération en dégage sous le nom de sciences est, à jamais, exposée à des ajouts dits "découvertes" et aux nouveaux assemblages et filtrages qui s'ensuivent. Le tout dans un monde tronçonné en "civilisations", longtemps distinctes, où l'alchimie scientifique pratiquée dans la civilisation "occidentale" qui est aujourd'hui la plus répandue n'a pas effacé tous les tris hérités d'autres civilisations.
En second lieu, il faut mettre un peu d'ordre dans le repérage des objets réels auxquels les sciences en voie de maturation ou encore balbutiantes entendent consacrer leurs recherches. La nature pourrait désigner toute la matière-énergie perceptible ou supputable depuis la Terre où vit l'espèce animale-humaine. De fait, les humains eux-mêmes sont pleinement inscrits dans cet objet réel qui est le plus enveloppant que l'on connaisse. Néanmoins, les sciences de la nature effectivement déployées sont peu enclines à embrasser toute la dite matière-énergie. Elles s'inquiètent de ce que porte la Terre, depuis son enveloppe montagneuse et océanique jusqu'à ses profondeurs extrêmes, à quoi elles adjoignent tout ce qu'elles peuvent "découvrir" au delà de l'atmosphère terrestre, à mesure que des appareils permettent d'en percevoir "quelque chose" que leurs théories s'efforcent d'élucider. Mais quand leurs examens se tournent vers l'espèce animale-humaine, leurs curiosités s'affadissent. Elles s'inquiètent de la physiologie des individus de cette espèce et font commerce d'une médecine et d'une pharmacopée plus ou moins éclairées par leurs savoirs. Elles risquent parfois quelques incursions du côté de la psychologie des mêmes individus, mais semblent piétiner, en attendant que deviennent pleinement intelligibles les organes corporels qui sous-tendent cette psychologie humaine. Elles passent difficilement de ce que le vocabulaire usuel désigne comme "conscience" et (depuis peu) comme "inconscient", jusqu'à la chose dite cerveau et aux autres éléments du corps humain éventuellement impliqués par ce qui est visé par ces mots. Bref les sciences de la nature s'arrêtent "quelque part" du côté de l'individu humain, alors qu'elles ont moins de scrupules quand il s'agit de comparer l'espèce animale-humaine avec les autres espèces animales.
En troisième lieu, il faut souligner que les sciences tournées vers les "choses de la nature" jouissent de deux privilèges. Elles font usage d'outils nés pour les travaux de toute sorte, ultérieurement raffinés, étendus et surmultipliés selon les demandes de leurs savants utilisateurs. Autrement dit, les outils des paysans, des artisans, des marins – et peut-être aussi des soldats - sont le point de départ d'un outillage propre à ces sciences. Les novations que la révolution industrielle a fait pulluler ont enrichi cet élan que l'actuelle révolution informatique suractive désormais. Ainsi équipées, les sciences des "choses de la nature" jouissent de ressources humaines et financières beaucoup plus substantielles que celles qui irriguent les autres démarches à ambition scientifique.
En quatrième et dernier lieu, il faut embrasser d'un même regard toutes les observations précédentes pour constater que les sciences des objets naturels débordent vers des objets tout à fait artificiels créés par leurs soins. Quand leurs recherches vont au-delà du visible et du mesurable, quelle que soit la puissance des outils scientifiques dont elles peuvent se servir, leurs investigations, emportées par la force des calculs et autres outils mathématiques construisent inévitablement un réel qui est tout à la fois probable et imaginaire. La probabilité devient certitude quand "un homme peut aller marcher sur la lune", mais l'imagination scientifique ne s'en tient jamais là et les recherches se poursuivent, "plus loin". Ailleurs, la probabilité demeure douteuse quand des décennies d'efforts et des milliards d'investissements permettent finalement de "photographier" le "boson de Higgs", mais la recherche scientifique se prolongera, par création de nouveaux outils ou/et par réélaboration de la théorie, c'est-à-dire par enrichissement du monde imaginaire, extrapolé du réel concret. Le monde "réel imaginaire" est la véritable aire d'expansion des sciences de la nature. La réflexion que je viens d'exemplifier du côté de "l'infiniment lointain" comme du côté de "l'infiniment petit" ne vaut pas seulement pour l'astronomie ou la physique. Elle est généralisable : celles des disciplines qui ne savent pas repousser "les frontières de la science" finissent par se routiniser jusqu'à perdre leur renom scientifique.
(2) UN TRI ATTENTIF

J'ai noté ci-avant les réticences et blocages des "sciences de la nature" quand elles approchent plus ou moins des objets relevant des catégories "société" et "homme". Mais la difficulté est plus rude encore pour qui veut dissocier scientifiquement l'homme et la société : ici, le tri doit devenir très attentif. De savantes généalogies décrivent la ou les transitions par lesquelles les espèces animales les plus "évoluées" sont devenues "humaines". Le cerveau, la main, l'outil, le langage, la pensée jalonnent ces itinéraires millénaires dont j'avoue tout ignorer. Pour leur part, l'homme et la société semblent indissociables. L'espèce humaine vit toujours en société. Les robinsonnades sont des mythes romanesques. Il n'existe jamais d'hommes sans société, ni de sociétés sans hommes. Mais cette liaison consubstantielle doit être rompue pour permettre le déploiement de sciences de plus en plus diversifiées capables d'explorer pleinement ces deux catégories d'objets, car ce sont, de fait, des objets d'essence très différente, nonobstant leur permanente comprénétration.
Les "sciences humaines" perdent de leur mordant lorsqu'elles se tournent vers des situations sociales où les individus de l'espèce humaine s'estompent jusqu'à devenir "personnellement" invisibles. À l'inverse, les "sciences sociales" sont d'un secours qui s'affaiblit, puis devient nul lorsque leur champ d'observation se garnit d'hommes dont les actions individuelles (= travaux, comportements, paroles, etc.) sont de mieux en mieux observables. Je pourrais résumer mon propos par une formule du genre "qui veut voir l'homme ne peut voir la société et réciproquement" mais elle durcirait par trop la distinction que je suggère. On me comprendra mieux si je prends comme point de départ des situations qui relèvent assurément de la zone mixte où l'homme et la société sont effectivement indissociables. Quand un romancier raconte une histoire, fût-elle riche comme du Balzac, du Zola ou même du Jules Romains, il projette des lumières non négligeables sur la "société" ainsi que sur "l'homme". Quand un journaliste de presse, de radio ou de télévision présente un reportage, il fait de même, en ajoutant parfois quelques doses d'un savoir plus général ou mieux calibré, sur la "société", par exemple sous forme de "statistiques" ou de "données géopolitiques", etc. Quand des œuvres collectives complexes telles un film ou une représentation théâtrale font "vivre sous nos yeux" une situation dramatique qui peut être parfois plus intensément riche qu'un reportage, ils enrichissent peut-être la "représentation" du social, tout en approfondissant celle de l'humain. Mais en toutes ces hypothèses, la sociologie, en tant que "science de la société" est loin de trouver son compte.
Laissant de côté les "sciences de l'homme" dont je ne connais pas grand chose, pour m'en tenir aux seules investigations tournées vers les "choses sociales" où j'ai acquis quelque entrainement, j'en suis venu à considérer que les "sciences de la société" gagneraient beaucoup à concevoir plus clairement ce que peut être, pour elles, l'équivalent du monde "réel imaginaire" des sciences de la nature que j'ai évoqué plus avant. L'équivalent, mais non le simple décalque. Les sciences de la nature opèrent sur des objets réels, autant que leurs outils le permettent et elles prolongent leurs résultats par des extrapolations bien raisonnées et éventuellement vérifiables. Les sciences de la société doivent découvrir leur objet sous de très réels amas d'humains actifs et diserts. Il leur faut écarter ces distractions pour imaginer ce qu'est, dans toute son ampleur, la société réelle qu'ils entrevoient là dessous.
Elles disposent néanmoins de quelques pièces d'excellente qualité pour donner du réel au bâti imaginaire qu'il leur faut assembler, sans trouver grand secours du côté des mathématiques et autres machines-à-extrapoler. Ces pièces se trouvent dans les savants travaux, diversement labellisés, dont les sociétés d'hier et d'aujourd'hui ont fait l'objet de la part d'historiens, de géographes, de philosophes même, et aussi, sur le tard, d'économistes et de sociologues, quand ces travaux ont supporté avec succès l'épreuve du temps et, mieux encore, lorsqu'ils peuvent être prolongés par des recherches tout aussi prometteuses. Au prix d'un tri bien réfléchi ces éléments du "réel imaginaire" des sciences sociales sont d'autant plus précieux qu'ils ont pris une grande extension durant les derniers siècles, à mesure que la recherche scientifique s'est dégagée des spéculations philosophiques qui étaient son berceau.
Pour ma part, j'ai esquissé un travail de ce genre dans les six volumes de La Société et dans les deux ouvrages qui ont pris la place des derniers tomes projetés pour cette série, quand les transformations effectives du système mondial ont imposé une réforme majeure de mon projet [1]. Projet, dont la reprise et la révision ne peuvent cesser, tant notre monde est agité de transformations profondes et rapides, tandis que se multiplient les travaux proprement sociologiques pouvant enrichir l'image rétrospective du réel imaginaire et - ce qui importe plus encore - ses projections aptes à éclairer l'action présente et les projets d'avenir.
(3) QUELQUES PISTES ESSENTIELLES

Vu depuis les sociétés les plus développées du monde actuel, le réel imaginaire qu'il faudrait enrichir par priorité comprend assurément :
- l'intelligence de la crise économique mondiale qui ne cesse de s'aggraver depuis plusieurs décennies;
- la clarification des perspectives offertes aux principaux États;
- l'évaluation des périls démographiques et écologiques.
- (a) sur la crise

En concentrant diverses études que j'ai publiées de 1975 à 2012 (cf. note 1), je puis esquisser une perspective globale sur "la crise" aujourd'hui omniprésente. Elle doit être comprise comme un processus amorcé dès les années 1970 et cumulativement aggravé, depuis lors, du fait de la mort du système de Bretton Woods, des secousses (pétrolières et autres) du marché mondial, de la prolifération des banques commerciales hors contrôle d'une banque centrale qualifiée, de la multiplication des économies ouvertes au libre transfert de capitaux, des spasmes spéculatifs qui en ont résulté, des formes prises par les "aides" financières aux pays affaiblis par ces spasmes, le tout se nourrissant, par surcroît, de déséquilibres budgétaires majeurs, principalement aux États-Unis. Tandis qu'un peu partout, les dépenses publiques excédaient de beaucoup les ressources fiscales, les dépenses privées ont été nourries plus par l'endettement que par des revenus réguliers.
Ces mouvements enchevêtrés ont été accompagnés par une prolifération internationale des grandes firmes de tous pays, bientôt suivies par un menu fretin de sous-filiales commerciales et "de services". L'économie s'est mondialisée. Les États, même les plus puissants, ont cessé de contenir et d'orienter leurs "économies nationales". Les firmes et les banques opérant de concert ou non, ont enflé et accéléré la valse mondiale des capitaux flottant sur des bourses et d'autres "plateformes" de moins en moins contrôlées.
La distribution mondiale de la valeur créée par le travail agricole, industriel et de service que la révolution industrielle avait déjà infléchie depuis les débuts du 20è siècle au bénéfice des grandes firmes à dominante industrielle, a été derechef infléchie, mais de façon massive autant que spasmodique, vers les firmes financières de toute espèce, dont une part essentielle s'est libérée des prudences traditionnelles de la banque, en même temps qu'elle échappait au contrôle technique des États. Des phénomènes dramatiques et spectaculaires ("bulles immobilières", rapt d'épargnes populaires, fluctuations saccadées de cotations et de taux de change, prêts faramineux aux États "surendettés", etc.) ont jeté sur ces mouvements profonds une brume opaque mais fluide qui en masque la nature politique profonde. Brume qui est déchirée de temps à autre quand des péripéties télévisables (expulsions d'acheteurs surendettés, effondrement d'établissements bancaires, ruées de ministres "pour sauver l'euro", etc.) permettent de distraire les opinions publiques, tout en faisant mine de les informer.
Les remèdes politiques qui pourraient arracher l'économie mondiale à cette spirale ont été définis de différents côtés et de façon assez souvent pertinente, mais presque toujours partielle. Le club des banques centrales a mis à jour le catalogue des précautions que devraient prendre les banques commerciales pour encadrer derechef leurs prises de risques. Mais sa version la plus pertinente (dite Bâle III) a été largement étirée dans la durée et sans cesse combattue par la plupart des banques. Les États-Unis ont esquissé une réforme financière plus vaste et parfois pertinente (loi Dodd-Frank), mais sont incapables de la mettre en œuvre, tant la résistance des banques locales et fédérales (privées ou à demi-publiques) a multiplié les obstacles et les délais. L'Union Européenne serait mieux orientée quant aux réformes à opérer, mais elle ne peut agir collectivement, par suite des insuffisances de sa charte constitutive, des déficits cumulés par plusieurs pays membres, enivrés par un euro mal encadré et des conceptions parfois désuètes de l'équilibre budgétaire. Bref, le capital financier (piloté principalement par Wall Street et la City londonienne) a victorieusement bloqué les politiques anti-crises, si bien que les États ayant un poids suffisant pour agir ne réussissent pas à stimuler une reprise de la croissance économique.
La suite est très incertaine. Elle ne se joue pas seulement dans les États aujourd'hui les plus développés.
- (b) sur les perspectives
ouvertes aux principaux États

Les principales novations intervenues de par le monde, depuis le début de "la crise" sont "excentriques". Elles dérangent l'ordre mondial et débordent du centre de gravité qui s'était affirmé, tout au long du 20è siècle, autour de l'Atlantique, sous la houlette américaine.
À très grands traits, les novations principales ont concerné l'effondrement de l'URSS, la réunification de l'Allemagne et l'affirmation de son poids en Europe, l'élan pris par quelques "tigres asiatiques" [2] suivis par la Chine post-maoïste, le dynamisme plus tard conquis par le Brésil et la majeure partie de l'Amérique latine. À quoi s'ajoutent des poussées moins vigoureuses, mais dans des zones massives aux Indes et (quelque peu) en Afrique. Parmi les pointillés, de portée moins manifeste, il faut noter encore : le potentiel du Japon, nonobstant sa perte de vitesse après les décennies 1950-80 et l'apparent réveil de la Russie en ce début de 21è siècle.
Le contraste est grand entre l'ex-Tiers Monde et les puissances occidentales d'aujourd'hui. L'Europe est anémiée par une décolonisation mal gérée (particulièrement par la France) et par la crise dite de l'euro évoquée plus haut. Le cas particulier de la Grande Bretagne est à souligner, car son anémie, encore masquée par ses ressources pétrolières, s'accentuera avec l'épuisement de celles-ci et peut-être aussi par la domestication des banques. Quant aux États-Unis, empêtrés dans les ambitions de leurs EnE [3], ils sont exposés non point à une décadence, mais plutôt à une douloureuse série de reconversions, tant de leur rôle mondial que de leur organisation interne.
La Chine qui progresse déjà vers une position centrale relayant celle des États-Unis a des chances de l'atteindre et de la conserver quelque temps, non sans la modifier. L'affaire se décidera, au fil des prochaines décennies, selon les réponses qu'elle apportera à deux questions essentielles d'ores et déjà perceptibles, mais à maturation lente. Première question : comment arbitrera-t-elle en fait entre ses potentialités capitalistes et les volontés "socialistes-populistes" dont elle a hérité et qu'elle affiche encore ? Deuxième question : comment ajustera-t-elle sa croissance (à fort rayonnement mondial) avec les réactions des autres puissances, à commencer par les États-Unis ? Ces deux questions se détailleront évidemment en une vaste série de problèmes "ponctuels".
À titre d'exemple, on peut évoquer le problème de la monnaie internationale. Malgré les faiblesses économiques des États-Unis, leur $ demeure la devise prépondérante. Ils tirent ce rôle de la position (déjà atténuée) que les statuts du FMI leur maintient. [4] Mais la Chine qui détient déjà, en réserves, plusieurs trillions de $ dispose de moyens de pression sur une trésorerie américaine condamnée à de fréquents emprunts, faute d'une fiscalité suffisant à couvrir ses dépenses. A quoi s'ajoutent les pressions d'autres pays désireux d'atténuer la prédominance américaine. Cette querelle de pouvoir a déjà commencé d'évoluer et, sans entrer dans un examen détaillé des réformes ultérieurement envisageables, on peut tenir pour probable que d'ici une ou deux décennies tout au plus, les États-Unis auront du céder le pilotage du FMI, non pas à la seule Chine, mais à un bref collège de direction où figureront notamment l'Inde, le Japon, l'Union européenne et peut-être le Brésil, voire d'autres États aujourd'hui émergents.
J'ajoute brièvement que les grandes zones tumultueuses de la planète constituent, en quelque sorte, le négatif des principaux États (actuels ou en devenir). Ces théâtres offerts aux "grands jeux" de ces derniers sont situés en Asie occidentale et centrale et dans diverses grandes régions de l'Afrique, mais pourraient aussi se cristalliser dans les îles et presqu'îles du sud-est asiatique.
- (c) la loi du nombre

Le 20è siècle a mondialisé l'industrie et la finance, ainsi que l'expérience des guerres. Il a moins bien fait connaître des mouvements démographiques pourtant fort amples et il n'a développé une "civilisation" du travail limité, de l'habitat moderne et des sports et loisirs que dans d'assez courtes zones, sauf à en vulgariser mondialement les images.
Le début du 21è siècle prolonge ces tendances, sans mesurer déjà les énormes inflexions qu'elles vont subir. La plus connue concerne sans doute la démographie, mais sous quelques angles seulement. Le passage de 2 à 7 milliards d'humains en un siècle a soulevé plus de craintes que d'espoirs, sans que l'énorme freinage de la natalité soit clairement perçu. Le fait que l'allongement de la durée moyenne de vie soit désormais la principale source de croissance démographique est un bienfait dont les conséquences multiples sont à peine entrevues. Les bouleversements qui vont en résulter en termes d'avortement, de contraception, de structures familiales, de scolarisation, de durée d'études probablement longues et scandées, d'habitat, de migrations et de voyages, de soins médicaux et hospitaliers, d'euthanasie, de voyages, d'exil des lieux de travail et de retraite ne sont qu'une partie des problèmes, riches de variantes fort contrastées, qu'auront à résoudre les quelques centaines d'États existants, mais aussi les millions d'entreprises et autres organisations et une bonne partie des milliards d'habitants diversement dispersés sur la planète. D'autant que celle-ci est peut-être exposée à des changements climatiques majeurs, avec tout un cortège de conséquences terrestres et maritimes de portée géographique énorme, lesquels s'accompagneront assurément de surcharges des demandes d'aliments, de matières premières plus encore que de ressources énergétiques.
Sans toujours évaluer attentivement ces risques surabondants, les associations écologistes et certains partis politiques s'efforcent d'en prévenir la partie qui leur semble la plus urgente ou les plus "payante" en gains d'influence. Provenant de classes sociales plus diversifiées que jadis, les élites administratives et (parfois) militaires, les ingénieurs et cadres d'entreprises, les intellectuels bien formés des écoles et medias, les scientifiques avérés et d'autres catégories d'acteurs sociaux de haut vol s'attaquent de façon souvent moins routinière que naguère à ceux des problèmes que leur pose une vie sociale qui devient plus turbulente. Mais dans la plupart des pays, les questions nouvelles et les risques accrus excèdent souvent les capacités en place, même dans les populations les mieux habituées à la modernité et aux adaptations fréquentes qu'elle requiert. Mon jugement est sans doute par trop global et peut sembler pessimiste, mais il exprime une conviction qui s'est forgée dans maints secteurs des sociétés présentes, durant une vie déjà longue : les capacités d'action aussi scientifique que possible se sont accrues et affinées beaucoup moins vite que l'accumulation des problèmes à traiter. Autrement dit, la vie sociale galope, tandis que dans maints domaines la décision politique prend du retard.
Il est donc plus nécessaire que jamais de développer les sciences sociales (au sens propre du terme) tout en les finalisant de mieux en mieux. J'écris ceci le jour où la NASA sauve son honneur (et son budget) en faisant atterrir sur Mars un robot d'étude. Je tiens que des investissements cent ou mille fois supérieurs à ceux que les activités scientifico-militaires de la NASA[5] récoltent ces temps-ci seraient utiles pour former les scientifiques, les ingénieurs, leurs assistants et leurs appareillages qui seront requis au cours des prochaines décennies afin de maîtriser une fraction croissante des problèmes à venir. Des problèmes, mais lesquels ? Ceux qu'une hardie révision des institutions scientifiques en vigueur mettra au premier plan, en bousculant leurs routines. Ceux dont de nouvelles institutions, assemblées autour d'équipes plus juvéniles, mais aussi internationales que celles du CERN, formeront le projet. Ceux, en toute priorité, dont les sciences sociales proprement dites seront le levier, tant il est vrai que c'est du côté de la "société" (plus que de la "nature") que viendront la plupart des tumultes annonçables, alors que ces sciences très médiocrement financées sont, pour le moment, orientées de façon peu pertinente et faiblement alimentées en renforts qualifiés.
La "société" a besoin d'élans comparables à ceux de la Renaissance ou des Lumières. Des élans aussi fougueux mais mieux orientés que ceux des révolutions nationalitaires du 19è siècle ou des révolutions sociales du 20è siècle. D'élans vers le savoir ayant priorité sur le pouvoir. Vaste et vague programme dira-t-on. Oui, si l'on s'en tient aux mots, comme je viens de le faire ! Non, si l'on sait donner la priorité aux outils dont les sciences sociales ont besoin pour mordre sur leur réel et pour l'imaginer autant que de besoin.
(4) DES OUTILS
POUR LES SCIENCES SOCIALES

Une société est infiniment plus complexe qu'un porte-container géant ou que les appareils de manutention automatisée qui l'approvisionnent ou le délestent dans les Rotterdam et les Shanghaï du monde marchand. Les industries allemandes, américaines, anglaises, françaises et italiennes qui fabriquent les pièces [6] des avions porteurs de centaines de passagers, forment un ensemble bien moins complexe que le système mondial actuel. Le long chemin qui a conduit des premiers outils jusqu'aux machine-outils, puis à leur automatisation a bénéficié, par ricochet, aux sciences de la nature. Mais il n'a pas eu d'équivalent jusqu'ici, pour ce qui est des machines-à-comprendre ce que société veut dire.
Pourtant, il existe, de longue date, des outils à finalité sociale, mais ils sont rarement conçus en vue de mieux comprendre la société, considérée dans son ensemble comme dans ses détails. Ce sont des relevés fiscaux, des décisions de justice, des inventaires de forces militaires. Plus la société devient complexe, plus leur liste s'allonge, depuis les déclarations à l'état-civil jusqu'à l'infini détail des taxations et aux multiples paperasses qui accompagnent tous les aspects de la "vie administrative" locale et globale des États bien assis. Désormais, le "recensement général de la population" est d'usage en maints pays et diverses synthèses spécialisées s'ajoutent souvent à cet immense tableau, à commencer par les comptes nationaux qui ont fait du PIB [7] un indicateur de la santé économique et de la richesse nationale. En outre, la plupart de ces images de la "vie sociale" sont désormais produites par des machines à écrire, à calculer, à combiner dont des ordinateurs pourraient assembler et stocker les résultats, autant que l'exigeraient leurs programmes. A un degré moindre de détail ou de publicité, les entreprises de toute la "vie économique" et bon nombre d'agences de la "vie culturelle" qui s'activent à des fins artistiques, religieuses, sportives, et autres à l'infini tiennent également des traces de leurs pratiques, si bien que leurs contributions à la "vie sociale" seraient elles aussi exploitables.
Mais toute cette pâture éventuelle pour enquêtes journalistiques et ces trésors pour historiens sont rarement conçus et machinés à des fins scientifiques, quoique bon nombre d'économistes et de sociologues figurent parmi leurs utilisateurs éventuels. La normalisation, c'est-à-dire l'établissement de normes claires à suivre dans des domaines bien définis [8] est un objectif affiché par maintes administrations, mais elle est moins féconde ici que du côté des firmes industrielles, car aucun "produit fini" (comme un avion…) n'en teste la pertinence. À vrai dire, les relevés, contrôles et autres recensions que les administrations – privées, ou publiques - affectionnent presque en tous domaines [9] fourniraient une abondante masse de données brutes dont l'exploitation enrichirait considérablement les sciences sociales, si trois conditions étaient remplies :
- une élaboration selon des normes scientifiques
- un cadrage les rendant combinables quels qu'en soient les sources et les objets
- une disponibilité pratiquement agencée.
- (a) des normes

L'exemple glorieux des comptabilités nationales a mal vieilli, car la multiplication des firmes multinationales et les "délocalisations" qu'elles provoquent se mêlent aux migrations internationales de la main d'œuvre (banale, qualifiée ou de haute voltige) pour affaiblir leur pertinence. Les banques qui les desservent ou les contrôlent obscurcissent plus encore la réalité économique par leurs maquillages et leurs spéculations. La CNUCED et de rares autres organisations tentent vaillamment d'explorer cette nouvelle Mer des Sargasses, mais il faudra toute l'autorité d'États domestiquant le capital financier et entraînant l'ONU vers une redéfinition des normes internationales des PIB et autres statistiques économiques pour que le pilotage (national et international) de la production, du commerce et du crédit retrouve, à tout le moins, le niveau qui fut le sien, pendant quelques décennies, juste après la deuxième guerre mondiale.
Cet exemple massif n'est nullement isolé. C'est tout l'univers des échanges et des changes, des trafics et des trocs, des revenus et des investissements qui doit être bordé par un maximum de normes nationales, rendues aussi internationales que possible, pour que la mondialisation en cours ne débouche pas sur de multiples catastrophes. Au reste, le recadrage des données de la "vie sociale", comme l'inventaire des institutions émettrices de leurs flux, ne doit pas concerner la seule "vie économique", mais doit également s'appliquer dans toute la mesure du possible à la "vie politique" et à la "vie culturelle (= idéologique)" [10] de chaque société, pour que les sciences sociales puissent enfin s'épanouir par une saisie scientifique de l'objet réel qu'est la société. Etant bien entendu que la mise à jour des normes et des inventaires est à entretenir selon une périodicité répondant à leur "évolution naturelle" sans trop souffrir des contraintes conjoncturelles, budgétaires par exemple. La France qui a dû remplacer son recensement quinquennal de la population tout entière, par un recensement portant chaque année sur un dixième de cet ensemble, avec extrapolation des résultats à l'échelle de l'ensemble, s'est exposée de ce fait à de multiples réclamations de localités et d'autres entités, perturbées par des résultats "imprécis". Il me semble qu'elle fournit ainsi un exemple à ne pas suivre.
Les économistes savent à peu près ce qu'il conviendrait de "normer" à tous les niveaux des échanges, mais ils n'ont aucune autorité sur les comptables, commissaires aux comptes du monde des affaires, ni sur les fonctionnaires qui actionnent les rouages centraux et locaux de chaque Etat, ni non plus sur les douaniers et autres agents aptes à mesurer les trafics transfrontières. Les politistes sont un peu mieux informés dans les pays où des procédures (électives et autres) conduisent à de multiples comptages, eux-mêmes adossés aux données des recensements et à leurs divers compléments. Mais, dans l'infini détail de l'idéologie(=culture), il est peu de comptages pertinents (hormis le scolaire et diverses enquêtes ponctuelles), si bien que les rares mesures un peu significatives à une échelle sociale émanent de sondages "d'opinions" et d'études "de marchés", matériau friable souvent incapable de supporter un lourd édifice scientifique. Beaucoup d'initiatives seraient à prendre dans ce domaine immense d'où sourd l'hégémonie idéologique qui partage avec la domination politique et l'exploitation économique l'orientation générale de chaque société.
- (b) des normes combinables

Même si les jugements à l'emporte-pièce que je viens d'avancer devaient souffrir de nombreux correctifs, la conséquence que je vais en tirer n'en tiendra pas moins. En effet, si des "normes" affinées et mieux assises devenaient monnaie plus courante dans le champ d'action de diverses sciences sociales, il n'en resterait pas moins que l'objectif commun à toutes les "sciences de la société" devrait être de produire des résultats utilisables par chacune de celles-ci, c'est-à-dire des résultats incontournables tant que de nouvelles "découvertes" pratiques et théoriques ne viennent pas imposer le recours à de nouveaux savoirs.
Dans cette perspective globale et durable, mais évolutive, il est plusieurs candidats pour organiser des combinaisons légitimes des résultats acquis. De toute évidence, ces résultats devraient être clairement situés dans l'espace et le temps, faute de quoi on leur prête naïvement une validité universelle. Trop de discours qui se veulent scientifiques et qui portent sur quelque aspect de la société négligent cette précaution méthodologique, si bien qu'ils sont exposés à des discussions souvent vaines, comme il en est tant dans les colloques universitaires. Le calendrier et la géographie doivent toujours cadrer les recherches sociologiques pour les rendre validables : le calendrier pour périodiser les résultats affichés et vérifier leur compatibilité avec leur contexte temporel; la géographie pour les localiser aussi exactement que possible. Mieux, ce cadrage spatio-temporel dûment défini et rendu aussi clair et souple que possible est la condition première à remplir pour rendre globalement combinables les résultats de toutes les recherches sociologiques. Un exemple d'apparence triviale va expliciter cette exigence majeure.
En publiant les résultats définitifs de l'élection législative française de mai 2012, Le Monde a fait usage d'une infographie pertinente qui a croisé les votes acquis par circonscription électorale et les revenus (fiscalement déclarés) des électeurs de cette même circonscription. Les résultats de ces croisements ont été détaillés, circonscription par circonscription, selon l'ampleur des votes, le niveau des revenus et le décompte des "parts fiscales" par famille pour être présentés sur deux pages en vis-à-vis, avec des dégradés de couleurs distinctes, pour les partis de droite ou pour ceux de gauche. Ce tableau n'est pas facile à décrire avec des mots, mais il est d'une lecture très aisée et d'une bonne richesse documentaire. Je le considérerais volontiers comme le prototype de la combinaison des données sociologiques, du moins tant qu'une méthode plus riche en données et d'une lisibilité plus commode encore ne sera pas disponible.
En multipliant les données bien normalisées et le détail des aires (géographiques ou/et géopolitiques) auxquelles elles correspondent, tout en explicitant clairement les liens plus subtils qui relient entre elles ces données, les sciences sociales adjoindront aux relevés de choses concrètes et de groupes durables dont toute société est pleine, un imaginaire réel aussi décisif que celui que bâtissent d'autre manière les "sciences de la nature".
- (c) des agencements pratiques

Tout explorateur des annuaires et autres compilations de données administratives ou politiques sait à quel point ce fouillis aride est énorme. Mais quel qu'en soit le collecteur, les amas provenant des autres sources d'une infinie diversité dont toute société développée déborde ne sont pas moins "illisibles" sans de longs et savants tris. La normalisation systématique des "données" et leur cadrage aussi "scientifique" que possible dont je viens de me faire l'avocat produira inévitablement une énorme quantité de "tableaux" (et d'autres "assemblages") très variés. L'infographie de résultats électoraux que j'ai prise comme exemple est, tous comptes faits, d'une extrême simplicité. Elle n'associe que quatre types de données : des aires géopolitiques, leur populations d'électeurs, les votes enregistrés localement et un extrait (dûment travaillé) des relevés fiscaux afférents à ces mêmes populations. Pour les centaines de milliers d'autres images sociales qui pourraient être construites en prolongement de cet élan, il faudrait synthétiser beaucoup plus de quatre types de données.
Mais la révolution informatique peut donner aux sciences sociales une telle capacité. A terme nullement lointain ses bénéfices rejoindront ceux que la révolution industrielle des outils et machines a procuré aux sciences de la nature. La prolifération des apps [11] pourrait aisément s'étendre aux outils de synthèse approvisionnant les documentations et les recherches de nature sociologique, dès lors que la normalisation et le cadrage des données deviendraient monnaie courante, tandis que les normes des enseignements et des recherches s'adapteraient à une réelle révolution de la sociologie. Savoir qui, des fiscalistes ou des notaires, des policiers ou des magistrats, des géographes ou des historiens, (etc., à l'infini) sera le premier à adjoindre aux apps actuels, de nouvelles machines est douteux, d'autant qu'il ne s'agira plus de jeux ou de commodités banales, mais bien de données savantes et complexes. Mais ce basculement est inévitable. Savoir si sa contagion partira des écoles les plus audacieuses (commerce et sciences politiques, notamment [12]) ou si elle sera incitée par des éditeurs ou des journalistes, est une question indécidable a priori, mais qui ne tardera pas à se trancher de fait.
Pour ma part, je souhaiterais que cette révolution informatique pour les sciences sociales mûrisse à partir d'administrations savantes comme l'INSEE où elle a déjà pénétré l'établissement et l'exploitation de données économiques et démographiques, avec divers débordements moins clairement finalisés. Mais il importerait d'extraire de cette direction générale du Ministère des Finances, un nouvel état-major tout à fait indépendant, dirigé conjointement par des universitaires, des statisticiens et des personnalités qualifiées. Il s'agirait, en somme, de guider les centres universitaires, d'orienter les administrations étatiques de tous types, d'inciter les groupements d'entreprises de tous genres et d'entraîner une grande quantité d'associations aux finalités des plus diverses, vers l'élaboration de normes claires et "combinables", de cadrages ajustables à de multiples échelles spatio-temporelles et de compilations durables des données ainsi établies et révisées à bonne périodicité. Toutes orientations à promouvoir dans le cadre national, en essayant de les faire imiter à l'échelle d'ensembles internationaux.
Robert Fossaert
Andresy, août 2012
[2] Singapour, Taïwan, Corée du sud, etc.
[3] Ces EnE ou États dans l'État visent deux puissances américaines aux capacités bien supérieures à celles de chacun des cinquante États assemblés dans les USA : le système bancaire et le dispositif militaro-industriel, le tout avec des filiales ou des bases dans le monde entier. Voir à ce sujet L'automne des États-Unis (2011), sur le site indiqué par la note 1.
[4] Au FMI, toute décision importante doit être ratifiée par 85 % des droits de vote. Or les USA détiennent encore 17 % de ces droits. De quoi bloquer les révisions statutaires et les autres décisions du FMI qui ne leur conviennent pas.
[5] Idem pour maintes autres agences des États-Unis, comme de leurs alliés ou rivaux.
[6] Pièces qui doivent être assemblées mieux qu'au millimètre près, nonobstant les différences de langage, de métrique et de traditions industrielles des ateliers où elles sont usinées.
[7] Lequel est – qui l'ignore ? – le Produit Intérieur Brut d'un pays.
[8] Les Annales des Mines ont publié en juillet 2012, dans le n° 67 de leur série "Responsabilité et Environnement" une remarquable étude sur "La normalisation : principes, histoire, évolutions et perspectives" qui fait le point sur ses dimensions actuelles, en particulier dans l'ordre international.
[9] Le "secret-défense" et autres cachotteries politiques rejoignent le "secret des affaires" dans l'arsenal des ruses anti-normalisation et anti-contrôle.
[10] J'ai souvent présenté ce concept d'allure biscornue. Voir, par exemple le tome VI de La Société.
[11] Si vous ignorez le sens de ce mot américain, interrogez les jeunes et très jeunes de votre entourage.
[12] Quoique récente, l’École d'Economie de Paris pourrait ouvrir cette voie, si j'en juge par les travaux d'Hippolyte d'Albis qui vient d'être couronné, ce mois-ci, par le Prix du meilleur jeune économiste décerné par Le Monde et le Cercle des Economistes.
|

