|
Simon LANGLOIS *
“Alexis de Tocqueville:
un sociologue au Bas-Canada”.
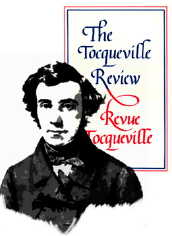 Un article publié dans la revue The Tocqueville Review / La revue Tocqueville, Numéro spécial Alexis de Tocqueville (1805-1859) A Specal Bicentennial Issue, vol. XXVII, no 2, 2006, pp. 553-574. Un article publié dans la revue The Tocqueville Review / La revue Tocqueville, Numéro spécial Alexis de Tocqueville (1805-1859) A Specal Bicentennial Issue, vol. XXVII, no 2, 2006, pp. 553-574.
- Table des matières
-
- Introduction
-
- Ce que Tocqueville a vu au Bas-Canada
- Nation et démocratie
-
- Conclusion
-
- Références
Introduction
- « Mais ce qui nous a intéressés le plus vivement au Canada,
ce sont ses habitants »
- Tocqueville, lettre du 7 septembre 1831.

L’année 2005 marque le 200e anniversaire de naissance d’Alexis de Tocqueville, célèbre de ce côté-ci de l’Atlantique pour son ouvrage De la démocratie en Amérique, publié en 1835, écrit après un long voyage de dix mois aux États-Unis, soit du 9 mai 1831 (arrivée à Newport) jusqu’au 20 février 1832, alors qu’il n’avait que 25 ans.
Tocqueville est né à Paris en 1805 dans une grande famille aristocratique française mais ses racines se trouvent en Normandie où il vécut, dans le village de Valognes près de Cherbourg. Il était l’arrière-petit-fils de Malherbes et le cousin de Chateaubriand. Son père et sa mère ont été emprisonnés à Paris sous la Terreur, à l’époque de la Révolution française, et sauvés in extremis de l’échafaud. Avocat de formation, il est devenu magistrat au début de sa carrière et il a épousé une anglaise, Marie Motley. À vingt-six ans, il a traversé l’Atlantique, officiellement afin d’étudier le système pénitencier américain, mais aussi dans le but de comprendre les institutions démocratiques et le système fédéral de la nouvelle république. Il publie en 1835 De la démocratie en Amérique en deux tomes. Le premier connut un énorme succès d’édition; il s’agit d’une description minutieuse de la société américaine de l’époque et de ses institutions. Le second livre est différent, plus un ouvrage de sociologie et de philosophie politique qui prend prétexte des États-Unis pour analyser aussi les sociétés européennes en mutation. Tocqueville y énonce deux idées maîtresses sur le progrès de l’égalité et sur l’avènement de la centralisation dans les sociétés démocratiques. Il a été élu membre de l’Académie des sciences morales et politiques (1838) et député de Valognes (Normandie) en 1839, puis brièvement ministre des affaires étrangères du gouvernement français en 1849. Il se retire alors de la vie politique et publie par la suite L’Ancien régime et la révolution en 1856. Il meurt à 54 ans à Cannes.
Tocqueville est un aristocrate de cœur mais un démocrate de raison. Il prend tôt conscience que l’ordre social ancien est révolu et que la démocratie est l’avenir des sociétés, mais surtout que l’égalité entre les individus est la grande tendance qui va s’imposer, démocratie et égalité étant liées, ce qui n’était pas évident dans la France de son époque. « Parmi les objets nouveaux qui, pendant mon séjour aux États-Unis, ont attiré mon attention, aucun n’a plus vivement frappé mes regards que l’égalité des conditions » (De la démocratie en Amérique, p. 4).
Malgré le succès indéniable qu’a connu son ouvrage lors de sa publication et malgré le fait que Tocqueville ait été élu très jeune à l’Académie des sciences morales et politiques, il a été ignoré comme penseur important en France pendant un très long purgatoire, même s’il n’a jamais été oublié des historiens officiels (Mélonio, 1993, p. 247). Nos cousins français l’ont redécouvert dans les années 1960, notamment à la suite de la publication du cours de Raymond Aron sur les étapes de la pensée sociologique (1967) dans lequel il faisait de Tocqueville l’un des auteurs classiques de la sociologie. Le même Raymond Aron a par la suite signé un article classique dans le premier numéro de la Revue Tocqueville/The Tocqueville Review – « Tocqueville retrouvé » (1979) – qui a aussi contribué au regain d’intérêt pour la pensée de Tocqueville [1]. Malgré cela, il a fallu attendre les années 1980 (et même 1990) avant que la pensée de Tocqueville ne jouisse d’une pleine reconnaissance dans l’Hexagone et n’apparaisse au programme des concours scolaires et ne figure dans les manuels. Henri Mendras a joué un rôle important dans cette reconnaissance et Raymond Boudon dans son Tocqueville aujourd’hui (2005) vient pour sa part d’élever Tocqueville au rang des pères de la sociologie en explicitant le paradigme tocquevillien et la logique de sa pensée.
Le purgatoire de Tocqueville a été bien moins long aux États-Unis, où il est reconnu – et lu – comme un grand classique, « le Montesquieu des Américains » (Mélonio). Olivier Zunz (2005) avance qu’après une éclipse de quelques dizaines d’années, son livre De la démocratie en Amérique a été considéré dès le début du XXe siècle comme un ouvrage de fond, un ouvrage de première main pour comprendre l’origine et la spécificité de la démocratie et du fédéralisme américain. Si certaines observations sur la société américaine sont maintenant considérées comme approximatives ou datées, ses analyses et ses intuitions sont par contre restées d’une étonnante fraîcheur. Dans son réexamen du diagnostic posé par Tocqueville sur la société américaine, James T. Scheifler (1986) montre que sa lecture tenait toujours la route sur un très grand nombre d’aspects. Relire Tocqueville sur l’Amérique, relire Tocqueville sur la démocratie est encore d’une grande pertinence et les élites américaines, tant d’orientations libérale que conservatrice, n’hésitent pas à le citer régulièrement.
Le bicentenaire de la naissance de Tocqueville est passé inaperçu au Québec et au Canada – mais il n’est pas trop tard pour le souligner ! Cet oubli est regrettable, parce que Tocqueville a visité le Bas-Canada (le territoire actuel du Québec) lors de son périple nord-américain et parce qu’il a écrit de nombreuses pages, fascinantes à lire, sur les Canadiens et la vie de l’époque. Père d’une « sociologie politique nouvelle », il était aussi un sociographe attentionné et un homme de terrain dont les observations sont restées précieuses pour comprendre son époque, notamment parce qu’il a adopté une perspective comparativiste.
La plupart des textes de Tocqueville relatifs au Bas-Canada – lettres à ses proches et carnets d’observation – ont été écrits à chaud lors même du voyage en Amérique, alors que les Démocratie I et II, s’appuyant sur des sources détaillées, ont été rédigées avec un certain recul et corrigées après diverses consultations. Les ouvrages majeurs de Tocqueville contiennent ici ou là quelques références à la situation du Canada dont il se sert pour illustrer un aspect de sa pensée, mais aucun ne propose une analyse complète de l’ex-colonie française. Les écrits épars de Tocqueville sur le Bas-Canada ont été rassemblés en livre d’abord par Jacques Vallée en 1973. Trente ans plus tard, Claude Corbo (2003) a publié un ouvrage plus complet – Regards sur le Bas-Canada – en exploitant les œuvres complètes et la correspondance de Tocqueville devenue entre temps accessible au grand public grâce aux efforts de Françoise Mélonio et de Laurence Guellec.
L’analyse de la question canadienne occupe une place mineure dans l’œuvre de Tocqueville. Mais Claude Corbo souligne avec justesse qu’on retrouve dans ses écrits épars et dans sa correspondance les grands thèmes tocquevilliens que sont la démocratie, la nation, l’égalité, la liberté, les classes sociales, précisant que ces lettres et carnets de notes sur le Canada sont instructifs sur la genèse de la pensée de Tocqueville. J’ajouterai que les écrits de Tocqueville ont aussi valeur de documents de première main sur la société canadienne de l’époque, plus précisément sur le Bas-Canada. Tocqueville aime questionner les gens ordinaires ; il interroge les élites sur la marche des institutions et sur les enjeux sociaux ; il observe tout ce qui l’entoure, il analyse ce qu’il voit, il décrit les lieux qu’il fréquente et les paysages sauvages qu’il a devant les yeux, parfois à la manière de son cousin Chateaubriand. Je pense à son texte « Quinze jours dans le désert » écrit sur la région des Grands Lacs encore à l’état sauvage, à sa description des chutes du Niagara ou du fleuve Saint-Laurent qu’il remonte en bateau depuis Kingston.
Relisons ce compte rendu de son séjour à la pointe du Lac Huron, qui caractérise bien Tocqueville l’homme de terrain. « Nous prenons un guide canadien et nous allons visiter la roche percée. Pittoresque. B[eaumont] va dessiner la roche perçée. Moi, je vais rôder suivant mon usage. Je veux voir le curé, mais il n’y est pas. (…) Un camp de Canadiens sur le rivage. Un bivouac autour du feu. Un Canadien à l’air et aux manières françaises. Gai, ouvert, énergique. Des bois-brûlés. Je m’assois à leur feu et cause avec eux » (RBC, p. 134 [2]).
Dans son œuvre, Tocqueville se préoccupe de trouver la vérité, de fonder une connaissance empirique des sociétés à partir de faits. Visitant le Canada, il prend des notes dans ses carnets et Beaumont, son ami et compagnon de voyage en Amérique, fait des croquis de ce qu’ils voient tous les deux – depuis les oiseaux jusqu’aux Amérindiens en habits, sans oublier les paysages naturels et urbains comme la chute Montmorency à Québec avec sur son flanc gauche une belle maison de bois au toit rouge, bien connue des Québécois ! – dessins qui se trouvent aujourd’hui dans les collections de la Beneke Library de l’Université Yale. Tocqueville se questionne aussi sur les sociétés à partir de ses préoccupations d’homme d’action et de philosophe intéressé par la recherche de solutions aux problèmes contemporains. C’est ce qui donne de la pertinence à ses écrits sur le Bas-Canada, comme à ses autres analyses qui nous parlent encore de nos jours.
Le voyage au Canada de Tocqueville est une parenthèse qui n’avait pas vraiment été planifiée longtemps à l’avance, du moins, c’est l’interprétation qu’en donne Jean-Louis Benoît. « Dans le projet initial de leur voyage, Tocqueville et Beaumont n’avaient pas prévu visiter le Canada, l’idée leur en est venue à la suite d’une conversation avec John Powers » (Benoît, 2005, p. 89), ce qui est attesté par l’examen des lettres rassemblées par Corbo. « Lors de ma précédente lettre, je ne croyais pas faire ce voyage » écrit-il d’Albany sur la voie de son retour aux États-Unis (RBC, p. 194).
Dès son arrivée en Amérique, Tocqueville a visité les villes de l’époque, interrogé les notables et des gens ordinaires et il a recueilli des données sur le système carcéral américain, le but officiel de son séjour. Mais il désirait aussi voir la nature sauvage et en particulier les Indiens, de plus en plus refoulés vers l’Ouest. Le 1er août 1831, il s’embarque sur le Steamboat The Superior qui le mènera dans les Grands Lacs, à Sault-Sainte-Marie, puis vers le Saint-Laurent, Kingston et Montréal, où il entamera son bref mais intense séjour canadien. Au début de ce périple, il écrit un long récit de voyage – « Quinze jours dans le désert » – dans lequel il relate sa rencontre avec les Indiens, mais aussi avec les métis bois-brûlés et les Canadiens (français), un texte qui comprend de belles pages sur la nature sauvage qu’il rêvait de découvrir. Le désert en question n’est pas l’espace sablonneux qui vient spontanément à l’esprit, mais plutôt un vaste espace vierge d’occupation « civilisée ». « Une des choses qui piquaient le plus vivement notre curiosité en venant en Amérique, c’était de parcourir les extrêmes limites de la civilisation européenne et même, si le temps nous le permettait, de visiter quelques unes de ces tribus indiennes qui ont mieux aimé fuir dans les solitudes les plus sauvages que de se plier à ce que les Blancs appellent les délices de la vie sociale » écrit-il au début de ce récit (RBC, p. 55).
Tocqueville a rencontré dans les Grands Lacs un Canadien qui fit sur lui grand effet. « L’homme qui était accroupi au fond de cette fragile embarcation portait le costume et avait toute l’apparence d’un Indien. (…) Comme je me préparais moi-même à y monter, le prétendu Indien s’avança vers moi, me plaça deux doigts sur l’épaule et me dit avec un accent normand qui me fit tressaillir : ‘N’allez pas trop vite, y en des fois qui s’y noient’. Mon cheval m’aurait adressé la parole que je n’aurais pas, je crois, été plus surpris. J’envisageai celui qui m’avait parlé et dont la figure frappée des premiers rayons de la lune reluisait alors comme une boule de cuivre : ‘Qui êtes-vous donc, lui dis-je, le français semble être votre langue et vous avez l’air d’un Indien ?’ Il me répondit qu’il était un bois-brûlé, c’est-à-dire le fils d’un Canadien et d’une Indienne. (…) Suivant les conseils de notre compatriote le sauvage, je m’assis au fond du canot et me tins aussi en équilibre qu’il m’était possible. Le cheval entra dans la rivière et se mit à la nage tandis que le Canadien poussait la nacelle de l’aviron, tout en chantant à demi-voix sur un vieil air français le couplet suivant dont je ne saisis que les deux premiers vers : ‘Entre Paris et Saint-Denis, il était une fille …’ » (RBC, p. 107).
Tocqueville n’est resté que quatorze jours au Canada, débarquant à Montréal le 23 août 1831, allant ensuite deux jours plus tard à Québec qu’il visite avec John Neilson et poussant l’exploration jusqu’à Montmagny, sur la rive-sud du St-Laurent, seul avec Gustave de Beaumont son compagnon de voyage, qui seront tous deux étonnés d’y découvrir en route un village portant le nom de ce dernier.
Dans sa correspondance, Tocqueville raconte avec beaucoup d’émotion sa découverte des Canadiens, un peuple de 600,000 habitants qui a survécu à la cession par la France de sa colonie canadienne à l’Angleterre par le « honteux traité de 1763, l’une des plus grandes ignominies de l’ignominieux règne de Louis XV » (Tocqueville, dans Vallée, p. 114). Tocqueville précise dans une autre lettre : « Il n’y a pas six mois, je croyais comme tout le monde, que le Canada était devenu complètement anglais » (dans Vallée, p. 107).
Dans ses écrits sur le Canada, il n’est donc pas surprenant de voir que l’aristocrate de cœur cohabite avec le démocrate de tête, pour reprendre une distinction rappelée par les biographes de Tocqueville, ce dont il était lui-même fort conscient. « J’ai pour les institutions démocratiques un goût de tête, mais je suis aristocratique par l’instinct ». Précisons cependant que le genre des écrits tocquevilliens sur le Canada – en majorité des lettres et des carnets de notes de terrain – se prête plus spontanément à l’expression de sentiments.
Tocqueville évoque avec émotion « la découverte d’une vieille France » en terre d’Amérique et le français parlé avec l’accent de Normandie dans les campagnes, comme en témoigne une de ses lettres à sa belle-sœur Émilie (7 septembre 1831) : « Nous sommes revenus par le Canada. Si jamais vous allez en Amérique, chère sœur, c’est là qu’il faut venir vous établir. Vous retrouverez vos chers Bas-Normands trait pour trait. M. Gisles, Mme Noël, j’ai vu tous ces gens là dans les rues de Québec (…) » (RBC, p. 198) [3]. Dans une autre lettre, il précise : « Singulier effet que cause sur nous cette langue française entendue à la fin du monde et avec ses vieilles tournures et son accent provincial » (RBC, p. 132).
Mais Tocqueville est troublé par la domination de la langue anglaise dans l’espace public et par l’envahissement de l’anglais dans la langue parlée par l’élite et les commerçants qu’il a rencontrés. La conclusion de sa description d’une session du tribunal de Québec évoque bien l’homme de sentiment qu’il était : « Je n’ai jamais été plus convaincu qu’en sortant de là que le plus grand et le plus irrémédiable malheur pour un peuple c’est d’être conquis » (RBC, 2003 : 165), écrit-il dans ce texte connu et souvent cité. Sachant que « la liberté est la première de [ses] passions », on peut facilement imaginer qu’il ait évoqué cette situation « avec tristesse ».
« Il est facile de voir que les Français sont le peuple vaincu ». « La population du Canada ne compte qu’un million d’habitants ; sa population est divisée en deux nations ennemies » ajoute-t-il dans la première Démocratie (p. 175). Mais Tocqueville doute qu’il puisse « exister une union indissoluble » entre les deux peuples anglais et français. « J’espère encore que les Français, en dépit de la conquête, arriveront un jour à former à eux seuls un bel empire dans le Nouveau Monde, plus éclairés peut-être, plus moraux et plus heureux que leurs pères. Pour le moment actuel, cette division entre les races est singulièrement favorable à la domination de l’Angleterre » (RBC, 2003, p. 157).
Ce que Tocqueville a vu au Bas-Canada

Dans son livre De la Démocratie en Amérique, Tocqueville s’attarde à scruter trois dimensions de la société qui lui paraissent en interaction. C’est là sa méthode d’analyse sociologique. Dès les premières pages de l’ouvrage, il annonce en effet l’examen successif 1) du « contexte et des circonstances », 2) des lois et institutions et, finalement 3) de la culture (les mœurs). Rappelons qu’il classe dans « les mœurs » les idées, les représentations, les « sentiments », les comportements. Son analyse de ce dernier aspect s’appuie sur sa lecture des journaux, sur les entrevues qu’il a faites sur le terrain avec les élites et des citoyens ordinaires et sur son examen des travaux publiés sur les États-Unis lus pendant son séjour américain et après son retour en France. Nous nous inspirerons de sa démarche dans les lignes qui suivent pour exposer sa vision du Bas-Canada.
Que pense Tocqueville du Canada ? Jacques Vallée, Jean-Michel Leclercq, Gérard Bergeron, Stéphane Dion et Claude Corbo notamment ont présenté plusieurs éléments de sa pensée. Je rappellerai pour ma part les principaux éléments de la sociographie tocquevillienne du Canada français en reprenant la perspective qui était la sienne dans De la Démocratie, donc en les groupant selon les trois dimensions qu’il avait distinguées : le contexte, les institutions et la culture.
Tocqueville insiste d’abord sur le poids des nombres. Frappé par la forte croissance de la population américaine, il évoque le doublement de cette dernière « à tous les vingt deux ans » et il entrevoit une Amérique comptant plus de cent millions d’habitants à la fin du XIXe siècle, une estimation qui s’est avérée n’être pas très loin de la réalité. Le poids du nombre explique aussi l’avancée des colons américains vers l’Ouest et il décrit l’encerclement des Indiens et comment ces derniers sont repoussés de plus en plus loin.
Le nombre, qui fait la force des Américains, est la faiblesse des Canadiens. « Ce ne sera jamais un peuple nombreux » écrit-il, mais il entrevoit l’avenir avec un certain optimisme. Il faut rappeler qu’il y avait plus d’Allemands d’origine en Pensylvannie que de Canadiens dans la vallée du St-Laurent au moment de la conquête anglaise (60,000 h. au total), un fait que Tocqueville souligne lui-même.
Les Américains sont mobiles sur le territoire. « Des millions d’hommes marchent à la fois vers le même point de l’horizon : leur langue leur religion, leurs mœurs diffèrent, leur but est commun » (Démocratie I : 267) [4]. Tocqueville souligne que les Canadiens qu’il a rencontrés dans le Bas-Canada restaient attachés à leurs terres et ne voulaient pas « aller vers l’Ouest ». Cette observation – on le sait – ne sera plus valable quelques années à peine après le départ de Tocqueville.
La sédentarité des Canadiens notée par Tocqueville était sans doute récente, et elle marquait un changement majeur dans l’histoire car les Canadiens (français) avaient toujours circulé sur de très longues distances et largement exploré le territoire nord-américain, laissant ici et là une descendance, souventes fois métissée avec les premiers occupants. Tocqueville en avait déjà remarqué la présence dans les régions du centre du continent lorsqu’il s’était aventuré en dehors des sentiers battus ; ce sont souvent des Canadiens français ou encore des métis bois-brûlés en effet qui lui ont servi de guide.
La rencontre de ces Canadiens a été pour Tocqueville l’occasion de juger sévèrement l’incapacité de son pays à coloniser et à conserver l’empire de la Nouvelle-France, à cause d’une centralisation excessive. « Au Canada, (…) un intendant (a) une position bien autrement prépondérante que celle qu’avaient ses pareils en France ; une administration se mêlant encore de bien plus de choses que dans la métropole, et voulant de même faire tout de Paris, malgré les dix-huit cents lieues qui l’en séparent, (…) cela se passe sous Louis XIV ; ces édits sont contresignés Colbert » (RBC, p. 268). Les colonies britanniques, au contraire, sont décentralisées et jouissent d’une plus grande liberté intérieure. Et il ajoute : « C’est dans les colonies qu’on peut mieux juger la physionomie du gouvernement de la métropole, parce que c’est là que d’ordinaire tous les traits qui la caractérisent grossissent et deviennent plus visibles » (idem). Leclercq avance que les observations de Tocqueville au Bas-Canada et aux États-Unis ont marqué sa pensée sur l’Ancien Régime et sur les politiques coloniales de la métropole. Pour lui, la Nouvelle-France périt parce qu’elle n’avait pas un gouvernement adéquat. « Tocqueville pense, au contraire, que la colonie aux prises avec des difficultés spécifiques doit développer un type de gouvernement propre (…) » (Leclercq, 1965, p. 33). Pour Leclercq, Tocqueville a bien vu que la centralisation des pouvoirs entre les mains de l’intendant pouvait être bénéfique si ce dernier était bien choisi et dynamique (Jean Talon) et si la métropole lui accordait des moyens, alors que le désintérêt de cette dernière et l’absence d’institutions locales fortes pouvaient lui être néfastes. Leclercq ajoute : « quand l’intérêt diminua sous Louis XV l’on y vit des intendants comme Bigot qui pervertirent l’institution et compromirent l’œuvre entreprise » (ibidem, p. 35).
L’ère des grandes explorations ou de l’occupation du territoire loin de la vallée du Saint-Laurent par les Canadiens est révolue. Tocqueville s’inquiète même de l’absence de mobilité et il prévoit les difficultés que les Canadiens auront un jour devant les limites physiques de l’espace cultivable sur leur territoire de l’époque. Sur ce point, il a raison. Entre les années 1880 et 1930, plus de huit cent mille Canadiens français vont prendre le chemin des États de la Nouvelle-Angleterre où ils formeront des petits Canadas. Ils vont y fonder des centaines de paroisses et y reproduire leur culture, du moins pendant un certain temps, certaines élites formulant même l’utopie de pouvoir continuer à vivre aux États-Unis comme des Canadiens français. D’autres prendront le chemin de l’Ontario et de l’Ouest canadien. Ils joindront leurs voix à celles de leurs compatriotes restés au Québec afin de redéfinir le Canada comme un État fédéral bi-national imaginé par Henri Bourassa, le père de la thèse des deux peuples fondateurs.
Tocqueville avance l’hypothèse que la mobilité géographique se fait en deux temps sur le territoire. Les nouveaux immigrants s’installent dans les villes et dans des lieux bien établis, souvent là où se trouvent déjà des compatriotes, comme ce fût le cas pour les migrants canadiens-français qui se sont établis en paroisses en Nouvelle-Angleterre, en Ontario et dans l’Ouest canadien. Ce sont les générations suivantes qui migrent plus loin et en dehors de leurs communautés, ou encore dont les enfants se marient avec des individus appartenant à d’autres cultures, avance-t-il. Ainsi, il observe que ce sont les Américains de vieil établissement qui migrent vers l’Ouest alors que les immigrants européens s’installent dans les villes de l’est. Tocqueville a sur les migrations une intuition qui a par la suite été formalisée dans les travaux de spécialistes du phénomène.
La masse des immigrants est démunie sur le plan économique. « Ce ne sont pas les riches qui immigrent », observe Tocqueville, qui ajoute une remarque pertinente : « les immigrants vivent une situation analogue », ce qui donne une certaine unité objective à leur situation. Si divers soient-ils par leurs caractéristiques propres, ils ont en effet une chose en commun : ils viennent d’ailleurs et la majorité d’entre eux repart à zéro avec peu de moyens propres. Les immigrants sont diversifiés par leurs origines nationales diverses, certes, mais ils sont par contre dans une situation structurelle identique – une « situation analogue » dont Tocqueville a noté toute l’importance. Certains analystes s’inquiètent des effets déstructurants que pourrait avoir une immigration trop importante dans un milieu donné. La situation analogue qu’ils vivent est au contraire le facteur qui les unit les uns aux autres, une idée qui se retrouvera plus tard au cœur de la philosophie du multiculturalisme à la canadienne.
Tocqueville note la prospérité des campagnes et le bien-être des paysans sur leurs fermes, un aspect qu’il aurait cependant sur estimé, car il n’a visité que la partie la plus prospère de l’espace canadien-français de l’époque. « Québec est dans une position très pittoresque, entouré de campagnes riches et fertiles. (…) Les villages que nous avons vus aux environs ressemblent extraordinairement à nos plus beaux villages. On n’y parle que le français. La population y paraît heureuse et aisée » (RBC, p. 161). Il décrit tout aussi favorablement la campagne qu’il a vue en allant vers le village de Saint-Thomas, aujourd’hui Montmagny. « Toutes les campagnes que nous avons parcourues sont admirables de fertilité ; jointes au Saint-Laurent et aux montagnes du Nord, elles forment le plus complet et le plus magnifique tableau. Les maisons sont universellement bien bâties. Elles respirent toutes un air d’aisance et de propreté. Les églises sont riches, mais riches de bon goût. Leur décoration intérieure ne serait pas déplacée dans nos villes » (RBC, p. 185).
Analysant la structure sociale, Tocqueville décrit les Canadiens comme étant dominés par les Anglais sur le plan économique, un aspect sur lequel il revient souvent. « Toute la population ouvrière de Québec est française, On n’entend parler que du français dans les rues. Cependant toutes les enseignes sont anglaises » (RBC, p. 161). Même remarque à Saint-Thomas (Montmagny) : « Dans cette portion du Canada on n’entend point l’anglais. La population n’est que française, et cependant lorsqu’on rencontre une auberge, ou un marchand, son enseigne est en anglais » (idem, p. 185).
Tocqueville livre une analyse fine de la classe des marchands et des professionnels canadiens qui sont alliés à leurs homologues anglais et écossais, qui partagent des intérêts communs et s’opposent aux politiques coloniales de la nouvelle mère-patrie (l’Angleterre). Tocqueville a très bien vu l’existence de cette alliance. « Il existe à Québec une classe d’hommes qui forme la transition entre le Français et l’Anglais : ce sont des Anglais alliés à des Canadiens, des Anglais mécontents de l’administration, des Français en place. Cette classe est représentée dans la presse périodique par la Gazette de Québec, mélange de français et d’anglais, dans les assemblées politique par M. Neilson et probablement plusieurs autres que nous ne connaissons pas » (183).
La classe des marchands et des professionnels rêve d’une république canadienne, mais Tocqueville note avec une grande lucidité que cette alliance entre les Anglais et les Canadiens au sein de cette classe risque d’être néfaste à la survie du fait français. « C’est elle [la classe] que je crains le plus pour le sort futur de la population canadienne. Elle n’excite ni sa jalousie ni ses passions. Au contraire, elle est plus canadienne qu’anglaise d’intérêt parce qu’elle fait de l’opposition au gouvernement. Au fond, cependant, elle est anglaise de mœurs, d’idées, de langue. Si elle prenait jamais la place des hautes classes et des classes éclairées parmi les Canadiens, la nationalité de ceux-ci serait perdue sans retour. Ils végéteraient comme les Bas-Bretons en France » (RBC, p. 183). « Mais si dans cet effort les classes intermédiaires et supérieures de la population canadienne abandonnent les basses classes et se laissent entraîner dans le mouvement anglais, la race française est perdue en Amérique » (RBC, p. 182).
Tocqueville souligne le rôle important du clergé dans l’encadrement institutionnel des Canadiens (français). Tocqueville décrit les ecclésiastiques comme « les gens les plus distingués du pays. Ils ressemblent beaucoup à nos vieux curés français » (RBC, p. 196). Il voit bien comment la structure de la paroisse est le pivot de la survivance en dehors des villes où se concentre la population de langue anglaise et il accorde un rôle clé au curé, donc au clercs proches de la population. « Le curé est bien véritablement ici le pasteur du troupeau ; ce n’est point un entrepreneur d’industrie religieuse comme la plupart des ministres américains » (RBC, p. 162). Tocqueville transcrit le contenu d’une entrevue avec M. Mondelet de Montréal. « En général, notre clergé est éminemment national. Ceci est en partie un résultat des circonstances dans lesquelles il s’est trouvé placé. Dans les premiers temps de la conquête et jusqu’à nos jours, le gouvernement anglais a sourdement travaillé à changer les opinions religieuses des Canadiens afin d’en faire un corps plus homogène avec les Anglais. Les intérêts de la religion se sont donc trouvés opposés à ceux du gouvernement et d’accord avec ceux du peuple. Toutes les fois qu’il s’est agi de lutter contre les Anglais, le clergé a donc été à notre tête ou dans nos rangs », rapporte-t-il à Tocqueville (RBC, p. 154). Et l’avocat interrogé observe candidement que les prêtres français fraîchement débarqués se montrent plus dociles envers le pouvoir anglais que le clergé local (le clergé national). « Ce qui me fait croire que le caractère politique de nos prêtres est spécial au Canada, c’est que les prêtres qui nous arrivent de temps en temps de France montrent au contraire pour le pouvoir une condescendance et un esprit de docilité que nous ne pouvons concevoir » (idem).
Tocqueville précise dans une autre lettre : « (Le curé) est l’oracle du lieu, l’ami, le conseil de la population. Loin d’être accusé ici d’être le partisan du pouvoir, les Anglais le traitent de démagogue. Le fait est qu’il est le premier à résister à l’oppression, et le peuple voit en lui son plus constant appui. Aussi les Canadiens sont-ils religieux par principe et par passion politique. Le clergé forme là la haute classe, non parce que les lois, mais parce que l’opinion et les mœurs le placent à la tête de la société » (RBC, pp. 195-196).
Pour Tocqueville, le clergé joue un rôle actif dans la défense du fait français. « Heureusement la religion met un obstacle aux mariages entre les deux races, et crée dans le clergé une classe éclairée qui a intérêt à parler français et à se nourrir de la littérature et des idées françaises » (p. 183). Il précise dans son carnet : « Si la religion perd jamais son empire au Canada, c’est par cette brèche-là que l’ennemi entrera » (idem p. 184). Dans son entretien avec Tocqueville, le député John Neilson lui souligne le rôle du clergé dans la préservation de la langue, une observation que prend soin de noter le voyageur. « Ce qui maintient surtout votre langue ici, c’est le clergé. Le clergé est la seule classe éclairée et intellectuelle qui ait besoin de parler français et qui le parle avec pureté » (rbc, p. 170).
Tocqueville voit bien que le clergé est actif dans la construction du Canada français par opposition au Canada nouveau de la classe des marchands en train d’émerger comme nouvelle référence nationale. Plusieurs historiens et sociologues québécois avancent en effet que le Canada français est un type de société qui a duré cent cinquante ans environ, prenant fin dans les années 1960, avec la Révolution tranquille au Québec et la tenue des derniers États généraux du Canada français qui marquent la rupture officielle entre les Canadiens français du Québec – devenus entre temps Québécois – et les minorités francophones canadiennes (l’Acadie étant depuis toujours une référence nationale distincte) [5].
Tocqueville observe que le niveau d’éducation de la population canadienne est plus faible que celui qu’il a observé aux États-Unis. « Au total, cette race d’hommes nous a paru inférieure aux Américains en lumières, mais supérieure quant aux qualités du cœur. (…) La raison des Canadiens est peu cultivée, mais elle est simple et droite ; ils ont incontestablement moins d’idées que leurs voisins, mais leur sensibilité paraît plus développée » (idem p. 180). Tocqueville ajoute cependant que système d’éducation se met en place, après une phase fort critique de sous développement chronique pendant soixante-dix ans. « Mais depuis quelques années, la Chambre des Communes, presque toute canadienne, a pris des mesures pour répandre à profusion l’instruction. Tout annonce que la nouvelle génération sera différente de la génération actuelle (…) » (rbc, p. 157). « Plusieurs nous ont paru parfaitement comprendre les besoins de l’instruction et se réjouir vivement de ce qu’on venait de faire en sa faveur» (p. 182).
Tocqueville faisait preuve d’un réalisme modérément optimiste dans sa lecture du contexte et des institutions. Mais il propose par contre une analyse beaucoup plus inquiétante sur la culture. Il se désole de l’absence d’élite cultivée canadienne et s’inquiète des menaces qui pèsent sur la langue française. Tocqueville insiste sur le fait que la culture des Canadiens français est en quelque sorte restée figée dans le passé qui lui rappelle la « vieille France ». Sa description du village de Sault-Sainte-Marie en témoigne. « Toute la population de Sainte-Marie est française. Ce sont de vieux Français gais et en train comme leurs pères et comme nous ne le sommes pas. Tout en conduisant nos canots, ils nous chantaient de vieux airs qui sont presque oubliés chez nous. Nous avons retrouvé ici le Français d’il y a un siècle, conservé comme une momie pour l’instruction de la génération actuelle » (rbc, p. 143). Commentant dans ses lettres sa rencontre des premiers Canadiens dans les Grands Lacs, Tocqueville revient souvent sur le français parlé qui lui rappelle son propre coin de pays. Le voyageur décrit les « qualités » du peuple, mais il se désole de n’avoir pas rencontré d’élite capable d’interpréter sa situation, contrairement à ce qu’il a vu aux États-Unis. « Je n’ai encore vu dans le Canada aucun homme de talent, ni lu une production qui en fît preuve » écrit-il (rbc, p. 163).
Rappelons la visite qu’il fait dans un « cabinet de lecture ».
« J’ai été aujourd’hui dans un cabinet de lecture. Presque tous les journaux imprimés au Canada sont en anglais. (…) Il paraît à Québec un journal appelé la Gazette, semi-anglais et semi-français ; et un journal absolument français appelé Le Canadien. (…) J’ai lu avec soin plusieurs numéros : ils font une opposition violente au gouvernement et même à tout ce qui est anglais. Le Canadien a pour épigraphe : notre Religion, notre langue, nos lois. Il est difficile d’être plus franc. Le contenu répond au titre. Tout ce qui peut enflammer les grandes et les petites passions populaires contre les Anglais est relevé avec soin dans ce journal. J’ai vu un article dans lequel on disait que le Canada ne serait jamais heureux jusqu’à ce qu’il eût une administration canadienne de naissance, de principes, d’idées, de préjugés même, et que si le Canada échappait à l’Angleterre, ce ne serait pas pour devenir anglais. Dans ce même journal se retrouvaient des pièces de vers français assez jolis. (…) En général le style de ce journal est assez commun, mêlé d’anglicismes et de tournures étranges. Il ressemble beaucoup aux journaux publiés dans le canton de Vaud en Suisse ». (rbc, pp. 162-163).
Nation et démocratie

Mais Tocqueville n’est pas seulement sociographe, historien et philosophe politique. Il est aussi un sociologue au sens fort du terme, le père d’une « nouvelle sociologie politique » comme le montre de manière magistrale Raymond Boudon (2005) dans son Tocqueville aujourd’hui. « Il faut une science politique nouvelle à un monde tout nouveau » écrit Tocqueville au début de la première Démocratie. Pour y arriver, selon Boudon, Tocqueville scrute les raisons qu’ont les acteurs sociaux d’agir comme ils le font et il avance que les processus sociaux sont le produit de l’action des hommes. Mais les hommes dont parle Tocqueville ne sont pas détachés du contexte social dans lequel ils vivent et ils doivent composer avec le hasard autant qu’avec la nécessité, précise Boudon. La description sociographique de l’Amérique sous trois angles – le contexte, les institutions et la culture – est intéressante en soi, notamment dans le cas du Bas-Canada, comme on vient de le voir, et à elle seule elle aurait suffit à faire de la Démocratie un grand livre. Raymond Boudon soutient que l’ouvrage a une portée encore plus grande parce qu’il livre aussi une explication des choses. « Le contexte détermine l’existence d’occasions, mais non le comportement même des individus, lequel est l’effet de motivations et de raisons » (Boudon, 2005 : 213). Citons encore Boudon : « Tocqueville a compris qu’une sociologie scientifique suppose que l’on explique les phénomènes sociaux à partir des actions et des croyances des hommes et qu’il est essentiel de retrouver les raisons et motivations compréhensibles qui les inspirent » (idem, p. 255).
Cette sociologie nouvelle se retrouve aussi dans les écrits de Tocqueville sur le Bas-Canada, lorsqu’il réfléchit sur le sentiment national et sur le lien entre nation et démocratie, deux aspects sur lesquels nous aimerions maintenant insister.
« Le contenu répond au titre » écrit Tocqueville à propos du journal le Canadien dans l’extrait cité plus haut. Cette expression donne à penser que ce dernier a bien vu, non seulement qu’il existait un fort sentiment d’appartenance et d’identification nationale chez les Canadiens, mais aussi comment le sentiment national se construisait à travers des discours, pour parler le jargon de notre époque. Tocqueville retrouve aussi cette opposition dans la langue courante en rappelant une autre donnée d’observation : « Les Anglais et les Français se fondent si peu que les seconds gardent exclusivement le nom de Canadiens, les autres continuant à s’appeler Anglais » (RBC, 2003, p. 163).
Tocqueville montre comment les acteurs sociaux construisent des représentations sociales partagées pour agir de concert avec d’autres dans le monde, comment ils élaborent des idéologies communes, des savoirs partagés, des utopies mobilisatrices comme celles des premiers arrivants d’Angleterre débarqués à Plymouth. Autrement dit, pour agir, les acteurs sociaux se donnent une interprétation commune du monde basée sur une rationalité élargie, c’est-à-dire sur des intérêts, mais aussi des idées et des sentiments, comme le montre ce passage. « Tous les peuples qu’on a vus se confédérer avaient un certain nombre d’intérêts communs, qui formaient comme les liens intellectuels de l’association. Mais outre les intérêts matériels, l’homme a encore des idées et des sentiments » (Démocratie I : 173).
« Liens intellectuels », « idées » et « sentiments » : nous voilà dans l’ordre des représentations sociales et de l’interprétation du monde nécessaire pour la vie en société. Revenons encore une fois à la Démocratie. « Ce qui maintient un grand nombre de citoyens sous le même gouvernement, c’est bien moins la volonté raisonnée de demeurer unis que l’accord instinctif et en quelque sorte involontaire qui résulte de la similitude des sentiments et de la ressemblance des opinions. Je ne conviendrai jamais que des hommes forment une société par cela seul qu’ils reconnaissent le même chef et obéissent aux mêmes lois ; il n’y a société que quand des hommes considèrent un grand nombre d’objets sous un même aspect ; lorsque sur un grand nombre de sujets, ils ont les mêmes opinions ; quand enfin les mêmes faits font naître en eux les mêmes impressions et les mêmes pensées » (Démocratie I : 344). Il ajoute plus loin : « Les Anglo-Américains sont ainsi unis entre eux par des idées communes » (Démocratie I : 345).
Il serait possible de multiplier les citations pour montrer le rôle que jouent les représentations sociales au sens large dans la pensée de Tocqueville. Ce dernier accorde une grande place à la presse dans la fabrication de ces représentations partagées. « La liberté de la presse ne fait pas seulement sentir son pouvoir sur les opinions politiques, mais encore sur toutes les opinions des hommes. Elle ne modifie pas seulement les lois, mais les mœurs. (…) Je tâcherai de discerner la direction qu’elle a donnée aux idées, les habitudes qu’elle a fait prendre à l’esprit et aux sentiments » (Démocratie I, p. 183).
Dans cette perspective, la nation apparaît comme une référence construite ou représentée, comme une expérience historique interprétée. Lorsque Lord Durham, cet autre célèbre voyageur qui visite le Canada dix ans seulement après Tocqueville, écrit qu’il y a trouvé dans le Bas-Canada « un peuple sans histoire et sans littérature », il illustre bien l’importance de la représentation de soi dans la vie collective et la nécessité de l’interprétation qui fonde la vie collective et le vouloir vivre ensemble dont parle Renan. Sans histoire écrite, un peuple risque de ne plus exister. On sait que François-Xavier Garneau sera piqué au vif par cette remarque et qu’il s’engagera dans le projet de donner aux Canadiens français une histoire nationale qui servira de référence pour l’action collective.
Le sociologue Fernand Dumont (1974) a donné forme dans son œuvre à cette perspective en définissant la nation comme une expérience historique interprétée plutôt que comme une donnée objective, comme une référence pour reprendre ses mots.
« La nation, c’est la conception que ses membres s’en font… Est-ce là céder à je ne sais quel idéalisme de la représentation ? Non, à la condition que ce postulat une fois admis, on examine concrètement, et pour chaque cas, comment ces représentations sont la résultante d’une construction au sein d’une histoire, comment elles permettent un agir collectif : comment en d’autres termes, elles se sont constituées comme pratiques et comment elles fonctionnent de la même façon » (Dumont, 1974 : 94-95).
Dumont montre clairement que ce qu’on pourrait appeler les facteurs objectifs, les structures, ou encore ce que Tocqueville nomme le contexte et les circonstances ne suffisent pas à orienter l’action collective. Il faut aussi le travail d’une représentation qui va lui donner cohérence, une direction, qui va fonder une pratique pour reprendre le vocabulaire de Dumont.
À noter que la référence ainsi constituée se situe au plan de la société globale et non pas au plan des appartenances identitaires individuelles définies par la profession, l’âge, le sexe par exemple, sans oublier les classes sociales. La nation rassemble au-delà des différences et des identités particulières et elle assure l’intégration horizontale dans les sociétés par ailleurs divisées selon plusieurs lignes de clivages.
Dans son essai sur la nation, Françoise Mélonio reprend cette définition de la nation comme expérience historique et elle en souligne le caractère modifiable. « Tocqueville prend grand soin de préciser que le caractère national, tel qu’il l’étudie, et quoiqu’il recoure au terme de « physionomie », ne relève pas d’un déterminisme biologique ou psychologique mais seulement d’une expérience historique singulière qui n’anéantit pas la liberté. Les caractères nationaux sont acquis, non innés, et partant modifiables » (Mélonio, [1997] 2005 : 342).
Stéphane Dion avance que les écrits de Tocqueville sur le Canada reflètent la pensée de ce dernier sur les liens entre nationalisme et démocratie libérale. « Son regard sur les États-Unis est libéral et le thème du nationalisme n’apparaît qu’en second plan. Or, le raisonnement est inversé quand il s’agit du Canada où le libéralisme n’est plus qu’un élément dans l’affrontement de deux nations » (Dion, 1988 : 540). Il soutient que le voyage de Tocqueville au Bas-Canada a « éveillé chez lui à la fois une forte réaction nationaliste et une nostalgie d’aristocrate ». Selon lui, Tocqueville s’écarte ici de sa méthode habituelle en privilégiant l’opposition entre des caractères nationaux plutôt que de relier les différences entre les peuples à leur histoire politique et sociale. Commentant ce qui se passe au Canada, Tocqueville aurait donc, pour Dion, hésité ou oscillé entre deux modes d’explication des faits sociaux : une explication culturaliste par référence au tempérament national, et une explication (plus tocquevillienne) par les effets pervers induits par la centralisation gouvernementale et par le contexte historique.
Notre lecture est quelque peu différente. Bien sûr Tocqueville retrouve avec émotion les traits de ce qu’il appelle lui-même une « vieille France » en terre d’Amérique. L’émotion est encore plus vive dans son cas parce que certains traits nationaux si typiques qu’il observe sont ceux de sa Normandie natale. Mais Tocqueville ne s’enferme pas dans la nostalgie du constat ; il s’interroge aussi en sociologue sur l’avenir, sur le devenir des Canadiens, sur ce que Mélonio appelle justement « l’expérience historique singulière », mais il n’entrevoit pas de réponse claire tout simplement parce que l’avenir est imprévisible.
Raymond Aron explique pourquoi Tocqueville adopte une telle position dans ses analyses, car il « ne croit pas que l’histoire passée ait été commandée par des lois inexorables et que les événements à venir soient prédéterminés. Tocqueville, comme Montesquieu, veut rendre l’histoire intelligible, il ne veut pas la supprimer » (Aron, 1967, p. 262). Autrement dit, l’histoire relève de l’action et de l’imprévisibilité. Le diagnostic de Tocqueville sur l’avenir du Canada français illustre parfaitement cette idée. Il observe que les Canadiens sont un peuple vaincu et dominé. « Ils sentent évidemment leur position de peuple vaincu » (RBC, p. 181). Tocqueville ne sait pas si la nation canadienne-française va survivre, mais il entrevoit son avenir avec réalisme, en dégageant les facteurs qui seraient susceptibles d’en assurer le développement, mais aussi en précisant les obstacles qu’elle va rencontrer. Il analyse avec lucidité le rôle des classes (selon son expression) dans cet avenir imprévisible, et en particulier le rôle du clergé et celui des marchands et des professionnels.
« Mais parviendront-ils jamais à reconquérir leur nationalité ? C’est ce qui est probable sans malheureusement être assuré. Un homme de génie qui comprendrait, sentirait et serait capable de développer les passions nationales aurait ici un admirable rôle à jouer. Il deviendrait bientôt l’homme le plus puissant de la colonie. Mais je ne le vois encore nulle part » (RBC, p. 182-183). Ailleurs, il écrit : « Celui qui doit remuer la population française, et la lever contre les Anglais, n’est pas encore né » (RBC, p. 163).
Plusieurs commentateurs ont avancé que Tocqueville n’avait pas vraiment pris la mesure de la révolte qui s’annonçait dans la colonie et qui surviendra six ans après son séjour. Il a par contre parfaitement identifié la classe sociale qui sera au cœur de la Rébellion de 1837-1838. Au terme de l’entretien qu’il a eu avec un négociant, n’a-t-il pas ce mot d’un fin observateur de la situation : « Il est rare qu’on parle avec tant de passion de ceux dont on ne redoute rien » (RBC, 2003 : 159) ?
Résumons les éléments essentiels de l’expérience historique canadienne telle que vue par Tocqueville.
D’un côté, Tocqueville déplore l’absence d’un leader politique au Bas-Canada (il n’a pas rencontré Papineau [6]) ; il prend conscience de l’inégal poids du nombre que nous avons évoqué plus haut ; ou encore, il s’interroge sur les implications de l’association des marchands anglais avec la bourgeoisie canadienne. Mais de l’autre, il voit l’attachement des gens ordinaires à la langue française dans les campagnes ; il observe le rôle actif du clergé au sein de l’organisation sociale qu’est la paroisse et il voit que les Anglais et les Canadiens ne se mêlent pas par mariage et que la religion les sépare. Autrement dit, l’explication de la coexistence des deux nations – et des deux sentiments nationaux – n’est pas d’abord culturaliste, mais elle reste au contraire très tocquevillienne, inspirée de sa sociologie politique, la nouvelle discipline qu’il appelait de ses vœux au début de la première Démocratie comme on l’a rappelé plus haut.
Cette position intellectuelle apparaît nettement quelques années plus tard dans le commentaire qu’il adresse à Henry Reeve, greffier du Conseil privé (Londres), après les Troubles de 1837-1838. « Les Canadiens forment un peuple à part en Amérique, peuple qui a une nationalité distincte et vivace, peuple neuf et sain, dont l’origine est toute guerrière, qui a sa langue, sa religion, ses lois, ses mœurs, qui est plus aggloméré qu’aucune autre population du Nouveau Monde, qu’on pourra vaincre mais non fondre dans le lieu de la race anglo-américaine. Le temps seul pourrait amener ce résultat, mais non la législation et l’épée » (lettre du 3 janvier 1838, RBC, p. 259). Mais Tocqueville ajoute aussitôt cette remarque qui montre bien qu’il ne se limite pas à une explication culturaliste. Il met en cause le gouvernement et non pas « une guerre entre races », pour reprendre les termes de l’époque. « À l’époque de mon passage, les Canadiens étaient pleins de préjugés contre les Anglais qui habitaient au milieu d’eux, mais ils semblaient sincèrement attachés au gouvernement anglais qu’ils regardaient comme un arbitre désintéressé placé entre eux et cette population anglaise qu’ils redoutaient. Comment est-il arrivé qu’ils soient devenus les ennemis du même gouvernement ? Je l’ignore, mais j’ai peine à croire que l’administration coloniale n’ait pas quelques grands reproches à se faire, sinon pour le fond des choses au moins pour la forme » (RBC, p. 260).
Conclusion

Tocqueville est un aristocrate favorable à la démocratie, cela a été souvent répété, et il « a donné forme à l’inquiétude de son temps » selon le mot de Françoise Mélonio (1993, p. 15). D’après P. Birnbaum (1970), Tocqueville était « un gentilhomme dédaigneux des systèmes » et il n’a pas essayé de formuler de façon rigide un système de pensée ni encore moins une théorie générale. Ses écrits sur le Canada illustrent sa posture intellectuelle, sa méthode, sa philosophie politique. Il observe et s’interroge, nous l’avons maintes fois signalé, il n’est pas indifférent et il laisse clairement voir ses émotions, mais sans oublier ses idées maîtresses.
Le détour par le Canada à l’âge de 26 ans a-t-il marqué l’esprit et la pensée de Tocqueville ?
Jean-Michel Leclercq (1965) et André Jardin (1984) le donnent à penser pour ce qui est de sa réflexion sur le système colonial français – qu’il juge trop centralisateur – mais les commentateurs et analystes des écrits de Tocqueville accordent finalement peu d’attention à ce voyage en sol canadien dans la formation de sa pensée, sans doute parce qu’il n’a pas publié d’ouvrage achevé ni même un rapport sur l’ancienne Nouvelle-France, ce qui eût davantage attiré l’attention, contrairement à ses écrits sur l’Irlande ou l’Algérie, plus connus et commentés.
Jean-Louis Benoît a fait ressortir de son côté un aspect important en soulignant que le type de catholicisme qu’a observé Tocqueville au Bas-Canada a conforté « l’idée qu’il a depuis son arrivée sur le continent américain : la Révolution française n’a été antireligieuse que par un accident de l’histoire » (Benoît, 2005 : 91). On reconnaît dans cette interprétation la perspective tocquevillienne sur l’histoire qui a bien été dégagée par Raymond Aron et Raymond Boudon. L’expérience américaine – et canadienne, est-il permis de penser – a contribué à façonner sa manière de voir les choses.
Grâce au travail de Claude Corbo, le regard de Tocqueville sur le Bas-Canada est maintenant mieux connu et il nous éclaire sur l’histoire canadienne et québécoise. Mais ses écrits canadiens nous permettent aussi de mieux cerner les intentions du grand sociologue, historien et philosophe politique qu’était Alexis de Tocqueville
RÉFÉRENCES

Aron, Raymond (1967)
Les étapes de la pensée sociologique, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque des sciences humaines.
Aron, Raymond (1979)
« Tocqueville retrouvé », La revue Tocqueville/The Tocqueville Review, volume 1, numéro 1 (reproduit dans Guellec 2005, p. 25-46).
Benoît, Jean-Louis (2005)
Tocqueville. Un destin paradoxal, Paris, Bayard.
Bergeron, Gérard (1990)
Quand Tocqueville et Siegfried nous observaient…, Québec, Les presses de l’Université du Québec. [Texte disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.]
Birnbaum, Pierre (1970)
Sociologie de Tocqueville, Paris, Presses universitaires de France, 1970.
Boudon, Raymond (2005)
Tocqueville aujourd’hui, Paris, Odile Jacob.
Dion, Stéphane (1988)
« La pensée de Tocqueville. L’épreuve du Canada français », Revue d’histoire de l’Amérique française, 41, 4, printemps : 537- 552.
Dion, Stéphane (1991)
« Le Québec contemporain et le paradoxe de Tocqueville », dans Raymond Hudon et Réjean Pelletier (sous la direction de), L’engagement intellectuel. Mélanges en l’honneur de Léon Dion, Québec, Les presses de l’Université Laval : 291-311.
Dion, Stéphane (1995)
« La conciliation du libéralisme et du nationalisme chez Tocqueville », La Revue Tocqueville/The Tocqueville Review, vol. XVIII, I : 219-227.
Dumont, Fernand (1974)
Les idéologies, Paris, Presses universitaires de France, coll. Sup Le Sociologue.
Dumont, Fernand (1997)
« Essor et déclin du Canada français » Recherches sociographiques, numéro 3, pp. 419-467.
Gagné, Gilles (sous la direction de) (2006)
Le Canada français. Sa nature, son temps, son héritage, Québec, Nota Bene.
Guellec, Laurence (textes réunis par) (2005)
Tocqueville et l’esprit de la démocratie, Paris, La revue Tocqueville/The Tocqueville Review, volume XXVI, numéro 1 et Les Presses de Sciences politiques, coll. Références.
Jardin, A. (1984)
Alexis de Tocqueville, Paris, Hachette, coll. Pluriel.
Leclercq, Jean-Michel (1965)
Les Études canadiennes d’Alexis de Tocqueville, Mémoire pour le Diplôme d’études supérieures de sciences politiques, Faculté de Droit et de Sciences économiques de Lille.
Leclercq, Jean-Michel (1968)
« Alexis de Tocqueville au Canada », Revue d’histoire de l’Amérique française, 22, 3, décembre : 353-364.
Mélonio, Françoise (1993)
Tocqueville et les Français, Paris, Aubier, coll. Histoires.
Mélonio, Françoise (1997)
« Nations et nationalisme », La Revue Tocqueville/The Tocqueville Review, vol. XVIII, I : 61-73 (reproduit dans Guellec 2005, p. 337-356).
Ouellet, Fernand (1974)
Compte rendu de Jacques Vallée, Tocqueville au Bas-Canada, dans Revue d’histoire de l’Amérique française, 28, 1, juin, 129-132.
Schleifer, James T. (1986)
« De la démocratie en Amérique aux États-Unis », dans Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique. Souvenirs. L’Ancien régime et la Révolution, Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins : 667-699.
Tocqueville, Alexis de (1835)
De la démocratie en Amérique, tome I et tome II, Paris, Laffont, coll. Bouquins (1986). [Texte disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.]
Tocqueville, Alexis de (2003)
Regards sur le Bas-Canada, (textes choisis et présentés par Claude Corbo), Montréal, Typo.
Tocqueville, Alexis de (1973)
Tocqueville au Bas-Canada, (textes choisis et présentés par Jacques Vallée), Montréal, Les éditions de l’Homme. [Texte disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.]
Zunz, Olivier (2005)
« La réception de Tocqueville aux États-Unis », Conférence d’ouverture du Colloque sur le 200e anniversaire de naissance de Tocqueville, Cerisy-La-Salle et Saint-Lô, mai.
* Conférence prononcée le 8 février 2006 devant les membres de l’Association internationale d’études québécoises et ceux de la section de Québec de l’Association des membres de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA), Québec, Place royale.
1. Pour une analyse de la réception de Tocqueville en France, voir l’ouvrage de Françoise Mélonio, Tocqueville et les Français (1993).
2. RBC : Tocqueville, Regards sur le Bas-Canada, édition établie par Claude Corbo, Montréal, Typo, 2003.
3. Jean-Louis Benoît rapporte que « Monsieur Gisles était maire de Valognes et madame Noël, l’épouse de l’homme d’affaires de Cherbourg qui gérait une partie des biens de Tocqueville » (Benoît 2005, p. 91).
4. Nous citons l’édition de Robert Laffont, collection Bouquins (1986).
5. Voir entre autres Fernand Dumont, «Essor et déclin du Canada français», Recherches sociographiques, 3, 1997 : 419-467 et Gilles Gagné, (dir), Le Canada français. Son temps, sa nature, son héritage, Québec, Nota Bene, 2006.
6. Claude Corbo avance que Tocqueville a rencontré Louis-Joseph Papineau bien plus tard, à Paris, en 1839.
|

