|
Bernard TAVERNE
Ethnologue-Médecin
Chercheur à l’IRD (Institut de Recherche pour le développement),
membre de l'Association AMADES
“La construction sociale de l’efficacité thérapeutique,
l’exemple guyanais”.
Un article publié dans l'ouvrage sous la direction de Jean Benoist, Soigner au pluriel. Essais sur le pluralisme médical, pp. 19-36. Paris: Les Éditions Karthala, 1996, 520 pp.
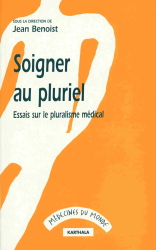
- Introduction
-
- La polyethnicité et le pluralisme médical guyanais
- Propos sur l’efficacité des différentes pratiques médicales
- Le classement des différentes pratiques médicales
- La construction sociale de l’efficacité
-
- Références bibliographiques
Introduction

Les sociétés créoles, des Antilles ou de l’océan Indien, ont pour caractéristique commune une grande hétérogénéité ethnique de leurs populations. La société guyanaise ne fait pas exception à cette règle puisqu’il est possible d’y dénombrer une dizaine de groupes ethnoculturels différents. Ce rassemblement, dans un même espace géographique et politique de groupes ethniques aux traditions culturelles parfois très éloignées, a pour conséquence la juxtaposition de différentes pratiques médicales, souvent spécifiques de chaque groupe.
En cas de maladie, les individus ont théoriquement accès à des pratiques médicales variées qui ne relèvent pas uniquement de leur propre tradition. Un espace de choix s’ouvre devant eux, mais l’accessibilité à chacune des pratiques médicales est en fait limitée par différentes contraintes (culturelles, économiques ou sociales) qui ne sont pas toujours clairement perçues par les individus. Lorsque l’on cherche à préciser quelles sont les motivations qui ont conduit les malades à choisir une médecine donnée pour un problème pathologique particulier, des explications telles la proximité géographique, l’influence du voisinage ou de la famille, ou encore le coût des soins, sont très rarement évoqués. Par contre, il est systématiquement fait référence à l’efficacité de la pratique médicale choisie, à travers un discours logique liant le choix thérapeutique et l’efficacité. Toutes les autres contraintes paraissent occultées par une référence générale à l’efficacité thérapeutique qui seule légitimerait les choix. L’analyse des discours émis par des individus originaires de groupes ethniques différents, permet de mettre à jour les divers classements des médecines les unes par rapport aux autres. Chaque groupe ethnique proposant sa propre hiérarchisation, on obtient ainsi autant de classifications différentes que de groupes ethniques. On ne peut manquer de constater que ces classements sont étroitement dépendants de la stratification sociale. Dans ces conditions se posent les questions : 1) de savoir ce que les choix thérapeutiques doivent à l’efficacité technique des différentes médecines ou au contexte social dans lequel ils se réalisent, 2) quels sont les critères majeurs de reconnaissance de l’efficacité thérapeutique appliqués aux différentes médecines.
La polyethnicité
et le pluralisme médical guyanais

Avec un peu plus de 120 000 habitants (1992), la population guyanaise se présente sous l’aspect d’un véritable creuset polyethnique. Les principaux groupes ethniques se répartissent comme suit :
- - environ 45 000 Créoles guyanais, issus du métissage entre les populations européennes et africaines de la période de l’esclavage ; ils constituent le groupe majoritaire, socialement dominant par leur maîtrise du pouvoir politique local,
-
- - 4 000 Amérindiens qui se répartissent en six groupes : Arawak, Emerillon, Galibi, Palikur, Wayana et Wayãpi,
-
- - 6 000 Noirs Marrons ainsi nommés par référence à leurs ancêtres, des esclaves africains qui s’étaient enfuis des plantations de l’ex-Guyane Hollandaise, l’actuel Surinam, au cours du XVIIe et XVIIIe siècles. Ils se répartissent eux aussi en six groupes : Aluku (ou Boni), Kwinti, Matawaï, Ndjuka, Paramaka et Saramaka,
-
- - 1 000 Chinois dont les premiers sont arrivés à la fin du XIXe siècle,
- - 1 600 Hmong, réfugiés du Sud-Est asiatique dans les années 1977-1979,
- - 10 000 Surinamiens,
- - 15 000 Brésiliens,
- - 20 000 Haïtiens arrivés entre 1975 et 1985 et quelques autres ressortissants des îles Caraïbes anglophones et francophones,
- - 12 000 Français « métropolitains »,
-
- - et un « émiettement » ethnique constitué de Libanais, d’Indonésiens de Java, de ressortissants du Guyana, etc.
Ce peuplement s’est réalisé à travers diverses vagues migratoires qui ont jalonné l’histoire de la Guyane. Certaines de ces migrations ont été organisées et n’ont concerné qu’un effectif limité de population ; d’autres se sont créées spontanément et ont débordé les différentes tentatives de contrôle et de régulation mises en place par l’administration ces vingt dernières années. Il est admis actuellement qu’environ la moitié de la population vivant sur le sol guyanais est de nationalité étrangère et que près de 50 % des immigrés sont en situation irrégulière au regard de la législation française sur l’immigration.
Selon Jolivet (1982), jusque à la fin des années 1960, les diverses vagues migratoires ont été bien acceptées par la population créole dans le cadre d’un processus d’assimilation/créolisation des nouveaux arrivants. Mais à partir des années 1970, au moment des afflux importants de migrants Brésiliens, puis dans les années 1980 avec l’arrivée des Haïtiens, une stratégie de repli a émergé dans la population créole. Diverses réactions de rejet, accompagnées de discours xénophobes, sont apparues, tenant les étrangers — le plus souvent les derniers arrivés — pour responsables de toutes les difficultés que rencontre le département : chômage, habitats insalubres, insécurité, accroissement des dépenses sociales, etc. Cette tension sociale réapparaît périodiquement sans atteindre, jusqu’à présent, un niveau de crise grave (Calmont 1988, Chérubini 1988).
Cette juxtaposition ethnique crée une situation de pluralisme médical par la coexistence, au sein d’une même unité sociale, de divers recours thérapeutiques répondant à des modèles variés d’interprétation de la maladie et de ses causes. Chaque groupe ethnoculturel, ayant ses propres modèles d’interprétation de la maladie et du malheur, dispose de ses propres spécialistes pour lutter contre les infortunes de la vie quotidienne, dont la maladie n’est bien souvent qu’une des manifestations. À ce titre, ne considérer, chez les thérapeutes traditionnels, que les domaines d’intervention en rapport avec la maladie serait une erreur. En effet, la plupart d’entre eux ne limitent pas leurs actions aux seuls désordres biologiques, mais peuvent tout aussi bien intervenir dans des domaines régissant de manière plus générale la vie des personnes, comme la recherche d’un emploi, les relations amoureuses ou la « chance ». Isoler le domaine médical reviendrait à morceler de manière artificielle leur espace d’intervention et ainsi conduirait à en perdre la signification réelle.
Il est donc possible d’identifier en Guyane des recours thérapeutiques relevant des traditions amérindiennes, marronnes, guyanaises, brésiliennes, haïtiennes, chinoises, saint-luciennes, et autres. À ces différentes pratiques médicales reconnues sur la base de critères ethniques, il faut également ajouter les structures transethniques constituées par des Eglises de diverses confessions (témoins de Jéhovah, Eglise adventiste) dans lesquelles se réalisent des rituels à visée explicitement thérapeutiques, et l’ensemble du secteur biomédical : en sa qualité de département français la Guyane dispose d’une infrastructure biomédicale particulièrement développée.
Propos sur l’efficacité des différentes
pratiques médicales

La présence de diverses pratiques médicales ne signifie pas pour autant qu’elles soient toutes situées sur un plan d’égalité et utilisées, ou plus exactement utilisables, par chacun des habitants de Guyane. L’observation d’itinéraires thérapeutiques révèle l’existence de choix, d’orientations préférentielles différentes selon les individus, mais le plus souvent communes aux membres d’un même groupe ethnique. Certaines pratiques médicales sont valorisées au détriment d’autres. Les différentes pratiques médicales, y compris la biomédecine, sont l’objet, de la part des membres de chaque groupe de classifications qui les hiérarchisent les unes par rapport aux autres sur la base de leur efficacité relative.
La légitimation des choix thérapeutiques a été étudiée à travers l’analyse d’entretiens effectués auprès de membres de différents groupes ethniques, parfois à l’occasion de séances thérapeutiques. Les informations ainsi acquises ont été confrontées à l’observation des consultations chez des thérapeutes haïtiens, brésiliens et saramaka.
Un choix de fragments d’entretiens, réalisés avec des personnes issues de six groupes ethniques (brésilien, chinois, guyanais, haïtien, galibi et saramaka), permet d’exposer les opinions caractéristiques de chacun à l’égard des différentes médecines.
Pendant que son époux se fait soigner par un « docteur-feuille » haïtien, une femme Guyanaise ne cesse de se plaindre de la biomédecine :
- « J’ai de la tension, le docteur m’a donné du Fludex® et de l’Aldomet® [1] mais je ne les prends plus ça me donnait des douleurs dans les bras et dans les jambes et puis ça m’endormait. Maintenant je ne prends plus rien et quand ça va pas bien je fais un peu de régime et je prends des tisanes que me donne une amie. Ça marche beaucoup mieux que la médecine des docteurs. J’ai une amie dont le mari devait être hospitalisé pour une opération, il avait des calculs dans les reins, à l’hôpital ils voulaient l’opérer, lui ne voulait pas, sa femme lui a fait boire des tisanes et bien le lendemain il commençait à uriner des cailloux et quand il est retourné voir les médecins ils ont dit que ce n’était plus la peine d’opérer. »
Afin de renchérir sur les propos de sa femme, et pour prouver la qualité des médecines traditionnelles, le mari entreprend alors de raconter l’histoire suivante concernant la médecine des Saramaka :
- « Les Saramaka, ils sont très forts pour les os, pour les fractures, chez les Saramaka, il y a un enfant un jour qui s’amusait avec un fusil, il a pris la décharge en pleine figure, sur le côté du visage, tout était cassé, et bien le Saramaka, il l’a guéri sans l’amener à l’hôpital. Il a mis l’enfant dans une case, il y est resté six mois, personne n’avait le droit d’entrer, sauf lui et une jeune fille vierge qui apportait la nourriture et bien au bout des six mois, la mâchoire était totalement réparée et l’os était encore plus dur qu’avant. »
À propos des différentes pratiques médicales populaires un Guyanais âgé de 35 ans affirme :
- « Les Saint-Luciens c’est quand vous avez la bless [2], mais pour les remèdes créoles, il faut voir les Saramaka, pour les os, mais aussi pour les remèdes feuilles. Les Haïtiens au niveau des herbes aussi, mais c’est le vaudou, c’est déjà autre chose, c’est reculé, eux ils viennent avec leur culture, alors il y a ceux qui diront qu’ils sont docteurs en… médecin d’herbe, ils vont dire : docteur-zerb. Et puis si t’as un problème d’esprit, je connais des Haïtiens qui sont capables de faire venir des esprits, mais ça c’est un domaine complexe. Je connais un Brésilien que je suis allé voir plusieurs fois, lui il est capable de faire les deux à la fois, il donne des plantes et il fait venir l’esprit, moi je ne connais pas de Guyanais qui font ça, des Haïtiens oui, mais pas de Guyanais. Je suis allé voir une femme une fois, une Dominicaine, c’est une dame qui regarde dans le truc de café, ça c’est différent, il n’y a pas de manifestation, il n’y a rien, l’esprit ne vient pas sur elle, mais elle a la présence quand même. »
Un autre Guyanais pour conclure ses propos résume sa pensée en une seule phrase :
- « Les plus forts, c’est les Saramaka, après c’est les Indiens et après c’est les Haïtiens. »
Pour un thérapeute Saramaka âgé d’environ 55 ans, demeurant à Cayenne :
- « Tous les Haïtiens de Guyane sont des mauvais, les bons sont restés en Haïti, ceux qui pratiquent ici n’utilisent que la magie noire, ils ne savent faire que le mal. Les Brésiliens, je sais qu’ils marchent avec le Saint-Esprit, mais je ne sais rien de plus. À Cayenne il y a aussi des Africains, je suis allé en voir un une fois, il m’a demandé 400 francs, une chandelle et une bouteille de whisky, rien que pour savoir si j’étais malade. Ensuite, si j’avais voulu me faire soigner, il fallait payer 3 000 francs plus une caisse de six bouteilles de tafia et une de douze bouteilles de bière, je n’y suis pas retourné. Les seuls qui connaissent bien sont les Saramaka et toutes les nations indiennes [les différentes ethnies amérindiennes]. »
La reconnaissance qu’exprime cet homme Saramaka à l’égard des Amérindiens est réciproque, un homme galibi affirme :
- « À Cayenne si on est malade on va d’abord chez le médecin, mais si ça n’est pas de son ressort on va chez le chamane. Depuis une dizaine d’année il y a des gens qui vont voir des Noirs Réfugiés [3] ou des Brésiliens mais pas des Créoles. À Cayenne il n’y a pas d’Indiens capables de soigner, il faut aller à Awara. Il y a même des non-Indiens qui viennent voir le chamane, des Javanais, des Créoles, des Métros, des gens de Cayenne ou du Surinam. Parfois c’est lui qui se déplace, quand il faut purifier une maison, il vient à Kourou, à Cayenne, même à Paramaribo. »
De son côté un thérapeute Brésilien considère que :
- « Les Saramaka savent beaucoup de choses, pour les os, les jambes cassées, avec les Saramaka, il n’y a pas besoin de chirurgien, il met des plantes des deux côtés de la jambe et il répare. Je sais qu’il y a des Chinois qui font ça mais je n’en ai jamais vu. »
Cette dernière information n’a été confirmée par aucun des Chinois rencontrés à Cayenne. Mais à propos de l’usage des différentes médecines l’un d’eux, dirigeant d’une grande société commerciale, affirme :
- « Les Chinois n’ont pas confiance à la médecine française et ils ont bien raison, quand on voit ce qu’ils font… Quand les gens sont malades ils préfèrent aller à Bélemil y a là-bas une équipe de Japonais qui sont très forts, ou alors repartir en Extrême-Orient. En Guyane il y a un état de délabrement avancé de la médecine, il n’est même pas possible d’avoir une interprétation radiographique correcte. Mais la médecine locale est forte, je connaissais une femme qui avait un cancer du sein, elle était condamnée par les médecins, elle a totalement guéri en suivant le traitement d’un Saramaka. Moi je vous dis que la médecine locale connaît des choses que l’on pourrait qualifier de miraculeuses. »
Un autre dirigeant d’entreprise chinois confiait :
- « j’avais un problème d’entorse au bras, je suis allé voir un Saramaka... Il m’a soigné en me massant avec des plantes. »
Enfin, un Haïtien affirme :
- « Ici, les Boni, ils sont très forts parce qu’ils n’utilisent pas les feuilles mais les racines, en Haïti on utilise les feuilles mais les Boni utilisent la racine. Il y a beaucoup d’Haïtiens qui vont voir les Boni, il y en a un qui habite au fond de la zone à… Il est fort. »
Le classement des différentes
pratiques médicales

Ces extraits d’entretiens révèlent la place centrale de la référence à l’efficacité dans le processus de hiérarchisation des différentes médecines. Le thème de l’efficacité est traité différemment selon que les individus jugent soit les médecines traditionnelles, soit la biomédecine. Deux modalités d’évaluation opèrent. Seuls les succès des médecines traditionnelles sont retenus, d’autant plus qu’ils paraissent « miraculeux » comme l’affirme l’une des personnes interrogées. Les exemples cités sont puissamment suggestifs : la reconstruction d’un visage délabré par un coup de feu ou la guérison d’un cancer. À l’inverse, les insuffisances et les échecs de la biomédecine sont constamment mis en avant, comme s’il était sous-entendu qu’elle soit astreinte à la réussite. Les argumentations sont bâties de manière inverse, elles tendent à la valorisation systématique des pratiques traditionnelles et la dévalorisation permanente de la biomédecine. Ce processus révèle que ce qui est présenté comme une appréciation portant sur les pratiques elles-mêmes à partir d’expériences individuelles est en fait prédéterminé par une idéologie plus générale quant à la place des diverses médecines dans la société. Cette situation est comparable à celle qui prévaut en France à propos de l’opposition entre les « médecines douces » et la biomédecine : entend-on souvent des plaintes à propos des insuffisances et du manque d’efficacité des médecines douces ou des erreurs diagnostiques de leurs thérapeutes, avec des termes identiques à ceux employés envers la biomédecine ?
Les médecines des Noirs Marrons et des Amérindiens sont unanimement considérées les plus efficaces. Il est remarquable que la désignation précise des groupes ethniques n’intervienne pas alors qu’il existe six groupes différents d’Amérindiens et autant de Noirs Marrons. Ces derniers sont parfois désignés par les Créoles Guyanais ou par les Haïtiens sous l’appellation Saramaka ou Boni. Il ne s’agit cependant pas d’une spécification précise, car en règle générale, ces termes sont employés dans une acception générique globale désignant les Noirs Marrons dans leur ensemble, sans volonté de signifier de manière précise l’ethnie concernée. Ainsi, l’attribution de pouvoir thérapeutique est effectuée de manière indistincte, en direction de groupes généraux, sans chercher à préciser quelle est celle de leur composante qui serait effectivement la plus compétente. Cette tendance à la généralisation et à l’amalgame se retrouve dans l’appellation même des pratiques médicales que donnent les Créoles aux médecines traditionnelles. « Pour les remèdes créoles, il faut voir les Saramaka », affirme un Créole Guyanais, assimilant dans ses propos la médecine marronne à la médecine créole. Il est procédé de même avec les médecines haïtienne et brésilienne, toutes deux désignées sous le terme « médecine créole » par les Guyanais. L’appellation « médecine créole » est progressivement devenue une appellation générique désignant toutes les pratiques de santé traditionnelles, autres que biomédicales.

Figure 1. Les orientations préférentielles des recours
thérapeutiques parmi six groupes ethniques de Guyane
Les fragments de conversation rapportés ci-dessus désignent les choix thérapeutiques privilégiés par chaque groupe ethnique et révèlent également les orientations qui paraissent ne jamais être suivies, les choix que l’on pourrait considérer « impossibles ». La figure 1 traduit les principales orientations thérapeutiques des membres de six groupes ethniques. Seuls ont été tracés les choix constatés à travers l’étude d’itinéraires thérapeutiques, l’extrémité des flèches indique les thérapeutes. Ces lignes représentent des courants préférentiels, qui ne peuvent être considérés comme l’expression de règles absolues.
Les Créoles Guyanais, peut-être à cause de leur désir d’appropriation des différentes pratiques médicales traditionnelles, n’hésitent pas à utiliser les multiples recours disponibles. Par contre, toute une série d’itinéraires ne sont a priori pas empruntés : Amérindiens, Noirs Marrons, Brésiliens et Chinois ne consulteraient ni les Créoles Guyanais ni les Haïtiens.
La biomédecine n’est pas exclue de ce type de classification mais les jugements à son égard s’orientent dans deux directions différentes selon l’appartenance ethnoculturelle des personnes interrogées.
D’un côté, on relève un discours constitué de critiques parfois acerbes de la part des Créoles Guyanais et des Chinois. La compétence des médecins est remise en cause et l’ensemble de leur pratique est contesté : 1) les diagnostics ne seraient pas fiables : ils ne savent pas interpréter les radiographies ; 2) les indications thérapeutiques seraient mal adaptées : ils proposent des traitements lourds tel une opération chirurgicale alors qu’une simple tisane fait l’affaire ; 3) leur incompétence est définitivement marquée par leurs propres aveux de ne pouvoir soigner des maladies comme le cancer qu’un Saramaka est capable de guérir. Il ne s’agit plus d’opinions sur le partage des compétences entre différentes pratiques médicales mais d’une réelle contestation et de la remise en cause du savoir médical qui rappelle les critiques d’Illich (1975). À la différence de ce qui a pu se passer en France métropolitaine cette contestation n’a pas débouché sur le recours aux médecines « douces » [4] (acupuncture, homéopathie, etc.) mais sur une apologie des médecines populaires locales « qui font des miracles ». Là encore, la position sociale des locuteurs éclaire le contenu de leurs propos : seuls les Créoles Guyanais et les Chinois s’engagent dans de telles critiques. D’un autre côté, Amérindiens, Noirs Marrons, Brésiliens et Haïtiens ont une position bien différente. Ils considèrent la médecine moderne et les médecins avec un respect non dépourvu d’admiration, qui n’est pas sans tenir à l’écart de statut social. Tous reconnaissent, en l’exprimant de manière à peine différente, que les médecins ont des compétences certaines mais ils les jugent incapables de diagnostiquer et de traiter certaines maladies (les maladies dues « aux esprits » ou « maladies surnaturelles »), pour la seule raison « qu’ils ne savent pas les voir ». Cette limitation n’est pas présentée en termes d’incompétence mais comme la conséquence d’une coupure irrémédiable dans l’univers des connaissances des différents thérapeutes. Certains domaines de la maladie peuvent être pris en charge par les médecins, mais d’autres incombent exclusivement aux tradipraticiens ; une fois cette séparation reconnue, les compétences de chacun ne sont pas contestées.
La construction sociale de l’efficacité

L’attribution de la plus grande efficacité thérapeutique aux médecines des Noirs Marrons et des Amérindiens de la part des groupes ethniques socialement dominants pourrait surprendre si l’on n’y reconnaissait une des expressions du « mythe du bon sauvage ». L’attitude des Créoles Guyanais à l’égard des Noirs Marrons et des Amérindiens est ambivalente. Les Noirs Marrons sont parfois qualifiés par les Guyanais de nèg nan bwa (nègres des bois, gens de la forêt), expression connotée de préjugés péjoratifs, attribuant à ces personnes une « mentalité primitive » et « peu développée », qui n’est pas exempte d’un fort mépris. Les Amérindiens sont également déconsidérés de la même manière. Fort maladroitement la presse locale, écrite et radiodiffusée, se fait régulièrement l’écho des éternels lieux communs affirmant qu’Indiens et Noirs Marrons « ne savent faire autre chose que de vivre sur les allocations familiales et le rmi ». La place occupée par ces deux groupes dans la hiérarchie sociale départementale est comparable à celle des Haïtiens et des Brésiliens, à la différence près du statut d’immigré. Les conditions de vie des habitants du « quartier saramaka » de Kourou ne sont pas notablement meilleures que celles des Haïtiens ou des Brésiliens ; il en est de même à Cayenne, où à quelques exceptions près, ils habitent dans les mêmes quartiers insalubres. Les uns comme les autres sont maintenus dans les mêmes espaces de marginalisation, économique, sociale et politique [5]. Ils appartiennent au même sous-prolétariat urbain et constituent un volant de main-d’œuvre journalière non déclarée que certains employeurs viennent chercher tôt le matin par fourgonnettes entières.
Dans le même temps les Guyanais ne refusent pas, dans l’ambiance actuelle de promotion des « cultures traditionnelles » comme valeur identitaire, l’honneur de partager leurs origines avec ces révoltés de la première heure contre le pouvoir des Blancs, que furent Amérindiens et Noirs Marrons. Bien plus, ces deux groupes sont perçus dans le cadre d’une « idéologie naturaliste des racines » comme les symboles vivants de la résistance politique originelle et du pouvoir magique ancestral perdu par les Guyanais (Chalifoux 1987). Amérindiens et Noirs Marrons sont considérés comme ayant conservé à travers leurs croyances religieuses et leurs pratiques magiques, un savoir supérieur à tout autre groupe (Jolivet 1982 : 404).
On retrouve fréquemment chez les Créoles l’expression d’un regret douloureux quant au sentiment de la perte des connaissances et des pouvoirs que possédaient les « anciens », comme si le fil d’une tradition s’était rompu. Une vieille femme créole affirme : « Les vieux guyanais savaient faire, ils étaient forts, mais ils sont tous morts, ceux de maintenant, ils parlent mais il ne font rien ». Cette certitude, qui n’admet aucun doute sur l’existence même de ces connaissances et sur leur nature, est renforcée par l’idée que d’autres groupes ethniques ont préservé leurs savoirs. L’idéalisation de cet âge d’or perdu conduit à penser que les individus qui seraient restés les plus proches du passé, les plus fidèles à leur tradition, ont gardé le plus de connaissances. C’est exactement ce qu’exprime un Créole Guyanais en affirmant : « Les Haïtiens... c’est reculé... c’est le vaudou ». Dans cette perspective, les Haïtiens occupent en effet une place de choix.
L’idéologie primitiviste s’exprime ici totalement, elle est à l’origine d’un processus d’inversion symbolique du pouvoir social qui conduit à considérer les médecines marronne, amérindienne et haïtienne comme les plus efficaces. Cette inversion symbolique consiste à attribuer aux groupes ethnoculturels occupant les échelons les plus bas de la hiérarchie sociale, les pouvoirs thérapeutiques les plus élevés. La reconnaissance du pouvoir thérapeutique apparaît quasi proportionnelle à la distance sociale qui sépare les individus. Cette distance sociale, largement dépendante de critères économiques, est généralement interprétée en termes de distance culturelle. Cette dernière légitime l’attribution et la croyance en l’existence de savoirs mystérieux et puissants des thérapeutes considérés : plus l’Autre est distant, plus il est redouté.
Cette situation n’est pas une production spécifique de la société guyanaise, des faits similaires sont décrits dans d’autres aires créoles (île de la Réunion et île Maurice : Andoche 1988, Benoist 1980) et se retrouvent de manière générale, avec des expressions à peine différentes, dans la plupart des sociétés polyethniques. Cette hiérarchisation dictée par le groupe socialement dominant n’est l’objet d’aucune remise en cause. Elle est perçue par les membres des groupes marginalisés comme une marque de reconnaissance sociale (la seule qu’ils possèdent ?) qu’ils réutilisent comme emblème identitaire valorisant. Le bénéfice de cette reconnaissance est tout à fait ambigu. Celle-ci s’enracine dans l’ordre social qui maintient les groupes concernés à la marge de la société, elle est clairement un produit de cette marginalisation. Aussi elle ne saurait servir de faire-valoir à une revendication de changement de statut social qui aurait pour première conséquence de la remettre en question.
Le principe d’efficacité thérapeutique mis en avant par la plupart des personnes interrogées est le produit d’une construction sociale qui permet l’élaboration d’une représentation collective de l’efficacité des médecines citées. Cette représentation est l’objet d’un large consensus dans la population, elle recouvre le champ de la connaissance, dans la mesure où elle est à la fois un savoir et une évaluation, et celui de l’action qu’elle structure puisqu’elle oriente les choix thérapeutiques des individus (Laplantine 1989 : 278).
Un des caractères particuliers de cette représentation de l’efficacité tient au support de son élaboration. La question de l’efficacité thérapeutique, thème majeur de réflexion en anthropologie médicale, est souvent abordée à travers l’étude des pratiques de santé : supports matériels ou symboliques, chaînes opératoires, techniques, etc. Les diverses composantes des thérapies ont été l’objet d’observations et d’analyses générant des hypothèses dans des domaines aussi variés et étendus que la physiologie et la neuroendocrinologie, la pharmacologie, la psychologie, etc. Et même si l’on prend garde, comme le rappelle Benoist (1986), à ne pas séparer dans l’analyse des pratiques thérapeutiques les trois éléments que sont les substances, les conduites et les comportements globaux, et si l’on s’attache à comprendre « la forme de la relation qui s’établit entre le thérapeute et son patient », on n’en reste pas moins au niveau des pratiques elles-mêmes. Il est encore implicitement suggéré que c’est à travers elles, et elles seules, que s’élabore la reconnaissance de l’efficacité thérapeutique. Il n’est pourtant pas question de nier qu’une certaine évaluation empirique des pratiques puisse être effectuée par les utilisateurs des médecines concernées. Les demandes de soins ne relèvent pas seulement des discours, elles attendent bien des actes effectifs qui sont nécessairement jugés par les utilisateurs. Il est certain que ces jugements participent à la construction de la représentation de l’efficacité.
Cependant, la mise en évidence du processus de construction sociale de la représentation de l’efficacité, révèle que l’élaboration de cette représentation se constitue en deçà des pratiques elles-mêmes. On serait tenté de dire presque indépendamment des pratiques, puisqu’elle s’enracine dans la structure sociale ; les critères employés, par exemple la proximité avec la Nature, ne concernent pas les techniques médicales mais bien le statut social des gens qui les mettent en œuvre. La représentation de l’efficacité préexiste donc bien aux pratiques. Elle détermine, en l’orientant, l’appréciation que portent les consultants sur les pratiques auxquelles ils ont recours. Les expériences individuelles ne semblent se constituer que par rapport à cette construction préalable. La référence aux résultats des pratiques de soins, que les utilisateurs constituent en preuve de l’efficacité, n’est qu’une construction secondaire qui occulte la détermination sociale des choix thérapeutiques.
Alors que les choix thérapeutiques sont pensés et présentés par les individus comme des choix raisonnés sur la base de critères d’efficacité, ils apparaissent en fait plus largement déterminés par le contexte social dans lequel ils se réalisent. Reconnaître ce processus oblige à tenir compte des rapports sociaux institués au sein d’une population avant d’en interpréter les recours thérapeutiques, et souligne combien les choix thérapeutiques sont aussi des révélateurs privilégiés des relations sociales.
Références bibliographiques

Andoche J.
1988 L’interprétation populaire de la maladie et de la guérison à l’île de la Réunion, Sciences Sociales et Santé VI (3-4) : 145-165.
Benoist J.
1980 Les carnets d’un guérisseur réunionnais, St-Denis, Fondation pour la recherche et le développement dans l’océan Indien, 124 p.
1986 La question de l’efficacité en anthropologie médicale, in : Médecines du Monde : Anthropologie et pratiques médicales, Actes du colloque 27-28 janvier 1986, Paris, Ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, pp. 91-98.
Calmont R.
1988 Migration et migrants en Guyane Française. L’exemple de la communauté haïtienne, Thèse de doctorat de troisième cycle, Université Bordeaux III, 449 p.
Chalifoux J.-J.
1987 La créolité transculturelle en Guyane, communication au colloque sur La Créolité, 15 octobre 1987, Cayenne.
Chérubini B.
1988 Cayenne, ville créole et polyethnique, Karthala et Cenaddom, 261 p.
Grenand P., Grenand F.
1990 Les Amérindiens, des peuples pour la Guyane de demain, Centre ORSTOM de Cayenne, 72 p.
Illich I.
1975 Némésis Médicale. L’expropriation de la santé, Paris, Seuil, 222 p.
Jolivet M.-J.
1982 La question créole. Essai de sociologie sur la Guyane Française, Ed. de l’ORSTOM, coll. mémoires, n° 96, 502 p.
Laplantine F.
1989 Anthropologie des systèmes de représentations de la maladie : de quelques recherches menées en France contemporaine réexaminées à la lumière d’une expérience brésilienne, in : D. Jodelet (ss. la dir.), Les représentations sociales, PUF, pp. 277-298.
Taverne B.
1991 Un « docteur-feuille » à Cayenne. Santé, culture et société chez les immigrés haïtiens de Guyane Française, Thèse Doctorat nouveau régime en Anthropologie, Aix-Marseille III, xix + 579 p.
[1] Fludex® (Indipamide) est un diurétique fréquemment prescrit lors du traitement de l’hypertension artérielle, Aldomet® (Alpha-méthyldopa) est un anti-hypertenseur central pouvant entraîner entre autres effets indésirables une somnolence.
[2] Syndrome douloureux épigastrique défini selon la nosologie créole, n’ayant pas de correspondance dans la nosologie biomédicale.
[3] Autre appellation des Noirs Marrons.
[4] En 1988, on comptait à Cayenne trois médecins à orientation acupuncture et aucun à orientation homéopathique sur un effectif total d’environ 50 médecins.
[5] Même si la récente création d’une commune amérindienne est sûrement l’un des premiers pas d’une reconnaissance politique débutante (cf. Grenand P. et F. 1990).
|

